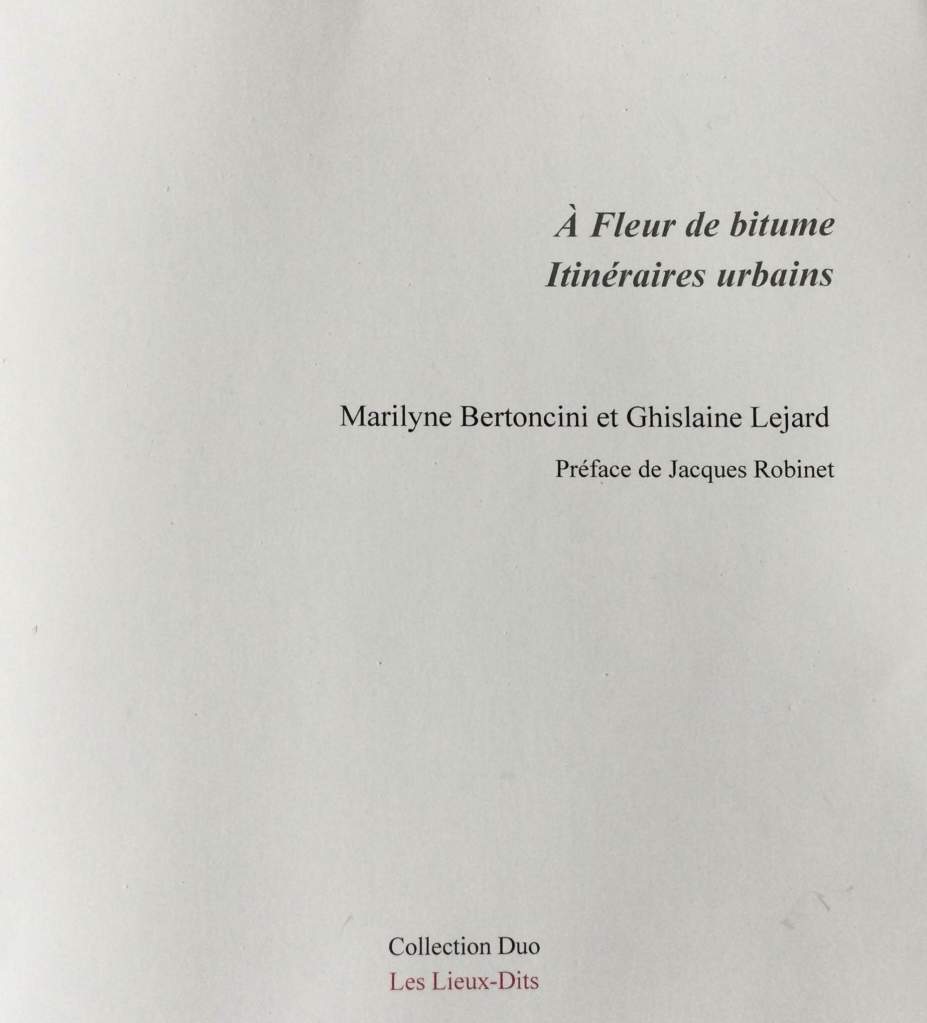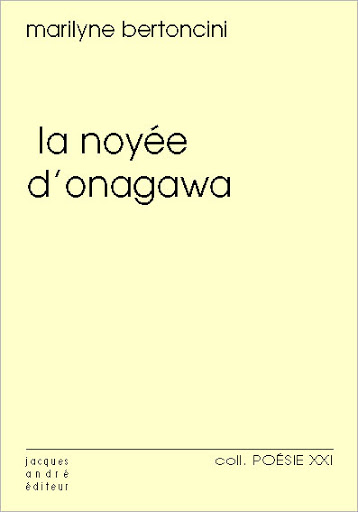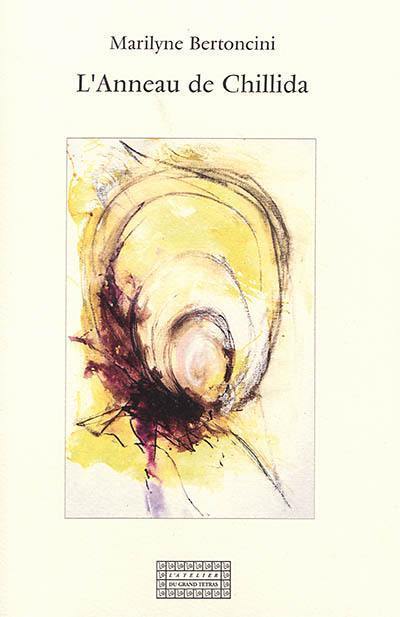Une chronique de Murielle COMPÈRE-DEMARCY (MCDem.)
Numéro Spécial Poésie/première
Ce Hors-Série 2025 de Poésie/première fête le trentième anniversaire de la revue et les vingt ans de l’association qui en est l’éditrice. En sus des trois numéros annuels, ce numéro exceptionnel nous permet de faire un bout de chemin avec les douze rédacteurs actuels de la revue qui ont déployé leur inspiration sur un terrain thématique commun : celui de l’absence, de la vulnérabilité. Ce qui n’est guère possible habituellement, puisque les quatre poètes appartiennent au Comité de lecture de la Revue et que, par modestie et déontologie, ils n’y publient pas leurs propres textes. En outre, Alain DUAULT —poète musicologue que beaucoup connaissent et qui porte une attention à la revue en participant aussi à certaines rencontres organisées par celle-ci (par exemple lors du « Mercredi du Poète » consacré à l’œuvre poétique de Monique LABIDOIRE, avec des lectures de Colette KLEIN)— offre ici un texte avec un récit poignant en lien avec les thèmes proposés. Des plasticiens (« lecteurs non moins fidèles à notre revue », précise Gérard Mottet) participent également à ce numéro Hors-Série 2025 : Laurent NOËL, Colette KLEIN, René CHABRIÈRE et Marc BERGÈRE.
Le numéro fait place aux textes des douze rédacteurs suivant un ordre logique de cohérence au vu de la thématique retenue. Ainsi la visite au musée d’Orsay de Michèle DUCLOS répond aux voyages en train de Marilyne BERTONCINI ouvrant le florilège, tandis que la marche de Claire GARNIER-TARDIEU trace d’autres passages, oniriques, sur lesquels « On croit marcher impunément / Mais les chemins sont faits de nos pas ». Francis GONNET donne la voix à la tisseuse mémoire, afin que celle-ci « donne sa voix au silence ». Le silence, note de musique qui, sans cesse, « réinvente nos battements de cœur ». « Pour que vive l’absence », écrit le poète, « je noue au présent, les mailles de notre histoire, j’attache nos paroles aux lumières d’un poème ». Telles des vrilles s’enroulant autour du cep poétique… Et sa pluie écrivaine, qui « raie le silence », en ce poème où « les encres se diluent au pas de l’eau » a une tonalité qui fait écho aux vers de Marie-Line JACQUET, dans lesquels la poète rêve que « Si les yeux coulent / Dans la fatigue / Ils s’ouvriront au fond /sur bien d’autres royaumes. »
La forme chantée par Jacqueline PERSINI « Entre ce qui se défait / du côté des ombres / et ce qui s’échappe / par la fenêtre » : pour conjurer la perte « Je crée la forme de / ta bouche, de tes mains / comme un soleil… » se retrouve dans les poèmes poignants de Martine MORILLON-CARREAU qui soulèvent le cœur de nos « vulnérabilités« . Nous comprenons que la poète accompagne un proche dans sa maladie renvoyée visuellement par la « cicatrice » sur le tronc d’un bouleau d’une « noire H ».
sûrement pas de hache ici ni surtout
grande contre l’écorce
du vieux bouleau
de quoi donc alors sinon délicat le
poignard peut-être
le quel sombre silence aux aguets
Non pas signe cabalistique d’une hache, mais « obscur tarot plutôt », accroissement d’un signe noir, funeste, sur l’arbre de la vie. L’écriture, syncopée, s’énonce dans la fragmentation de la douleur, déroulant le poème visuel du corps se morcelant « sur le fil fragile du temps ». La poète, traversée par la douleur, exprime « l’angoisse amère » présente, dès « l’absence annoncée », face à la joie incommensurable, « irréparable » vécu avec son amour ; parle de l’effacement de soi (« partir quitter la scène ») à l’heure du Grand âge, invoquant « (nos) brèves / mémoires / espérées ».
Le poème de Gérard MOTTET, extrait de Par les chemins de vie (éditions Unicité ; 2017) et dédié à la poète Colette GIBELIN nous parle de l’absence et de la vulnérabilité à travers « le vacillement de la lumière ». Colette GIBELIN, « voix féminine majeure de la poésie contemporaine » (Luc VIDAL), évoque en effet souvent le flamboiement de l’ombre au cœur de la lumière, parmi la ferveur de vivre. Sa poésie s’avance sur le fil d’un équilibre existentiel précaire, condensant notre fragilité et notre ferveur de vivre, maintenant le cap au-dessus du vide dans un lyrisme contenu, telle, ainsi que l’écrit Gérard MOTTET, dans une contribution musicale, par son rythme et ses références : « Le long d’une musique imaginée / sur les portées déjantées de la vie », qui ramène au premier poème du recueil, celui de Marilyne Bertoncini qui se déplie en paysage/déphasage où les « Murmurations du souvenir » s’abouchent au Fleuve de l’Écrire « sous un même ciel, (en) différents temps ». Ce leitmotiv, traduit aussi en anglais, rythme un Poème de vie à l’instar de Cendrars dont l’encre trempait aussi dans la vie. Lille-le Nord est cette » île de mémoire » morcelée, refaite par les mots des minutes de sable où la poétesse nous trans-porte : rue Eugène Jacquet ,
je pense aux jars du camp gitan
avant même le temps de l’enfance
vert et vierge territoire
la rue qui depuis Fives menait en ville
en traversant
le Jardin des Dondaines
rue Greuze,
rue Greuze
tu creuses dans mes souvenirs
un abîme de ciel gris
… car le ciel de l’Écrire creuse, en profondeur, comme l’émotion d’un lieu plutôt que le lieu lui-même ; comme « les grands travaux allaient commencer / le creusement de nouvelles tranchées « – Lille -Europe où » d’autres trains un même ciel » nous emportent, afin que la fumée promise du souvenir s’alchimise sur des lignes poétiques révélatrices. Nous retrouvons ici le Livre de la mémoire écrit par Marilyne BERTONCINI, d’ouvrages en ouvrages, où se feuillette le topos vivant d’une voix humaniste si singulière, qu’elle résonne et vibre au-delà des complaisances aléatoires. Le leitmotiv qui ponctue le poème tel un refrain a été inspiré à la poète par l’écoute de Different Trains de Steve REICH (Grammy Award de la meilleure composition de musique classique contemporaine), musique mixte combinant documentaire, musique et vidéo, composée à New York en 1998, nouvelle œuvre commandée pour le Kronos Quartet. L’inspiration de cette pièce rejoint celle de Marilyne BERTONCINI en revenant à l’univers de l’enfance. Œuvre autobiographique et documentaire, Different Trains navigue entre les souvenirs de son auteur et les témoignages de survivants de la Shoah.
» Murmurations du souvenir« … un titre que renierait pas Pascal QUIGNARD, et qui nous ramènent à la thématique de l’absence thématique de ce numéro. Des rémanences ou réminiscences -évidentes ou souterrainement balbutiées, à l’œuvre dans les strates de notre mémoire portée par la langue verbale (puisque le souvenir, et même le plus silencieux, s’écrit bien sur une partition dont les notes sont toujours en possible résurgence) se lisent ici en filigrane des vers.
S’il n’est pas possible de citer tous les textes, tous apportent un regard singulier, tissant un fort réseau de correspondance, parmi lesquelles je vous invite à découvrir également les voix de Pascal MORA, Edouard PONS, François TEYSSANDIER et Dominique ZINENBERG, dans ce numéro offert aux abonnés et disponible sur le site de la revue.