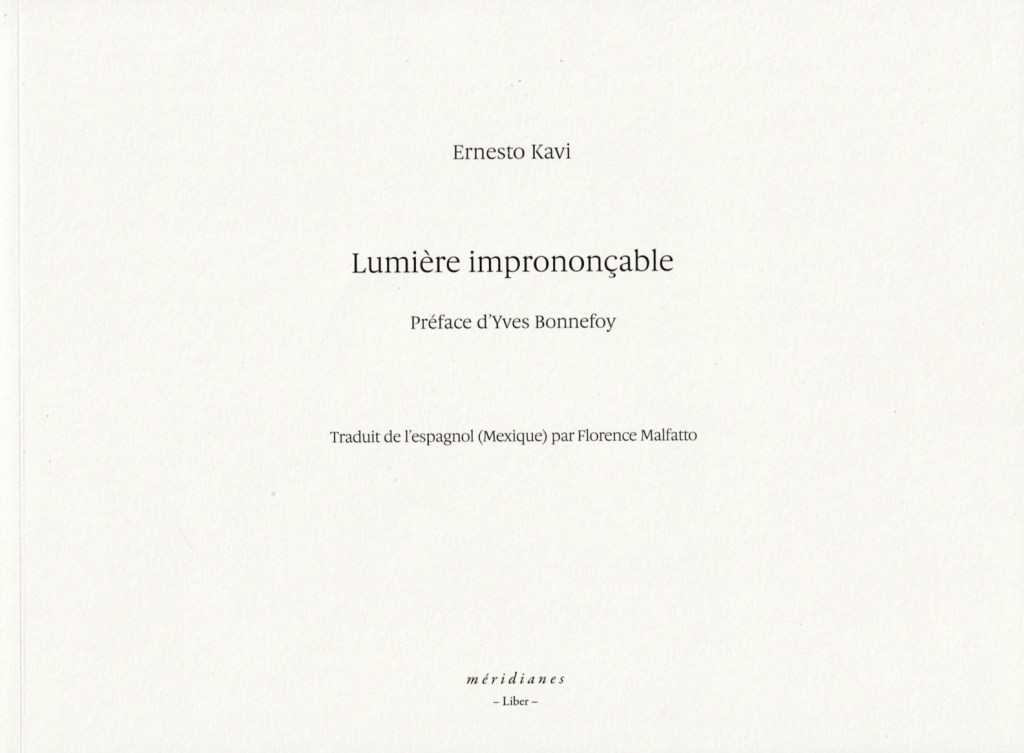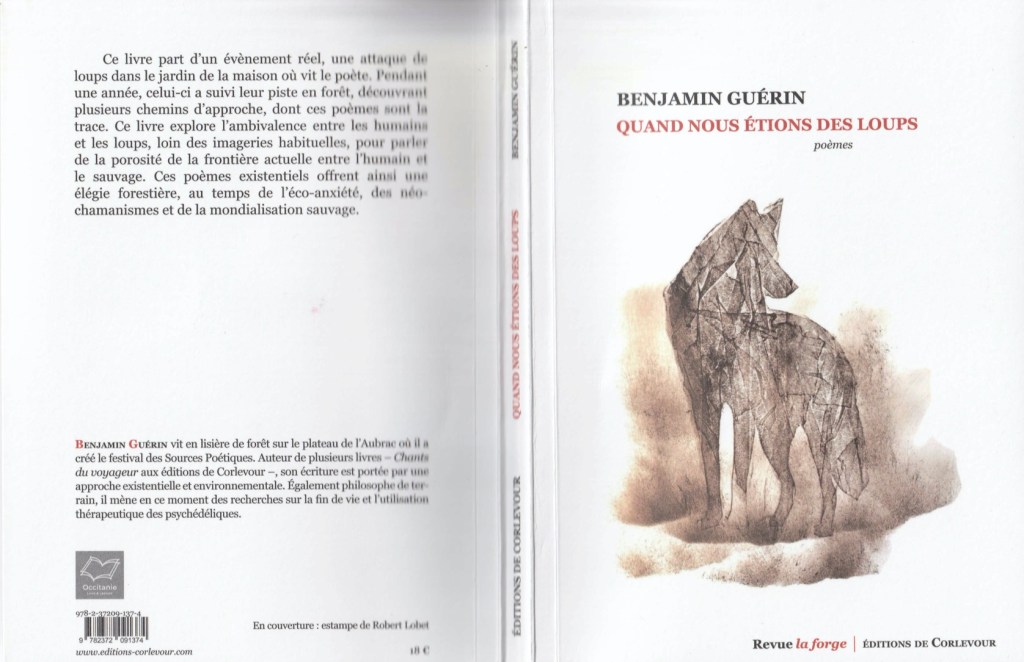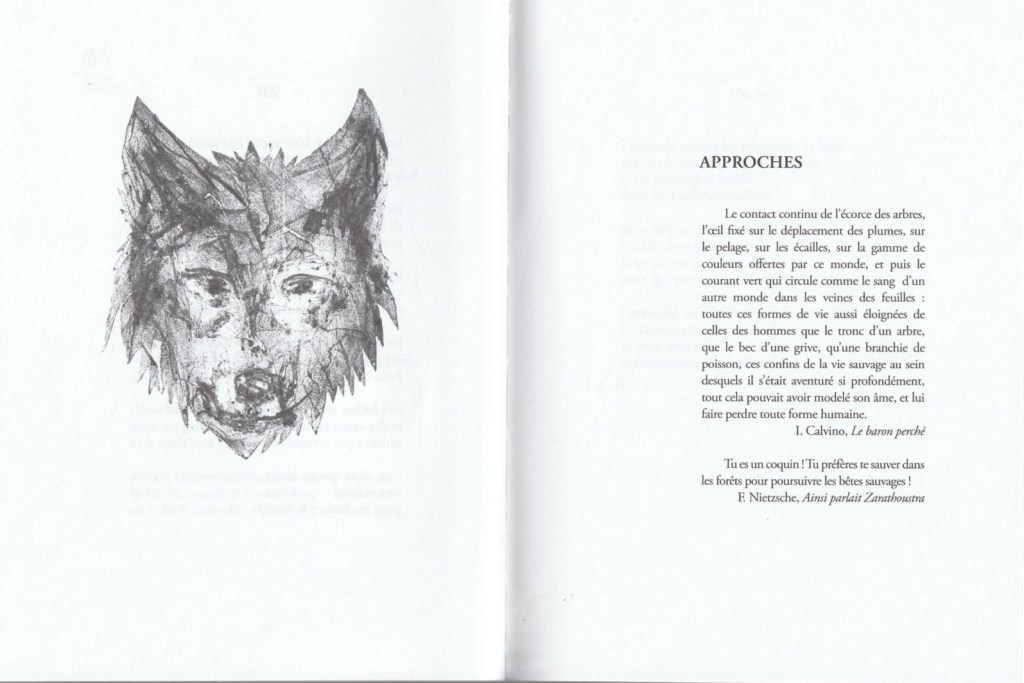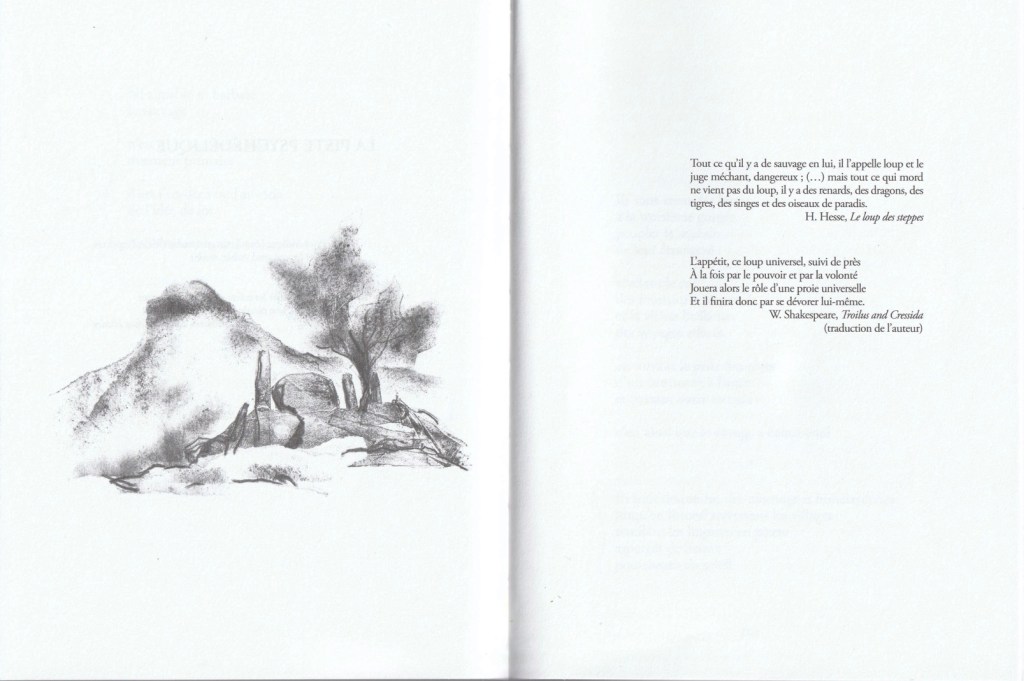Une chronique de Marc Wetzel
Béatrice PAILLER, D’un pas de luciole, Editions du Cygne, 58 pages, 2024, 12 €
C’est une poète : pour dire des canalisations d’hiver, qui, dehors, gèlent la nuit et dégèlent le jour, elle écrit : « Incisive sur la langue du matin l’eau sourit aux lèvres du zinc. Du rebord des gouttières, l’hiver rit de toutes ses dents : déchaussées à midi, rechaussées à minuit » (p.29). Pour évoquer la tonalité particulière d’un passé vécu : « Autrefois a goût de manque, petit fruit roulé à fond de gorge sous la langue, pour ne pas oublier la saveur de ce qui fut » (p.25). Pour décrire l’immense incendie énergétique déclenché, sur Terre, par l’activité surpeuplée et dévastatrice de l’homme, elle a ces mots : »Feu a pris monde, tombé des poches de l’homme, nourri de son orgueil » (p.23). Et même pour caractériser une notion aussi abstraite que le temps (l’infatigable et inéluctable successivité des existences), elle a l’image parfaite : « Le temps : une éternité de terre, mais à l’homme : sable où demain se dérobe » (p.18). Mais, malgré l’intensité sensible de ses notations sur la vie dans la nature, Béatrice Pailler pense aussi l’élan naturel même, elle médite (et fait méditer) la Vie propre et infinie de la Nature. Sa profondeur me rappelle les réflexions entendues du philosophe Marcel Conche (1922-2022) au temps de mes études : cette poète voit et sent, comme lui alors, que la Nature est comme une immense tapisserie de choses et d’événements (avec leurs motifs liés de proche en proche) dont la force ne faiblit pas; qu’elle est dispensatrice de leur espace et de leur temps pour tous les êtres ; qu’il n’y a pas de Principe de la Nature même, mais qu’elle est le seul Principe réel (puisqu’elle contient tout pouvoir de commencer et de commander), ou qu’il n’y a pas d’au-delà d’elle (car elle établit tout horizon, et englobe d’avance tout ce qui la limiterait). Mais elle, en poète, sait mieux que personne que, pour saisir véritablement la Nature, il faut aller jusqu’à écarter notre propre pensée ! Comme l’écrivait Conche, dans « Présence de la Nature » :
« Il appartient à la nature de la pensée de devoir se laisser elle-même de côté pour être à la mesure de ce qu’il y a, dans la Nature, à penser » (p.70).
Et, pareillement, voici les derniers mots de Béatrice Pailler dans ce recueil, où la Nature ne pense pas, n’est pas Idée, ne travaille qu’à son propre déploiement – mais, en définitive et partout : « rit » (de toutes ses formes !), est « Mère » (de toutes ses forces), et « joue » (de son propre fond).
« Temps joueur, tourne la roue. En elle la joie, en elle l’étreinte. Dans la cascade des saisons son rire de vent, d’eau, de ramures; son rire de mère, car demain sera l’humanité » (p.54)
Rouvrons le livre : cette promeneuse (de campagne) et jardinière (à ses heures, qui sont donc celles de la nature) est seule là où elle va – en tout cas, elle n’y rencontre personne – et, à force d’observer, de saisir les paysages et morceaux de monde à même leurs correspondances visibles, elle ne cesse, en effet, de « méditer » – en tout cas de se formuler à elle-même ce qu’elle discerne, de synthétiser ce qu’elle devine. Elle pense, mais à même les choses, le temps, les vents de jour et de nuit, les voix et lueurs de son pays (autour de Reims ?) – et, dernière surprise, elle pense sans concepts, sans références, sans recoupements instruits, comme si sa vive intelligence se voulait sans passé, et si sa culture se faisait devoir d’avancer muette, micro coupé, tout à l’écoute et à la disposition de ce qui, dans le monde qu’elle arpente, la dépasse. Cette sobre ascèse étonne, mais on comprend assez vite que le passé qui l’intéresse est celui des choses et organismes, et qu’elle parle et écrit pour le deviner (et, probablement, servir sa subsistance).
Ce sont, en effet, les clignotements du passé du monde que Béatrice Pailler nomme « lucioles » et sort rejoindre. La persistance du passé dans le présent (et donc dans l’avenir, fait seulement des présents qui ne sauraient tarder !) est à la fois son obsession, sa cible et son appui. (« Dans le pas du monde survivent les absents. Libres d’horizon, ils déambulent, nus du jour, vêtus du temps » p.41) Puisqu’aucun présent ne peut chasser l’autre sans devenir lui-même le passé et le rejoindre, le temps qui passe construit, consolide, complète et confirme, sans trêve et sans faute, le passé (voilà une intuition chez elle, semble-t-il, centrale). Comme disent les philosophes, puisque ce qui n’est plus ne peut pas ne pas avoir été, tout présent actuel est hanté par l’entrechevauchement indéfini de ses devanciers, et « ce qui fut fait signe, mais aujourd’hui l’ignore » (p.24), comme le relief des gorges oublie – mais marque ! – la lente scie des eaux qui les encaissèrent, ou la roche fossilifère s’ignore ancien sol enfoui, où y vaquaient les vies déposées et peu à peu englouties avec lui. Débris de gestes et de formes d’une vie naturelle qui dansent toujours là où ils sont, passé réel du monde dont le contact avec notre présent ne fait que continuer les rencontres et « étreintes » d’alors – et qu’il suffit alors à la poète de considérer, et transposer à nous, en demandant, par exemple : quel passé du monde serons-nous donc nous-mêmes, le jour venu ? Un fossile est conservé et souvent intact parce que le vivant qu’il relaye fut lui-même silencieux, ou assez issu du silence pour bien mûrir. Mais nous, dont le présent n’est que bruit, fureur et égarement, de quelle maturation sera donc capable, demain, notre effort révolu ? Notre indéfinie bougeotte, par contraste, se compactera peu quelque part, et nos révolutions permanentes rendront bien malaisée à la Nature sa généreuse (et désintéressée) tâche de nous y conserver !
Cette Nature, d’ailleurs, a-t-elle un maître ? Dans un récent entretien, Béatrice Pailler résume sa « poétique du monde » par deux mots : Création et Lumière, souhaitant, par sa poésie, « faire partager la lumière intrinsèque de la création« . Mais l’emploi du terme « création » ne signifie pas, ici, une origine divine de la Nature, mais veut plutôt souligner l’indépendance de cette Nature par rapport à son Créateur (car, comme le souligne le philosophe Gildas Richard, une « création » vient de rien (elle est ex nihilo), – alors qu’une fabrication vient d’une idée ou un engendrement d’une semence – : parler de « création » pour désigner la Nature, c’est donc la faire venir de rien, ou de rien d’autre qu’elle-même, et c’est donc soit constater que son créateur est absent (donc nous veut libres de lui !), soit que toute présence créatrice est discutable (donc facultative !). Ce qui, au contraire, est certain, selon Béatrice Pailler, c’est que la Nature est notre absolue Origine, donc notre divine source. C’est donc notre saccage de la Nature qui est blasphématoire, et non la divinisation de la Nature au détriment d’un Principe divin antérieur et extérieur à elle ! Et, lorsque la Nature, par nous agressée, reprend ses droits (comme en témoignent nos ruines), ou qu’elle « décide » de faire demi-tour lors de ses propres impasses évolutives, de se « ré-ensauvager » à loisir quand elle est allée trop loin ou qu’elle est fragilisée par ses sophistications, alors il faut s’incliner (comme le chêne devant le lierre qui l’enserre, ou le moment où le « rosier redevient églantier » – le passé de la nature, par principe majoritaire en elle, se rappelle alors, logiquement au bon souvenir de son présent – ). Deux très beaux passages, ici, p.44 :
« Le lierre enlumine les bosquets. Langue et salive sur écorce, il donne aux arbres sans printemps l’illusion de ses feuilles …« , et :
« Maquis de velours, d’épines, solitude trempée du soir, les allées s’épuisent. Dans l’ombre d’une lune tiède, les ronces guettent la fin d’un règne : le rosier redevient églantier. Ce qui fut a trop de vie pour ne jamais se taire. S’inverse, alors le chemin. Sous la couronne du désordre, la vie errante reprend terre« .
Ainsi la conscience écologique suit la liberté poétique comme son ombre ! Car, quel meilleur moyen de saisir ce que nous avons fait de la Nature (un mondial atelier-dépotoir), que, par le Verbe poétique, formuler ce que nous avons réellement voulu d’elle : à l’évidence, l’exploiter, la dresser et la rentabiliser. Et notre poète n’a besoin, elle, que de cinq mots pour, décisivement, le formuler. Les voici : Le Verbe est devenu « un trop frère du profit ! » (p. 49). Oui, le merveilleux verbe humain est devenu le cancer de l’harmonie naturelle. Pas alors de remèdes-miracles ici, mais le miracle d’une parole cherchant en elle son propre remède, avec patience, acuité et une infinie justesse. Trois courtes citations suffisent à en montrer la valeur : respectivement, sa caractérisation de l’élément serpentant de la vie (l’eau), le silence requis pour écarter les mâchoires de notre étau logico-verbal, et sa merveilleuse capacité à voir en tout présent l’effort qu’aura fait le passé sur lui-même (« la braise d’hier »). Étonnante, attachante et éclairante poète ! La vie, dit-elle, … « seule promesse tenue » !!! Oui, tenue dans ce recueil d’abord !
« L’eau, une enfance retrouvée qui aurait raison de la surdité du monde. Elle parle à tous les corps et son dialecte de terre, bruits de langue, soyeux, tels des serpents, est la seule promesse tenue, la seule vérié qui compte. De sève, de sang et de lait, de salive et de larmes; source, elle chante dans tous les corps. Son dire est le plus doux des baptêmes. Toujours, sur le temps qui n’a plus date, sa parole guérit » (p.8)
« Telles des saintes au tombeau, les pivoines embaument. Le jardin mouillé d’or moissonne le jour. La pluie investit les feuillages. S’étend le soir, saison fugace de silence où le temps ne saigne plus, gardant en lui ses heures » (p.43)
« Dans nos corps murmure un chant de lucioles, la braise d’hier : des souvenirs, telles des lueurs, réfutant l’absence : con forza y fuoco » (p.42)
©Marc Wetzel