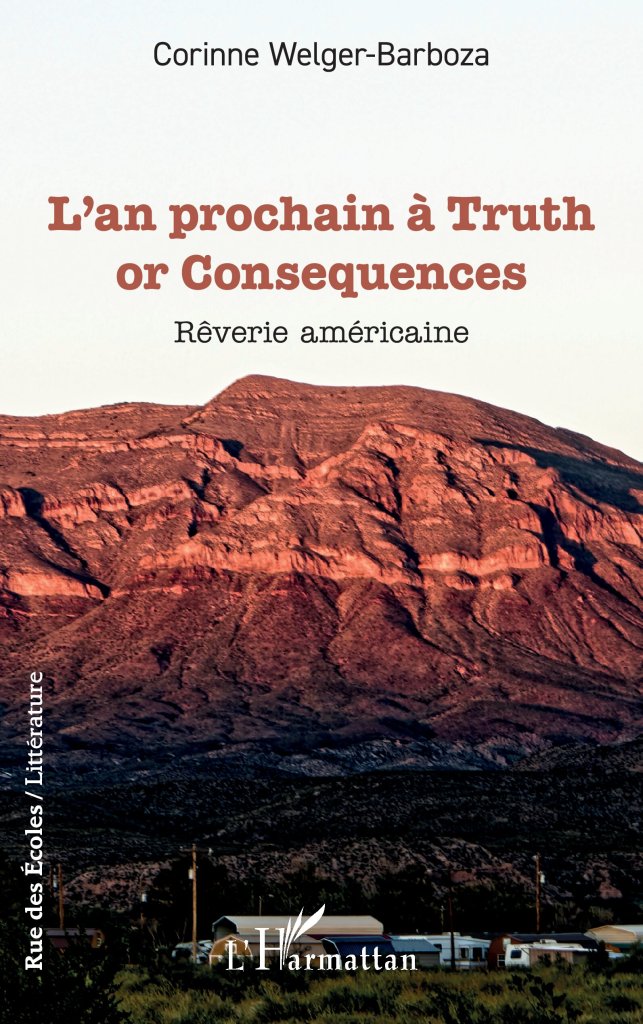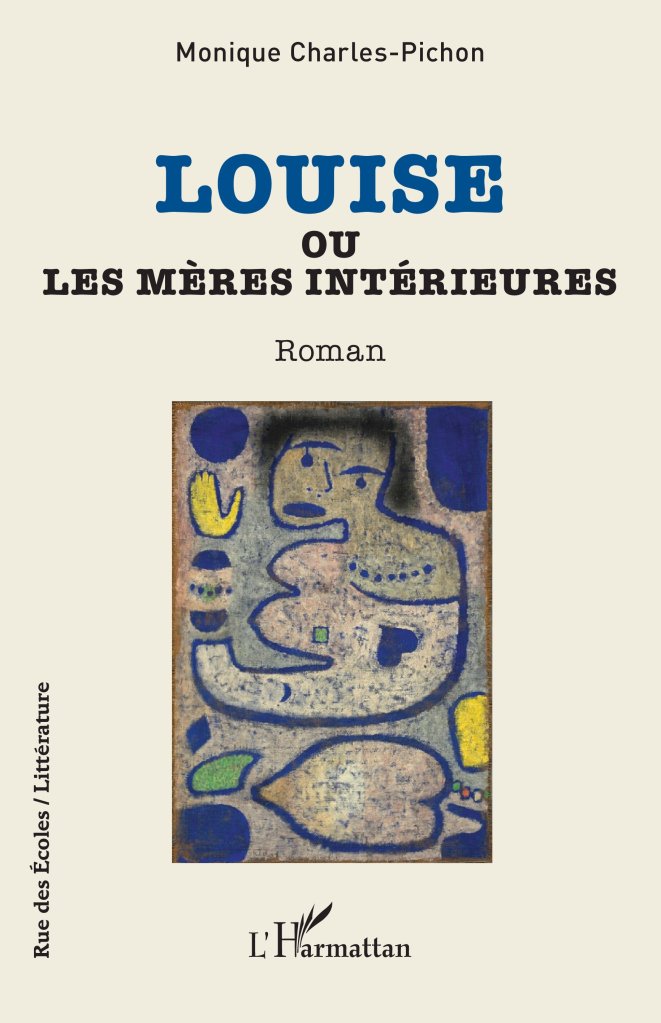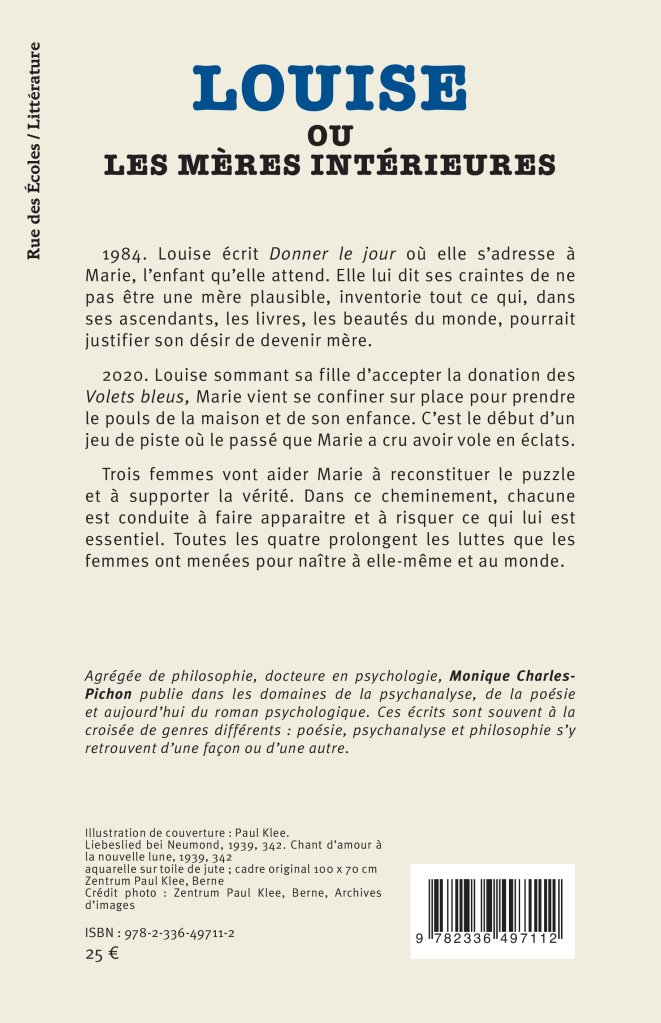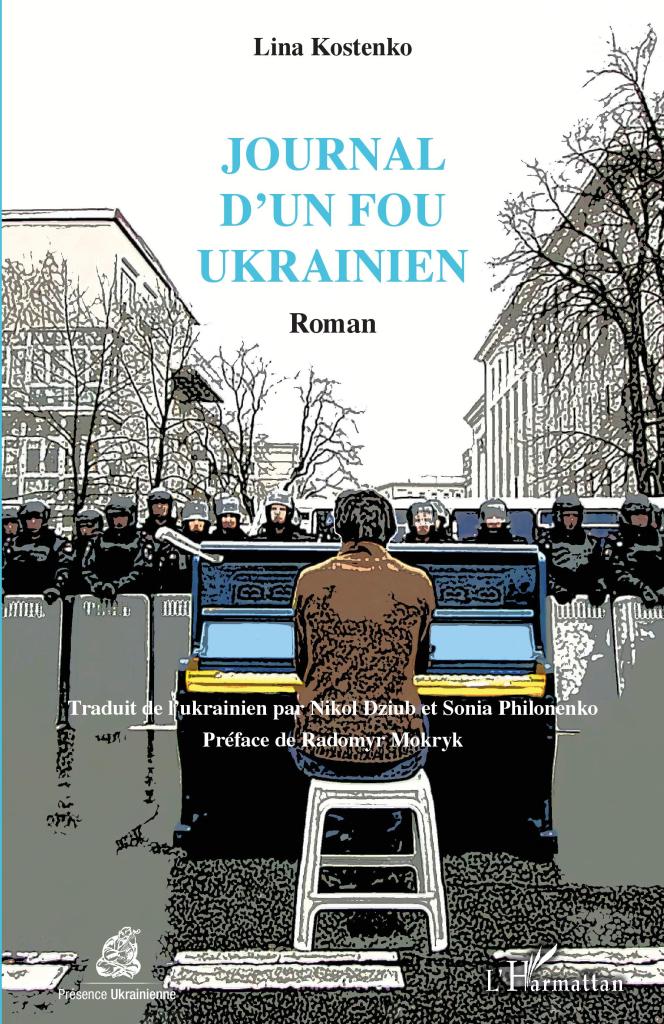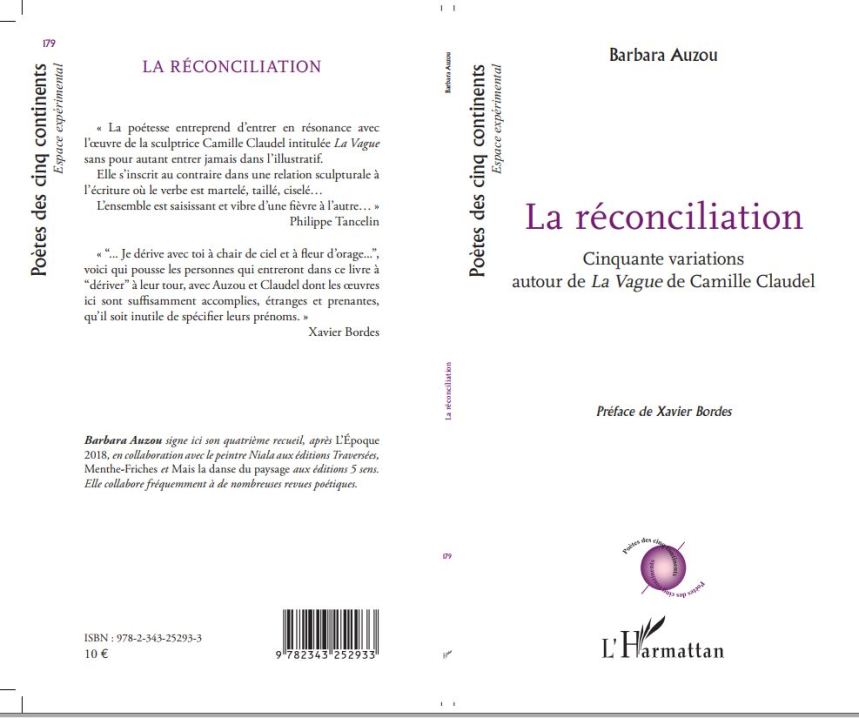Une chronique de Marie-Hélène Prouteau
Corinne Welger-Barboza, L’an prochain à Truth or Consequences, Rêverie américaine, L’Harmattan, 2025, 245 pages, 23€
La rêverie américaine de Corinne Welger-Barboza se présente comme un récit inclassable, à la fois autobiographique et onirique. Au cœur de celui-ci s’inscrit le rêve qui se vit en osmose avec Hellène, l’héroïne d’un début de roman stoppé net. Ceci n’est pas un roman, semble être suggéré comme dans le geste de Magritte. Car qu’est-ce qu’un roman dont le narrateur dit qu’il ne joue plus le jeu ? Le décès de l’amie de la narratrice Claude réoriente en effet le récit vers un « pacte autobiographique » – défini autour de l’identité entre la narratrice et la protagoniste, Corinne, en l’occurrence.
Ce récit de voyage dans une petite ville du Nouveau Mexique a quelque chose de singulier. D’une part le changement de nom de cette cité américaine, autrefois appelée joliment Hot Springs, à la suite d’une émission de radio tient du loufoque et du kitsch. De plus, tout en obéissant à une logique de référent rationnel, le récit est tout au long traversé par l’omniprésence fantomatique de l’amie morte, d’une intensité inhabituelle, et dans une moindre mesure par la présence du père et de la mère, les parents morts de la narratrice. Comme si le rêve éveillé traversait le réel de la narratrice. Le tragique chez Corinne Welger-Barboza n’est jamais solennel ; il lie légèreté et gravité.
Le récit de ce séjour à Truth or Consequences se présente en dix chapitres. Quelles sont les marques de cet itinéraire au Nouveau Mexique, une fois écartés le folklore télévisuel à paillettes et le western-rodéo rutilant ? Au fil des pages un espace géographique se dessine. Le Land Art, la grande beauté des paysages et du Rio Grande. Devant le désert, la narratrice confie un étrange sentiment-paysage : « je suis happée physiquement…par le pays physique, si j’ose dire. Je découvre un sentiment de plénitude qui m’est tellement étranger ».
Se voient ici convoqués de multiples références artistiques, l’artiste de Land Art Walter de Maria, le film « Le Sel de la terre », la « rétrospective Georgia O’Keeffe à Beaubourg », La Barque de Dante, le musée local Geronimo Springs Museum, les murals, l’art pueblo. Ces références viennent tracer les étincelles de l’exaltation artistique qui vibrent chez Corinne Welger-Barboza.
Les diverses rencontres de personnages croisés ici et là figurent ainsi les trois cultures, indienne, hispanique et américaine. L’impression de multiplicité tient à la polyphonie des diverses voix de Claude, l’amie, de Pierre – un amour inventé de la narratrice-, de son père et de sa mère. Cette dimension dialogique est ce qui frappe dans ce récit. Car cela renvoie aux interrogations qui traversent l’autrice sur son histoire personnelle, en premier lieu, son engagement féministe, revu avec un brin de nostalgie. Puis sa judéité et son refus d’appartenance à la communauté juive – réflexion déjà présente dans sa biographie familiale En déplacement. Elle prône ici la non affiliation : « de toute façon, ai-je jamais été partie prenante de « La communauté » ? Non jamais {…] en attendant une société d’étrangers fera l’affaire ». Cette perspective d’une société d’étrangers jetée à l’emporte-pièce ouvre plus de questions que de réponses.
Le titre du livre, pied de nez léger à la référence à une Jérusalem idéale, est porteur d’ironie. Terre promise, Truth or Consequence ? L’Amérique est-elle vraiment synonyme de cette « culture de la relance » que l’autrice évoque ici ? Pour qui en réalité ? On peut s’interroger. La visite au musée Geronimo où finalement la mémoire indienne semble pétrifiée et non entretenue de façon vivante semble le laisser penser. Plus loin, est évoquée la violence de l’Histoire des USA – non pas la question de l’esclavage mais la mémoire des Indiens, tout aussi violente. Et l’autrice d’évoquer les Chikasaw, la « terrible marche », la « déportation jusqu’en Oklahoma ». S’agissant des Native Americans, des premières nations et des droits bafoués des premiers habitants de l’Amérique, le mot « migration » semble faible ici. C’est d’ « expropriation », d’ « extermination », selon ses termes qu’il s’agit. Le péché originel de la Conquête de l’Ouest, de l’histoire « des vaincus ».
Pourquoi, se demande la narratrice, vouloir « s’installer » à Truth or Consequences ? Il y a eu assez de migrations dans sa famille juive depuis la Hongrie et l’Europe centrale. D’autant plus, reconnaît-elle, que « l’Italie, Rome plus précisément, occupait jusqu’à présent mon premier pays de cœur, celui où je rêvais de m’installer, au moment de me retirer ». Le Nouveau Mexique possède pour elle quelque chose qui est incontestablement de l’ordre du charme. Selon l’écrivain américain cité en exergue, Eugene Manlove Rhodes, nommé le « cow-boy chronicler », c’est « The Land of Enchantement ».
Au bout de son parcours la narratrice réévalue bien des choses. Grâce à Pierre, elle pourra peut-être se départir de cette fascination fantomale pour l’amie morte et d’autre façon, de son penchant à réécrire le passé. Et maniant l’humour, elle en vient à voir en ce rêve d’installation une sorte de « Floride des retraités pauvres ». Comme si le récit de ce non exil américain, jamais subi, véritablement choisi, lui permettait de s’affranchir de ses blessures et, finalement peut-être, de son passé.
Écoutons à ce sujet les mots de Toni Morrison, la grande écrivaine américaine, dans l’exergue à son roman Home. Des mots pleins de force poétique et porteurs d’universel :
« À qui est cette maison ?
À qui est la nuit qui écarte la lumière à l’intérieur ?
Dites, qui possède cette maison ?
Elle n’est pas à moi.
J’en rêvé une autre, plus douce, plus lumineuse,
Qui donnait sur des lacs traversés de bateaux peints,
Sur des champs vastes comme des bras ouverts
pour m’accueillir.
Cette maison est étrange.
Ses ombres mentent.
Dites, expliquez-moi, pourquoi sa serrure
correspond-elle à ma clef ? »