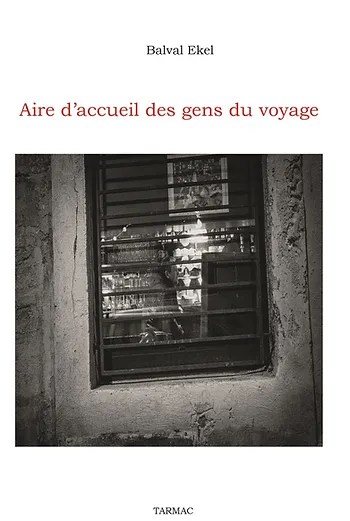Une chronique de Patryck Froissart
originellement parue sur le site de La cause Littéraire
Christine Hervé, Dernier émoi, Editions Traversées, juin 2023, 114 pages, 20 €

Réjouissons-nous ! La poésie, la vraie, la belle, la puissante, qui émeut, n’est pas morte. Les Éditions Traversées, comme, c’est fort heureux, quelques autres maisons indépendantes, nous la font vivre, nous la font lire, nous la font aimer. Les Editions Traversées sont wallonnes…
Les ouvrages publiés sont de beaux livres, d’élégante facture, visuellement attirants, tactilement agréables. C’est important. L’esthétique physique du volume incite à découvrir l’esthétique artistique de l’œuvre dont il est l’écrin. Les Editions Traversées ont le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’il faut remercier pour leur implication dans cette riche démarche culturelle.
A noter : Les Editions Traversées publient, à raison de trois numéros par an, une revue littéraire fort appréciée.
L’opus de Christine Hervé, le vingt-troisième, déjà, de la collection, est constitué de quatre corpus de longueur inégale :
Promesses de l’absence
Le plus long ensemble de textes du volume se présente sous la forme de segments de prose poétique, très courts, répartis un à un sur cinquante pages, centrés sur le thème obsédant de l’absence, ou plutôt sur celui de la présence obsessionnelle de l’absent.
De page en page, l’esprit, quasi fantomatique, de la délaissée rêvasse, erre tel un songe en action parmi les lieux, le passé, les objets familiers les plus triviaux, les traces, les souvenirs du fantôme de l’absent, qui revit par une succession de visions évocatrices dont la chère et douloureuse acuité est sobrement exprimée en versets, comme autant de flashes, et de flash-backs, brefs, concis, à quoi le caractère volontairement monocorde de l’expression confère paradoxalement une pesante et forte impressivité, dégageant la poignante atmosphère de mélancolie d’un quotidien qui reste continûment, physiquement, « réellement » partagé par le couple imaginaire, indissocié, que constituent toujours, par-delà la séparation, l’absent et sa partenaire.
On fait avec l’absent une drôle de paire on se vautre dans son vide on sent son impossible étreinte on entend ses paroles rassurantes ou tranchantes ange destructeur ou étoile filante dans le néant de nos voix.

Tourbière
Six poèmes de facture plus habituelle, compositions de distiques mettant en scène une femme marchant sous la pluie, dans le vent, vers l’océan, s’éloignant de la maison familiale, portant en elle le fruit d’une union qu’on devine méjugée, ou mal vécue, ou qui s’est mal terminée. Le personnage paraît animé par le désir de rompre avec ce qu’il laisse derrière lui. Le décor, triste, chagrin, froid, est en concordance avec l’action, le titre, « tourbière » donnant le ton. Ce qui est à venir, ce vers quoi elle va, s’exprime toutefois en opposition avec le présumé désastre du passé immédiat. Par-delà la brume ambiante, et en dépit de la tourbière qui pourrait embourber, la course se fait de plus en plus légère, et apparaît vers la mer régénératrice comme le halo d’un possible bonheur à retrouver :
Ce n’est pas la honte
qui la fait fuir
mais la croyance
d’une aube nouvelle
pour celui qu’elle porte
sainte d’innocence
d’amour perdu
en une nuit
forte d’espérance
Une ferme noire
Personnage principal : la fermière, qui apprend l’advenue d’un cancer. Personnages adjuvants :
le fermier, qui souffre et pleure en cachette de la souffrance de sa femme,
les vaches.
Les détails poético-actantiels s’enchaînent ici sous une forme différente, en paragraphes compacts, mais le procédé narratif est le même : des flashes, des moments pris sur le vif, des instantanés, courts, décisifs, qui, dans un autre genre, pourraient être développés en autant de chapitres d’un roman. La brièveté des termes du récit, le choix de la segmentation séquentielle créent ici encore une atmosphère lourde, saisissante, forçant l’empathie, le lecteur prenant toute sa part de l’angoisse qu’éprouve le couple, contrastant avec la placidité des vaches exprimée récurremment par ce propos constatif :
Les vaches au champ la regardent passer. Paisibles.
De nouveau le poème s’achève, résolument optimiste, sur le refus, le déni de ce qui semble pourtant inéluctable :
Pleine d’espoir. Des cloches dans la tête. Quand l’herbe verdira elle conduira de nouveau les vaches au champ, sous les aboiements des chiens.
Dernier émoi
Cette quatrième partie présente sur chacune de ses trente pages un poème minimaliste. L’expression, syncopée, fragmentée, faite de ruptures syntaxiques, d’ellipses, est devenue plus ésotérique, bien que le lecteur soit à même d’appréhender la thématique globale qui semble tourner autour de l’envol libératoire, de la fin légère de l’histoire, du but de la trajectoire poétique, du dénouement des histoires évoquées dans les parties précédentes, comme si l’auteure s’était débarrassée tout au cours de l’écriture du fardeau de ses propres angoisses en jetant précédemment sur le papier les mots exprimant celles de ses personnages. Le personnage, se fondant en ceux des trois premières parties, en effet, est alors la narratrice elle-même, alias l’auteure. Fin du discours plus ou moins narratif. Les phrases tronquées, les syntagmes isolés, les mots solitaires s’envolent et se dispersent en un souffle final, en un « dernier émoi ».
Personnage
de ta propre histoire
jamais écrite
et qui peine à vivre
[…]
Je lance mes mots
au ciel
ils retombent
en pluie d’or
Christine Hervé nous offre un ouvrage original dans la forme et le fond, dont la force est idéalement propre à provoquer chez le lecteur l’émotion poétique.
Née en Bretagne, Christine Hervé quitte dès l’enfance ses côtes de granit pour la Méditerranée. Elle enseigne le français et l’anglais en France et à l’étranger : USA, Gabon. Elle commence par écrire des histoires pour enfants, puis se dirige vers la poésie contemporaine.
© Patryck Froissart
Patryck Froissart, originaire du Borinage, a enseigné les Lettres dans le Nord de la France, dans le Cantal, dans l’Aude, au Maroc, à La Réunion, à Mayotte, avant de devenir Inspecteur, puis proviseur à La Réunion et à Maurice, et d’effectuer des missions de direction et de formation au Cameroun, en Oman, en Mauritanie, au Rwanda, en Côte d’Ivoire.
Il a publié plusieurs recueils de poésie et de nouvelles, dont certains ont été primés, un roman et une réédition commentée des fables de La Fontaine, tous désormais indisponibles suite à la faillite de sa maison d’édition. Seuls les ouvrages suivants, publiés par d’autres éditeurs, restent en vente :
- Le dromadaire et la salangane, recueil de tankas (Ed. franco-canadiennes du tanka francophone)
- Li Ann ou Le tropique des Chimères, roman (Editions Maurice Nadeau)
- L’Arnitoile, poésie (Sinope Editions)