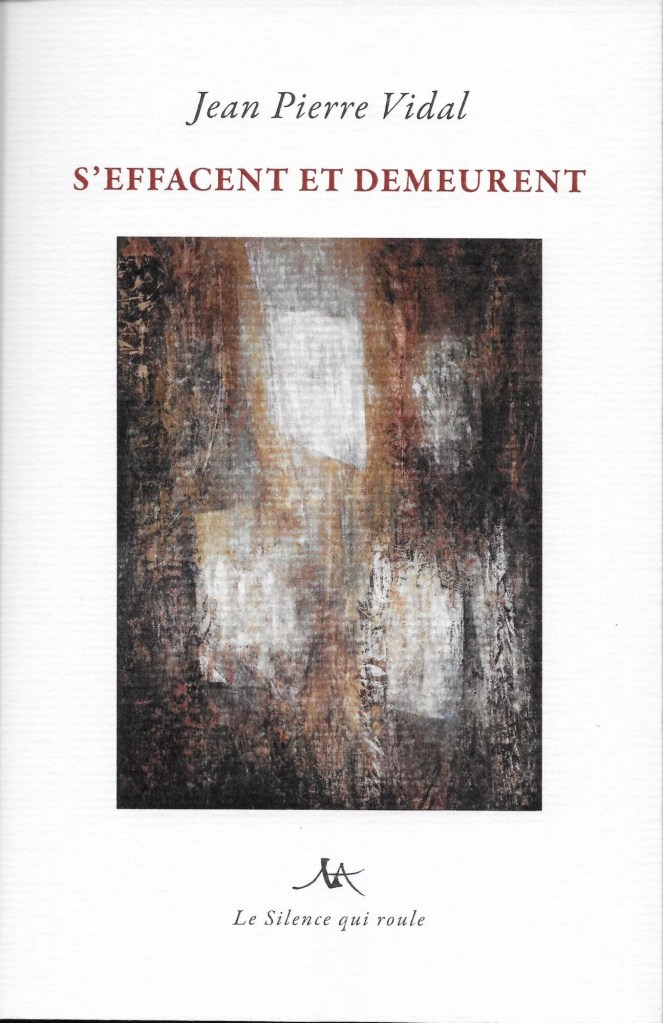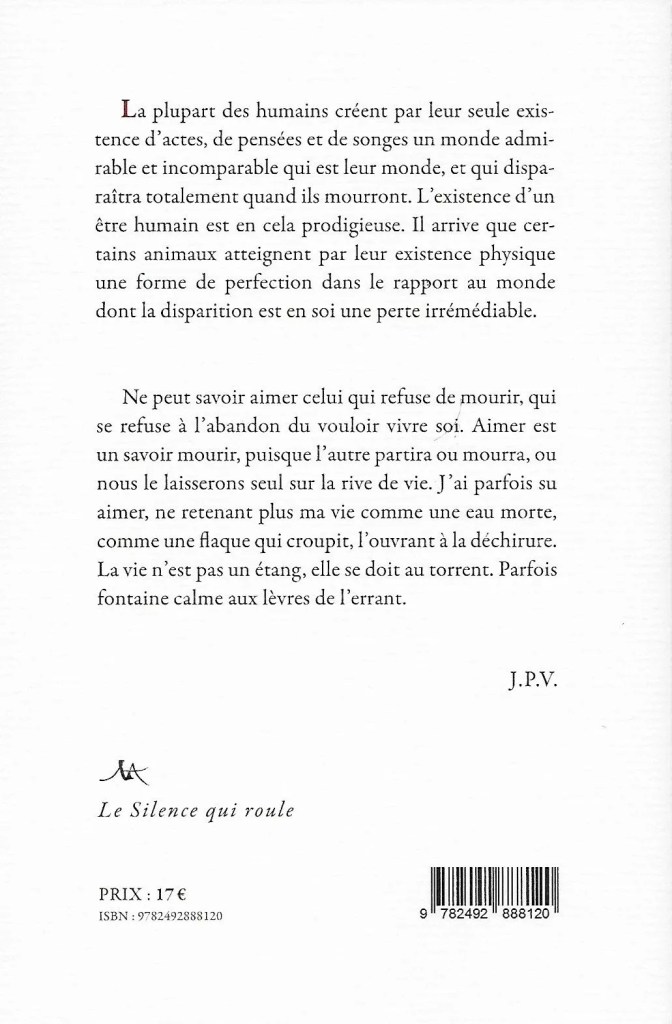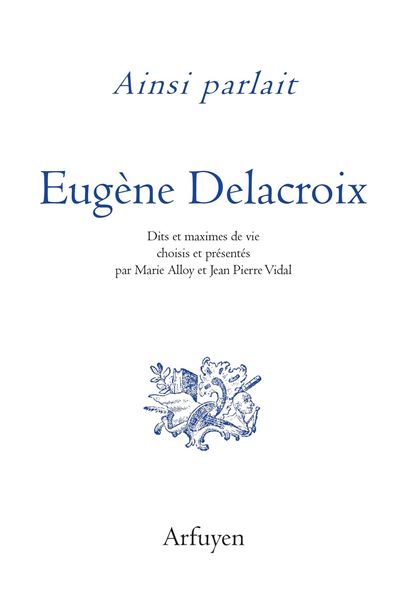Une chronique de Marie-Hélène Prouteau
Marie Alloy, Jean Pierre Vidal, Ainsi parlait Eugène Delacroix, « Dits et maximes de vie », Éditions Arfuyen, 170p, 14€, octobre 2023.
Heureuse et stimulante initiative que la publication de ce florilège, « Dits et maximes de vie » d’Eugène Delacroix que nous présentent Marie Alloy et Jean Pierre Vidal, dans la collection « Ainsi parlait » des éditions Arfuyen.
Eugène Delacroix est un des plus grands artistes français du XIXe siècle, à la création artistique riche et multiple. Figure de la génération romantique des années 1820, il incarne puissamment par ses succès teintés de scandale le renouveau de la peinture. Il est aussi un artiste qui, toute sa vie, a pratiqué l’écriture. N’a-t-il pas rêvé dans sa jeunesse d’être écrivain ? On a d’ailleurs récemment exhumé de courtes nouvelles de sa composition. Le « peintre-poète », comme l’appelait Baudelaire, est de ces artistes dont le génie offre de multiples facettes. Marie Alloy et Jean Pierre Vidal nous proposent ici une approche particulière de Delacroix, écrivent-ils, à travers la sélection de maximes, [qui]veulent rendre compte de la vision du monde et de l’homme qu’il s’est forgée au cours de ses 65 années de son existence ». Ce choix implique une orientation, une sélection dont il faut mesurer, derrière le résultat final si maîtrisé, le travail imposant et l’extrême sensibilité aux profondeurs de ce grand esprit. C’est en effet un Delacroix, analyste moral d’une grande acuité, qu’ils donnent à découvrir au lecteur dans cette somme de 420 fragments qui ont l’avantage de fixer la pensée et nous font accéder à la grandeur, impersonnelle souvent, de sa méditation.
Le matériau ne manque pas. Entre le Journal, les lettres aux amis, les écrits sur l’art, notamment des articles dans La Revue des Deux-Mondes, sources surabondantes, l’on découvre que Delacroix s’astreint quotidiennement à l’écriture. Nulla dies sine linea, pourrait être sa devise fervente. L’introduction réalisée par les deux auteurs remet bien en perspective sa vision tragique du monde, ses relations à Baudelaire, à son amie George Sand, sa relation éminemment complexe au romantisme et à ses représentants.
L’ouvrage permet ainsi de comprendre comment la dualité est au cœur de cet homme et de cet artiste si peu commun. Delacroix, tout à la fois, le peintre de la violence et la brutalité splendides et le plus courtois des mondains. Le républicain et le romantique, peignant La Liberté guidant le Peuple mais fustigeant les « désordres » des barricades (101), qui, lors de l’enterrement du général Lamarque, inspireront à Hugo le moment emblématique des Misérables. Comment ce romantique, en prise avec son siècle sans jamais, cependant, être militant, se double-t-il d’un héritier des moralistes classiques et des Lumières ? Il y a des contradictions exposées ici qui sont savoureuses, tant elles se chargent de densité et de complexité des idées. C’est ainsi que Delacroix apparaît critique vis-à-vis de l’emphase romantique : « Le romantisme chez Lamartine, et en général chez les modernes, est une livrée qu’ils endossent » (238).
Le lecteur passionné qu’est Delacroix, lisant les modernes Goethe, Byron, Poe qui inspirent parfois sa peinture, n’en est pas moins féru de tradition classique, y puisant le goût des formes fragmentaires, essais, maximes, pensées qu’il trouve chez Marc-Aurèle (143), Montaigne (125 et son éloge du mouvant), Pascal (377), Saint-Simon (373). Jusque dans les termes qu’il utilise, les « misères », « l’amour-propre », « l’esprit ferme », les « malins penchants », Delacroix semble imprégné de la grande pensée classique. Ainsi en est-il lorsqu’il livre son pessimisme devant le progrès de ce 19è au matérialisme triomphant, tant critiqué par les écrivains et les artistes romantiques – songeons à l’ironie de Stendhal, à l’époque, escomptant quelques lecteurs, happy few, vers 1880. « L’homme fait des progrès en tous sens : il commande à la matière, c’est incontestable, mais il n’apprend pas à se commander soi-même » (250). Vieil idéal de sagesse antique de « maîtrise » de soi, quand le monde s’écroule et va en désordre.
Nous suivons Delacroix dans le questionnement d’une pensée complexe, vivante qui met en mouvement quelques grandes catégories existentielles, la vie, l’amitié, la création, la mort, l’amour. « Tous les hommes ont besoin d’être distraits et veulent l’être continuellement […] Ce sont des prisonniers qui charment les heures de la prison par les imaginations d’un état qui les met hors de l’état présent, c’est-à-dire qui les arrache à la contemplation de soi-même » (361). Cette page du Journal, écrite dans une tonalité pascalienne, est fort éclairante sur le scepticisme tragique du monde qui est le sien et l’ambiguïté de l’imagination à ses yeux. Négative, ici, pour l’homme ordinaire, dans son usage de « divertissement », l’imagination est aussi pour Delacroix la faculté essentielle à la création, notamment en peinture.
Delacroix revient à plusieurs reprises dans sa correspondance sur ce qu’il nomme « le commerce des lettres » (9), la causerie avec ses amis, souvent des amis d’enfance. Cela participe de ce qu’il appelle « la vie de l’esprit » (111), tant dans l’écriture à l’ami ou dans celle à visée interne du Journal. Delacroix se pose des questions sur ce qu’il a ressenti, vu, lu. La peinture n’a pas cette vertu de questionnement intérieur. Ces pensées et maximes, idéal de mise en ordre qui jugule ce qui échappe, s’opposent à la saillie baroque de la peinture.
La scansion du temps traverse ces dits et maximes, sélectionnés par Marie Alloy et Jean Pierre Vidal depuis le Delacroix âgé de 17 ans en 1815 jusqu’à ses 64 ans, l’année de sa mort. Et le mérite de ces auteurs est de nous donner à saisir une telle approche transversale, quasi synchrone que la simple lecture du Journal ou de la Correspondance ne permet pas. Les variations, les contradictions se laissent percevoir – ainsi en est-il des éloges mondains et de sa « gloire » que Delacroix célèbre dans le fragment 60, daté de 1824, tandis qu’en 1860, il aspire à son exact contraire : « Je vis seul à Paris comme si j’étais au fond de la Sibérie ; je ne vois personne ; ni soirée, ni dîners, ni visites » (406).
On le voit s’enchanter à Tanger, lors de son voyage en 1832, de la lumière, de la beauté : « C’est un lieu tout pour les peintres […] le beau y abonde » » (93). Dans un renversement caractéristique des Lumières sur qui est le vrai barbare, toujours plein de sa curiosité insatiable, il écrit, visant ceux qui manifestent alors à Paris : « Allez en Barbarie apprendre la patience et la philosophie » (100).
D’une manière générale, Delacroix aborde sa réflexion sur l’art davantage du point de vue de l’expérience intérieure que du point de vue de l’esthéticien qu’il n’est pas vraiment. « C’est ce terrible l’art qui est la cause de toutes nos souffrances », écrit-il à son amie George Sand en 1851, (209). Il revient souvent dans ses lettres sur cette comparaison entre les arts (28), peinture, littérature et musique – on sait son lien à Chopin : « La peinture, c’est la vie […] La musique est vague. La poésie est vague. La sculpture veut la convention. Mais la peinture, surtout en paysage, est la chose même », écrit-il à un ami. Pour Delacroix, l’artiste se distingue par une singulière et extrême sensibilité qui est à la fois sa force et son fardeau car cela le rend vulnérable, « le plus ordinairement persécuté » (191) par ceux qui l’envient et le jugent.
Le grand mérite de cet ouvrage est de mettre en lumière, dans ses vérités multiples et ambivalentes, la polyphonie intérieure propre à ce grand artiste qu’est Delacroix. Il faut saluer, dans ce qui s’apparente à un art de lire, l’empathie remarquablement pénétrante du regard de la peintre Marie Alloy, poète elle-même et de l’écrivain proche des peintres, Jean Pierre Vidal.
©Marie-Hélène Prouteau