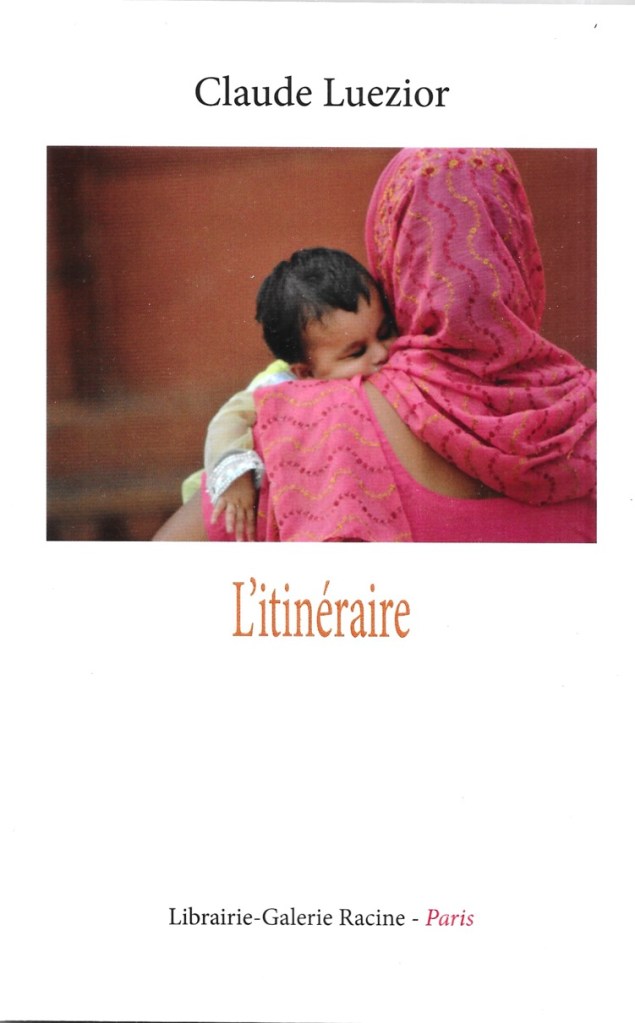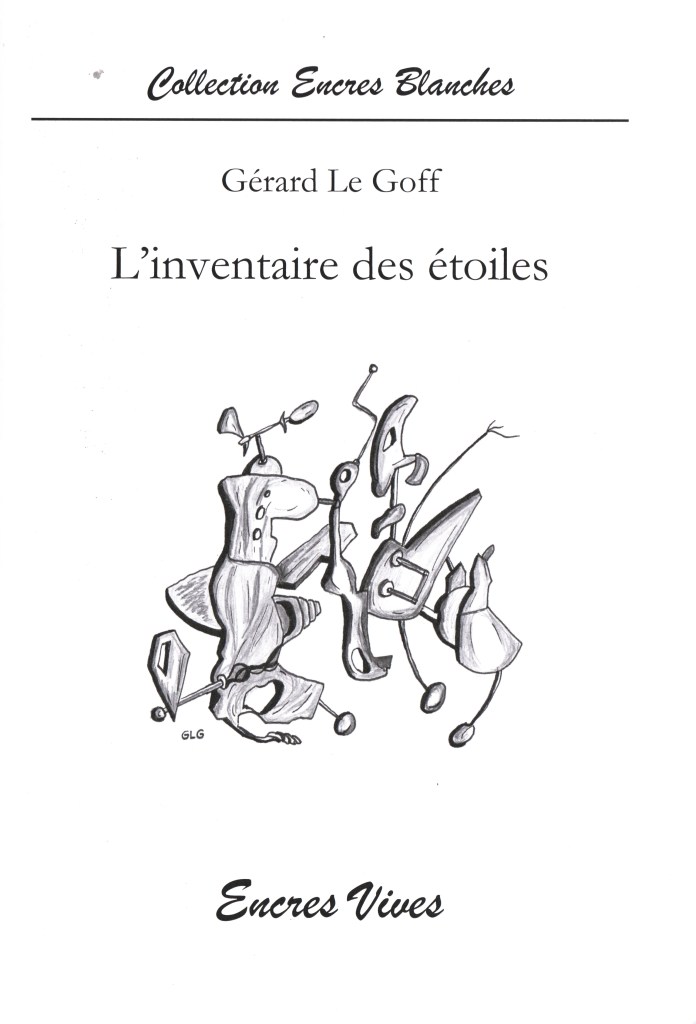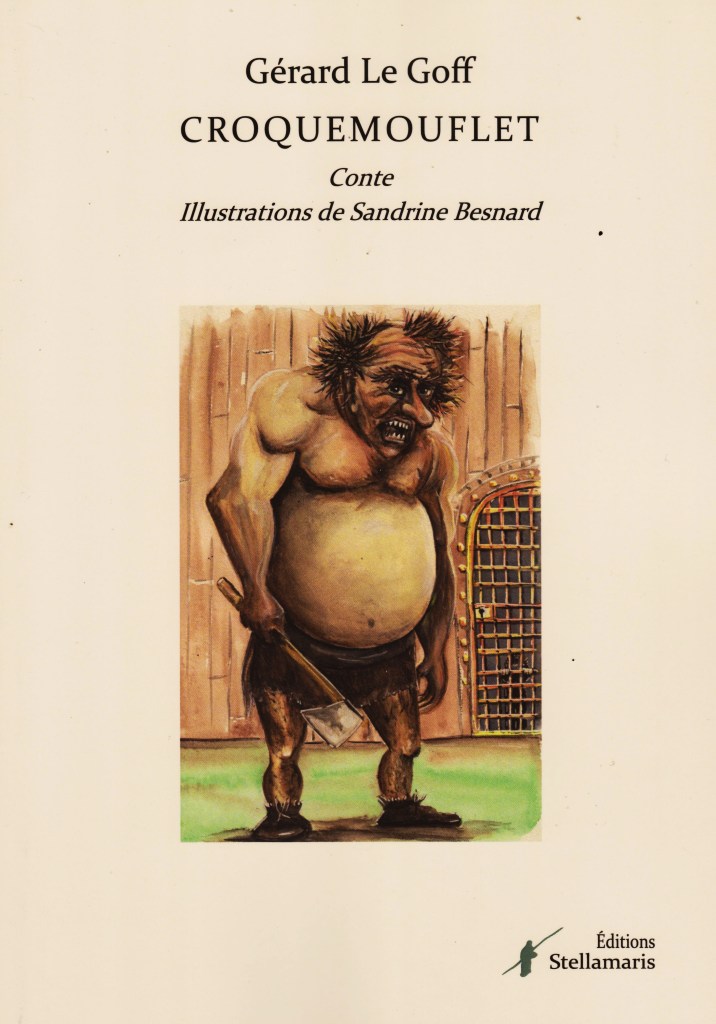Une lecture de Sonia Elvireanu
La marée du siècle, Gérard le Goff, MVO Éditions, Livres blancs, 2025, 302 pages, 20 euros.
______________________________________________________________________________
Poète et romancier français contemporain, Gérard le Goff exerce sa plume aussi bien en poésie qu’en prose. À peine a-t-il publié le recueil de poèmes Aires de vent où prennent place de petits textes en prose poétique (Encres vives, 2024) qu’il fait paraître son troisième roman, La marée du siècle, après Argam et La raison des absents, différents quant à leur trame et leur structure. Si Argam peut être placé du côté du réalisme magique, les deux autres s’apparentent en raison de leur vision réaliste et de leur noyau autofictionnel.
La marée du siècle évoque avant tout la beauté naturelle et le patrimoine architectural de la côte nord de la Bretagne, l’espace où vit aujourd’hui l’auteur, né au sud de la France. Est-ce un hommage rendu à cet espace adoptif, différent de celui natal ou tout simplement le besoin de matérialiser une région splendide de son pays, de satisfaire son goût de décrire ? Ou peut-être les deux. Dans le cadre d’un projet piloté par la maison d’édition Duval-Mongeraud et destiné à promouvoir le tourisme dans cette région, le littoral de la Manche va se voir au fil des pages exploré en profondeur et illustré par le personnage principal, à la fois peintre et photographe ; se succèdent : collier de villes et de stations balnéaires, falaises, plages de sable, baies et rochers, ports de pêche ainsi que de nombreux endroits historiques et légendaires.
Le roman doit son titre au flux exceptionnel qui se produit sur la côte bretonne tous les 18 ans, selon les scientifiques. Ce phénomène est appelé « marée du siècle » en raison de son amplitude, qui est souvent comparée à un mini tsunami au vu de la hauteur et de la violence de ses vagues, ainsi que par les dégâts causés. Il a pu être observé en 2015 à Saint-Malo, précise la presse française. Il semble vraisemblable que l’auteur y fasse allusion dans une de ses descriptions : d’immenses vagues en cavalcade frappent violemment la plage et atteignent les étages du casino, s’engouffrent dans les rues et déferlent en cascades sur les trottoirs, noyant les voitures garées. La « marée du siècle » anime la côte bretonne et attire, hors saison, une foule inhabituelle de touristes venus voir ce prodige de leurs propres yeux.
La trame du roman tourne autour de la fugue inopinée et inexplicable de la femme d’un peintre, Léonard Hauteville, alors que rien ne pouvait augurer un tel drame dans l’existence de ce couple heureux. Léonard et Hélène vivaient jusqu’à présent dans une complicité sans faille.
Une bonne partie du roman s’attarde sur la solitude du peintre hanté par la disparition de sa femme aimée et le vide ressenti en son absence. Il ne cesse de la revoir mentalement, de revivre le commencement de leur histoire, leurs gestes familiers, leur vie conjugale. Tourmenté par des insomnies, des interrogations sans réponse, par la monotonie de la vie quotidienne, sans aucun espoir de la retrouver même en faisant appel à la police, le peintre imagine peindre une série de portraits d’Hélène d’après des photos qu’il a prises d’elle par le passé.
| Portrait de Marie par l’auteur (huile sur toile) |
La première partie du roman suit le rythme lent de la mélancolie qui ronge l’âme du solitaire. Puis le récit s’anime grâce au projet auquel le peintre est invité à collaborer : réaliser des aquarelles pour un livre de promotion du tourisme. L’éditeur lui offre un séjour gratuit d’un mois sur la Côte de Jade, appelée ainsi en raison de la couleur de la mer qui la baigne. C’est l’occasion de flâneries dans les stations situées sur la côte de la Manche pour prendre des photos afin de peindre, dès son retour à son atelier, les aquarelles commandées. Ces promenades, au cours desquelles il traverse des sites naturels, des paysages rares et variés, des villages pittoresques, des forteresses médiévales, des ports de pêche, l’entraînent à échanger avec divers personnages, souvent décalés, qu’il croise sur son chemin. Ce sont autant d’expériences qui lui permettent de se découvrir lui-même et les autres. La rencontre fortuite, dans l’hôtel où il réside, avec l’écrivain à succès Julien Passager et son amie Louise Favre, une femme elle aussi abandonnée par son mari, s’avère importante pour Léonard Hauteville. L’écrivain suggère au peintre et à sa propre amie une méthode empruntée à un film policier pour retrouver les traces de leur conjoint disparu. Louise va appliquer les consignes de Julien et obtenir des résultats. Par l’intermédiaire d’un détective privé, Hélène Hauteville et le mari de Louise sont rapidement localisés à Paris.
La partie finale du roman est la plus dynamique. Le statut social du peintre change du tout au tout grâce au succès fulgurant qu’il rencontre avec une exposition où sont proposés au public les portraits de sa femme. Pour la présentation de l’événement, on sollicite Julien Passager. Le peintre et l’écrivain sont amenés à collaborer et s’entendent à merveille. La soudaine célébrité de Léonard contribuera beaucoup au retour de la disparue. Par ailleurs, les aquarelles réalisées sur la Côte de Jade sont également très appréciées par l’éditeur Duval-Mongeraud, qui compte en inclure dans un second livre.
Le roman permet à l’auteur de satisfaire son goût de peindre la réalité par les mots, tout comme le fait le peintre par le dessin et la couleur. Il décrit minutieusement lieux sauvages, gens, maisons, plages, paysages, hôtels, intérieurs, soirées conviviales, villages, mégalithes, saints bretons, forteresses médiévales et églises. Il nous laisse deviner son plaisir à observer, goûter, sentir, savourer, à prendre son temps devant un café ou un bon repas, servis dans un restaurant de ville ou une auberge de campagne. Il sait créer l’ambiance, l’atmosphère, le mouvement, rendre vifs les menus gestes et conversations des personnages. Le lecteur découvre aussi sa passion pour l’histoire.
Pour construire deux de ses personnages, le peintre et l’écrivain, l’auteur n’hésite pas à leur emprunter certains éléments de sa propre biographie. Ainsi, le narrateur fait des intrusions dans le passé du peintre pour retracer le portrait d’un homme timide, solitaire, anticonformiste, porté sur la lecture et la rêverie, tel le personnage du roman La raison des absents. Dans la figure de l’écrivain, il se plagie un peu lui-même pour évoquer son parcours littéraire, jusqu’à citer le titre de son roman, Argam. Ses personnages masculins sont crayonnés d’après les deux hypostases de l’auteur, peintre et écrivain, dans sa vie quotidienne.
Le rythme du récit semble suivre un tempo musical : andante, allegretto, allegro. La narration est lente au début, puis s’anime avec le séjour du personnage sur la Côte de Jade, pour devenir très vif vers la fin. Dans chaque chapitre, le récit inclut de brefs textes en italiques de nature différente : réflexions, souvenirs, évocations de lieux, interrogations, rêveries. On imagine les bribes d’un journal poétique, qui dévoile le côté évanescent du personnage, son penchant pour le mystère. Est-ce le poète Gérard le Goff qui se glisse ainsi dans son propre texte ? De toute façon, cela tient à la structure du roman et lui donne une touche d’irréel et de beauté, suggérant au lecteur la double nature de l’être humain, le côté incompris et rêveur de lui-même.