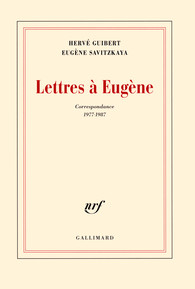-
Hervé Guibert / Eugène Savitzkaya, Lettres à Eugène, Correspondance, 1977-1987, nrf, Gallimard (15,90€ – 129 pages)
La correspondance dévoilée entre Hervé Guibert et celui qu’il a élu : le belge Eugène Savitzakaya, couvre une décennie. Elle débuta en 1977 avec la parution, à 22 ans, de leur premier roman respectif. Ces lettres mêlent confidences, épanchements, délires, supplications, conseils bienveillants, projets communs (Villa Médicis), déboires, ainsi que des réflexions sur leur écriture. Écriture sensuelle, tendue par le désir.
Comme Christophe Carlier le démontre dans son roman (1) : « les lettres nous informent moins sur la psychologie de leur auteur que sur celle de leur destinataire ».
Il ajoute que « C’est toujours en fonction de celui-ci qu’elles sont composées, le rédacteur jouant simplement le rôle du miroir déformant ».
Ce recueil nous offre donc les portraits croisés des deux auteurs qui s’apprivoisent, tissent des liens littéraires, puis plus intimes. On devine leur abandon physique : « Je sens encore ta langue » lors d’un séjour sur l’île d’Elbe. L’amitié n’instaurant pas la symétrie, la fréquence de leurs échanges est inégale. D’où les nombreuses remarques d’Hervé, souffrant d’une carence de nouvelles de la part d’Eugène. Ses missives se font plus enflammées après leurs rencontres. Certaines sont de vraies déclarations : « Je t’aime ». Hervé ne cache son aimantation mais est en proie à des interrogations, craignant d’insupporter Eugène par sa prolixité et sa passion « déraisonnable ».
Hervé, envahissant, estampille Eugène de nombreux termes : depuis « Bufo, Mon cœur infernal, Ma merveille, mon gueux ». Quant à Eugène, plus discret, « retors », il se qualifie de « pauvre protégé » et voit en Hervé « le plus gentil des garçons ».
Quant à Eugène, il n’est pas indifférent mais garde une certaine froideur et distance.
Toutefois, il répondra à sa demande de photos, parfois à ses injonctions. Il se montre préoccupé quand la santé d’Hervé montre des défaillances. Une infinie et profonde tendresse les réunit. Hervé Guibert évoque en filigrane cette maladie qui le ronge, consignant ce mal « invivable », sa souffrance physique dans son journal (Lemausolée des amants) qui fut publié de façon posthume en 2001.
Quand il devine Hervé dans une phase de bourdons, il n’hésite à l’inviter à Liège.
Les cadeaux échangés (oursons, médaille) n’arborent pas la même valeur pour eux. Pour Hervé, tout ce qui lui vient d’Eugène devient sacré comme des reliques.
Quant à Eugène, il conserve précieusement « une carte purgative », qui agit comme un baume au cœur quand il est triste.
Leurs liens professionnels leur permettent de cultiver leur amitié, Hervé Guibert faisant publier par épisodes, les textes d’Eugène dans L’autre journal. Mais leurs relations vont être assombries à la cessation de cette aventure éditoriale. D’où la lettre de contrition d’Hervé, endossant la responsabilité de l’avoir « fourgué dans ce pétrin » et renouvelant son admiration « pour la beauté de son écriture ».
Leurs lettres convoquent également des connaissances communes, comme le photographe Bernard Fauchon ou le poète Izoard et déclinent tous les titres de leurs publications. C’est alors que la portée prophétique et testamentaire de La mort propagande saute aux yeux. Hervé Guibert ne voyait-il pas « tout noir ou presque noir » ? N’écrivait-il pas pour résister à au silence et à l’oubli ?
Si la mort met fin à leurs liens, Eugène Savitzakaya ressuscite son frère d’écriture et lui rend hommage par ce touchant mausolée de papier établi conjointement avec Christine Guibert. La littérature plus forte que la mort.
(1) : L’assassin à la pomme verte de Christophe Carlier (éditions Serge Safran).
© Nadine Doyen