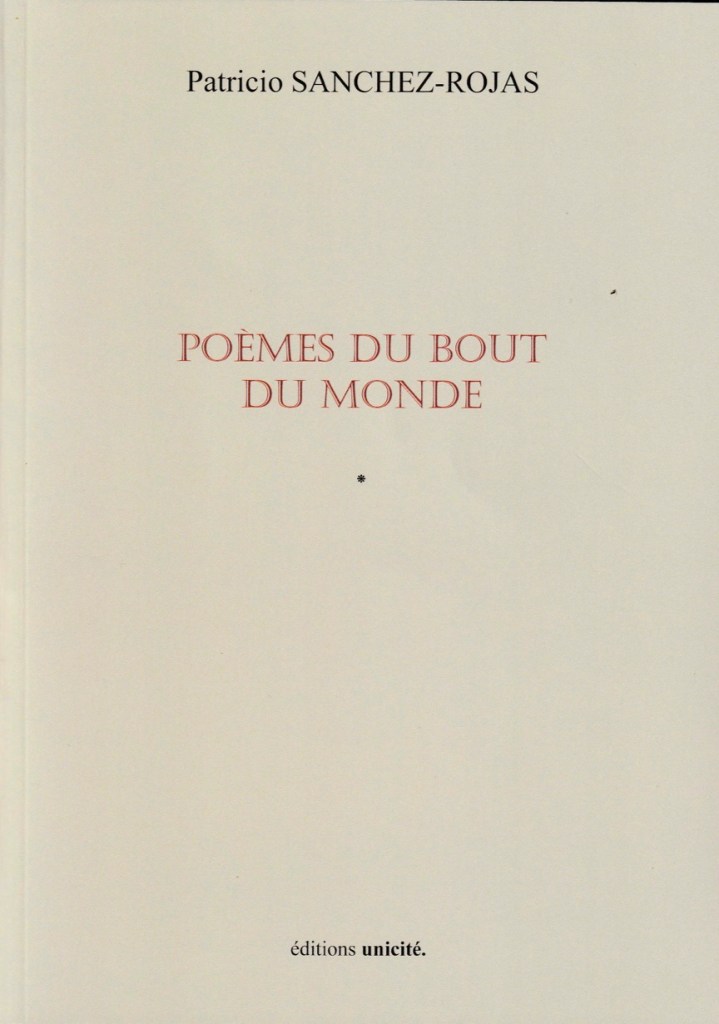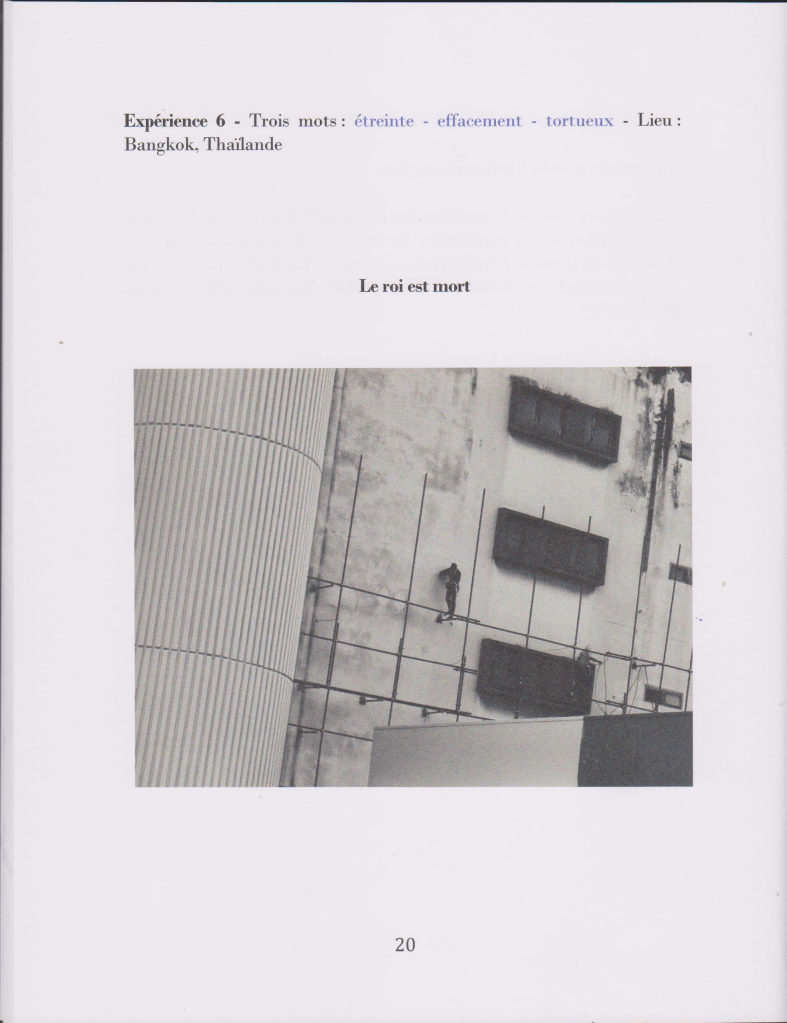Une note de lecture de Corinne Welger-Barboza
Marie–Hélène Prouteau, Paul Celan, Sauver la clarté1, Préface de Mireille Gansel, Éditions Unicité, 142 p, format 15X21cm, 14€.
Marie-Hélène Prouteau fréquente Paul Celan, depuis longtemps. Hormis la lecture assidue de son œuvre, elle a signalé les traces que le poète a laissées dans certains lieux cardinaux pour elle. Brest, visitée par Celan, Brest et les blessures encore vivaces de l’après-guerre qui ont provoqué une sorte d’éveil au désastre de l’enfant Marie-Hélène.
Mais d’autres contrées, d’autres villes, frappées par la guerre, situées en Europe et au-delà, ont imprimé leurs lots de ruines, dans l’esprit de l’auteure, au milieu desquelles la catastrophe de la Shoah ; ici le lien avec Celan se passe de commentaire. Sur ce terreau, germera une partie de son œuvre littéraire, la fabrique de sa sensibilité à la désolation, au broiement des vies, toutes choses en correspondance avec l’œuvre de Celan et sa terrible biographie. Marie-Hélène Prouteau marquera ce compagnonnage, en empruntant une expression du poète, le cœur une place forte2 , pour intituler un de ses ouvrages3 : sa propre quête de l’expérience familiale, durant la Grande guerre, une histoire de petites gens posant des gestes d’humanité, au milieu de l’inhumanité.
Cette fois, elle a choisi d’actualiser la présence de Celan, à ses côtés, de la consacrer pleinement, de partager l’approche personnelle qu’elle a forgée, au terme de cette longue fréquentation. Ce faisant, Marie-Hélène Prouteau ne compte pas rejoindre la société académique ; elle précise qu’elle ne vise pas «(…) l’approche pointue des études universitaires, érudites et herméneutiques ». Sa visée est toute autre : mettre au jour une dimension peu envisagée de l’œuvre, au moyen de la conversation exigeante et féconde qu’elle a instaurée avec le poète.
Au fronton de sa lecture de Celan, Sauver la clarté ; c’est la lumière qui s’annonce, proposition aux allures de paradoxe ou bien désir réparateur, au regard de la connotation première de l’œuvre du poète, confinée dans les ténèbres.
Alors, l’auteure circonscrit une séquence et un espace jalonnés de moments, d’évènements, d’œuvres et de poèmes évidemment. Une période dans la vie et l’œuvre du poète qui court des années 1960 à 68. Une zone sensible où lieux, circonstances, affects et créations nourrissent le dialogue que Marie-Hélène Prouteau a noué. L’auteure dessine autour des poèmes ou des lettres du séjour breton de 1961, une constellation de sensations qui manifestent le répit, le plaisir éprouvé, parmi la nature et la compagnie d’ombres amies. À l’autre extrémité du chemin envisagé, Mai 68 à Paris, qui entraine Celan dans ses manifestations, le cœur tendu d’espoir vers le printemps de Prague.
Le Finistère, Paris, deux étapes récurrentes dans la géographie du poète déraciné. La déambulation poétique de Marie-Hélène Prouteau arpentera ces lieux et bien d’autres, en les peuplant d’un monde de noms, amitiés d’écriture, intimités fraternelles jusqu’à la traduction. Elle restitue et recompose, ajoutant sa part d’imagination, la société dense dans laquelle baigne l’œuvre de Celan. Les liens entre les textes et les auteurs, les lieux et les époques animent ce monde des figures de Mandelstam, Kafka, Benjamin et tant d’autres. L’ouvrage de l’écrivaine est riche de sa propre érudition.
Des images aussi, motivent les haltes de Marie-Hélène Prouteau, relancent les évocations par leur puissance propre. Ainsi, de la fresque de Leyde de Jan Willem Bruins, œuvre d’art public, qui disperse des poèmes de toutes provenances, sur les murs de la ville. « Après-midi avec cirque et citadelle », écrit à Kermorvan, est l’un de ceux-là. Celan demeure ici comme chez lui, présent à ce milieu multilingue et cosmopolite. Le poème mural fait signe à l’auteure parce que le texte s’est fait image et réjouit sa sensibilité picturale, s’expose naturellement dans la Hollande de Rembrandt, cher au cœur de Celan – il a dédié un poème à l’un de ses autoportraits – ou encore, la Hollande des peintres modernes qui lui importent également. Ces Pays-Bas, refuge du savoir et de la liberté, depuis la création de l’université européenne jusqu’aux penseurs pourchassés, en passant par Spinoza ; toutes significations que Marie-Hélène Prouteau fait circuler, à la façon d’un va-et-vient, entre Celan et elle-même, par le truchement d’une carte postale qu’il a envoyée à son fils, en 1964.
Une autre œuvre plastique encadre l’ouvrage : la fresque de Giuseppe Caccavale, peinte sur la voûte du salon de la résidence étudiante Concordia, rue Tournefort – la rue où Celan réside en 68, à proximité de la rue d’Ulm où il a enseigné. Ici, l’œuvre est circulaire, bleue et entraîne le poème « Du fond des marais4 », dans son mouvement perpétuel. Une spirale dont Marie-Hélène Prouteau décèle la charge d’espoir, rappelant le lien de ce poème avec l’expérience concentrationnaire du travail forcé, englué dans la boue du marais. « Cette vision marécageuse, Celan l’accueille pour la contrer immédiatement à l’orée du poème : « Du fond des marais monter », dit-elle.
Autre nœud de la rencontre : la résistance contre le totalitarisme. Une fois le nazisme défait, la catastrophe stalinienne pèse de tout son poids, de tous ses crimes. D’où la célébration par Celan des « contre-paroles ». Dans le Méridien5, le « Vive le roi ! » de la Lucile de Büchner illustre le propos : on imagine aisément combien l’évocation de ce cri a fait rugir les communistes de l’époque ! Ô surprise, je sors à peine de la lecture de « Les dieux ont soif », d’Anatole France; une autre Lucile, une même en vérité, jeune prostituée, fait acte de courage et de liberté, en s’écriant « Vive le Roi », face à l’échafaud ! Je fais effraction dans le jeu des correspondances dont le livre est tissé… Marie-Hélène Prouteau tient étroitement liées les amitiés poétiques, linguistiques et politiques qui habitent Paul Celan : Mandelstam, Pasternak, Akhmatova… hormis leur importance, dans la période envisagée, nul doute qu’elle y trouve un écho à ses propres engagements auprès des dissidents du communisme réel.
Il faut revenir au motif apparent, ce que nous avons appelé la « réparation » : mettre en exergue, « sauver la clarté », la faire rayonner, parmi le paysage de désolation qui semble résoudre l’identité de l’œuvre de Celan et celle du poète lui-même. Car enfin, dans l’après-coup, Celan ne présente-t-il pas une vie close comme un poing fermé, entre le crime de 1942, blessure incurable de l’assassinat de ses parents et du peuple juif, et la mort qu’il s’est donnée, en 1970 ? Une ligne de vie parfaite, si l’on ose dire, avec sa logique écrite, imparable. Pourtant, la vie, évidemment, ne s’est pas conformée à une telle parenthèse monolithique. Les éclats de lumière que Marie-Hélène Prouteau a relevés, scrutés, se sont bien manifestés. La « période bretonne » du poète l’atteste, moment de détente heureuse.
Bien sûr, au cœur des ténèbres rayonnent aussi la lumière ou son espérance ; la tradition juive fait de cette ambivalence un puissant ressort. Pour sauver la clarté, le travail de Marie-Hélène Prouteau, s’arrime à des circonstances réparatrices, dans la vie du poète, nourries par les relations d’amour, familiales et extra-familiales : Gisèle, Eric l’enfant, et d’autres, amantes ou amies, comme Nelly Sachs, particulièrement envisagée ici. Mais en traçant le réseau des filaments de lumière, jusqu’à la capacité de Celan « de faire rayonner sous les méridiens célestes la clarté d’un reflet d’or. », l’écrivaine ne mésestime jamais la dualité qui travaille le poète. Au fil des pages, en empathie avec le tourment à l’œuvre, elle s’attache à faire coulisser les ténèbres et la clarté. Ainsi, elle relève dans l’adresse à l’enfant, pour qui il « coupe le bambou », la proximité établie par Celan avec le travail forcé au camp : « Kermorvan, Tabaresti, à l’aplomb du méridien, l’image nous rattache au corps du monde, en ses horreurs comme en ses émerveillements. » Elle ne néglige pas non plus qu’en 1961 Celan est traversé par l’onde de choc du Procès Eichmann ; il y répond, si l’on peut dire, par les Aphorismes de Kermorvan6,
Une sorte d’inscription géographique s’attache à Celan, suivie par Marie-Hélène Prouteau. qui sème, au fil du texte, une suite de poèmes importants. La carte ici dressée s’étend bien au-delà de la Bretagne, de la France, pour pointer à multiples reprises, vers l’Europe orientale, balkanique d’où vient Celan. Celle-là même avec laquelle l’auteure a tissé ses propres liens, et même posé des actes, dans les années 70. De quoi fabriquer une trame aux fibres multiples et entrelaçant différentes temporalités du passé. Mais l’opérateur décisif, essentiel, la raison d’être de la mise en relation, c’est l’écriture. La trame géographique dessine des proximités qui fournissent le prétexte et le contexte à la liaison, au ralliement par l’appartenance à l’histoire européenne mais aussi, et sans doute principalement, à la poésie.
La poésie s’entend ici, dans l’acception que Celan a formulée, grâce à la figure du méridien. Le méridien signifie bien davantage qu’une figure géographique ; il représente un mobile, celui de l’aller-retour, comme défini par Celan :
« Je trouve quelque chose — comme la parole — d’immatériel, mais de terrestre, quelque chose de rond, qui revient sur soi en passant par les deux pôles et en traversant même au passage, amusons-nous, les tropes des tropiques : je trouve… un méridien. »
Le mobile, compris aussi bien comme le but que comme le mouvement pour l’atteindre, vise à revenir au point de départ, à condition d’avoir suscité des rencontres :
« (…) parmi tant d’autres chemins, des chemins sur lesquels la parole se fait voix, ce sont des rencontres, les chemins d’une voix en route vers un toi qui entende …) ».
Ces mots de Celan éclairent l’œuvre de Marie-Hélène Prouteau. « Paul Celan – Sauver la clarté » qui tisse précisément la rencontre, du côté de celle qui a « entendu ».
Puis, la géographie et ses quelques repères, va bien vite se compliquer, voire se dérober ; nous serons tenus d’embrasser, dans le même mouvement, son antonyme ; à savoir, l’impossibilité d’inscrire des noms, des lieux, sur une carte effacée. La disparition convoquée recèle en réalité la matrice du poème, selon Celan, mouvement d’arrachement au non-lieu, dont le souffle se situe entre le « déjà-plus » et « l’encore ». Et c’est précisément, dans cet espace intermédiaire que s’insère l’élan de l’écriture, temporalité particulière de l’ouverture poétique, où Marie-Hélène Prouteau inscrit son compagnonnage avec Celan ; plutôt qu’écrire au sujet de Celan, elle choisit d’écrire avec Celan, à ses côtés. Sa voix propre se fait entendre, en toute liberté, sans le frein que pourrait inspirer la révérence au poète, ce géant. Tout ici procède, déambule au cours d’une libre association, autrement dit par la libération d’associations créatrices pour l’écrivaine.
Politique, résistance, poésie… Pour Celan, la poésie avant tout constitue le lieu de la résistance, pour instiller peut-être la consolation, surtout pour faire retentir l’irréparable. Forte de cette perception, l’auteure tente par son propre chemin d’écriture de percer, de suggérer le souffle qui porte la création de Celan, dans telle circonstance ou tel poème. Vagabondage, au sein d’un territoire précis de la production du poète où elle pose les cailloux blancs qui orientent, donnent sens au parcours, celui de Celan et le sien propre. Instants choisis de vie ressuscitée, rencontre en actes de parole.
Échos, signes, résonances, coïncidences, ricochets, le processus déployé par Marie-Hélène Prouteau creuse, rebondit, jusqu’à faire éclore le motif. Par les moyens de cette dérive, par le biais de sa profonde empathie, elle nous invite à côtoyer Paul Celan, à lire et relire ce poète essentiel. Sa prose poétique, libre de tout didactisme, trace les voies qui font rayonner les paroles de Celan, poèmes ou correspondances. On ressort éclairé.e.s du voyage.bre de tout didactisme, trace les voies qui font rayonner les paroles de Celan, poèmes ou correspondances. On ressort éclairé.e.s du voyage.
©Corinne Welger-Barboza
- Paul Celan – Sauver la clarté, Préface de Mireille Gansel, Éditions Unicité, 4ème trimestre 2024. ↩︎
- « Après-midi avec cirque et citadelle », recueil La Rose de Personne.
↩︎ - Le cœur est une place forte, La part commune, 2019.
↩︎ - « Du fond des marais », recueil posthume des poèmes de 1968.
↩︎ - Conférence de réception du prix Buchner, 1960, Darmstadt.
↩︎