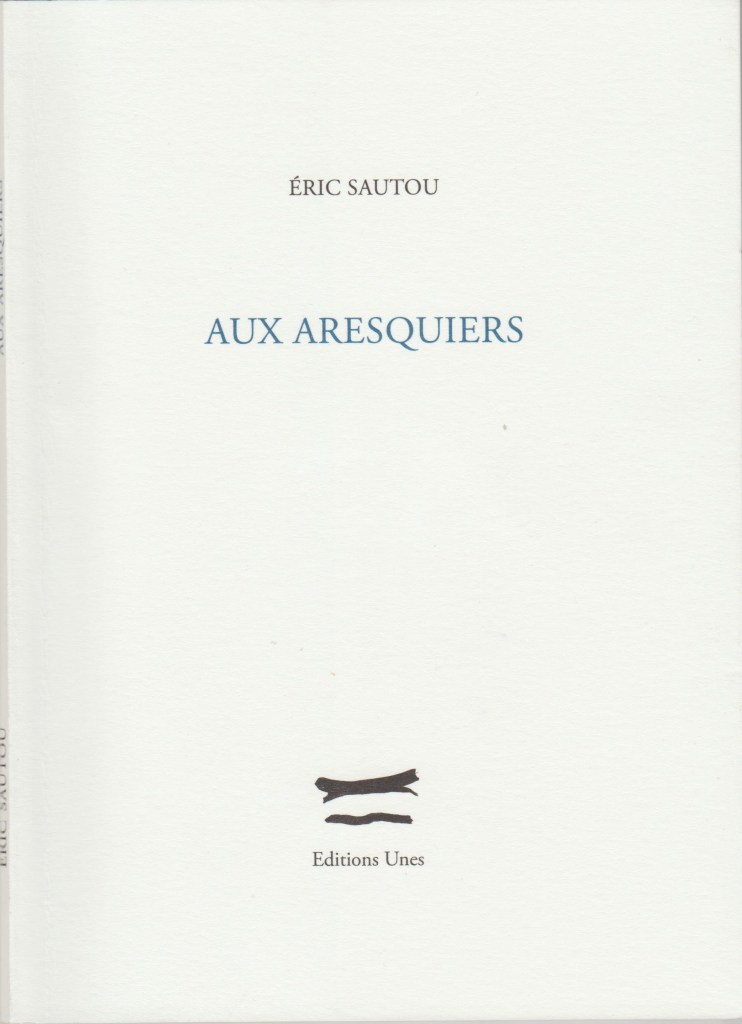Une chronique de Marc Wetzel
Geoffrey SQUIRES, Choix de poèmes, édition bilingue, Traduit de l’anglais (Irlande) par François Heusbourg, Editions Unes, 129 pages, mars 2024, 10,40 €
Geoffrey Squires (1942) ferait un parfait petit maître de haïku …
Bras blanc d’un pommier
qui vient tel un animal du paradis
frotter contre ma fenêtre
une longue branche en fleur
poussant contre la vitre claire (p.45)
… mais non : il ne se contente pas de tels morceaux choisis de pure présence. Squires est trop impétueux, trop divisé (trop nord-irlandais), trop traducteur ( je veux dire : trop avisé de la capacité des langues, même de la sienne, à faire prendre leur sagace et profitable petite musique pour un monde – neutre et général – même des choses), trop sensible à l’inquiétude même de la nature, pour se contenter de célébrer ses pauses, s’étonner admirativement de ses minces surprises, et distribuer d’aimables bons points à son accessible mystère. Il n’est pas dupe des petits airs contemplables de la nature. C’est qu’en elle, – il le sent et le chante – il n’y a aucune nostalgie de ses états propres, aucune complaisance, même dans le repos (rien n’y fait diversion, mais rien non plus n’y exagère son attention), rien ne s’impose définitivement à rien (tout ce qui arrive est déjà interrompu par autre chose, comme si l’autorité ne comptait pas entre phénomènes). Ce poète n’est pas tragique parce que la nature ne l’est pas : elle est faite, elle, pour se perdre, et les morts mêmes des êtres naturels ne sont que de « petits atterrissages quotidiens dans le secret de la lumière » (small landfalls daily in the hiddenness of the light, p.61). Le réel des choses, comme dit Valéry, « ne va vers rien » (who knows where it all goes – dit Squires, p.90). Mais c’est qu’aller lui est tout. Et ce poète aussi aime aller.
« Que cela soit ou porte en soi (whether it is or has within it)
Une substance telle qu’on ne peut l’imaginer
qui sait où tout cela mène
Nombreux nombreux petits mouvements
Quelle est cette lumière
qui se perd là-haut et s’éloigne
Voix un frisson dans l’air
temps le détail « (time the particular) (p.91)
La nature seule intéresse l’effort constant de perception de Squires; on ne trouve pas nommé un seul objet technique en cette cinquantaine de poèmes, et le seul événement socio-culturel mentionné en eux est la circulation automobile « Les routes sont du meurtre à l’état pur (sheer murder) de nos jours » p.35. Mais de cette nature, le poète est indifférent aux horizons (qui ne sont que nos limites portatives, p.71), comme à ses socles secrets (l’apparence lui suffit dès que, disait Alain, « il ne manque rien à une chose qui dépend de toutes les autres »); L’étrangeté salutaire de la nature, suggère-t-il (p.55), c’est justement que ses détails (comme une feuille d’arbre agrandie) recèlent une infinité de petits mouvements, mais « pas d’intériorité en soi » (la nature ne cache pas d’âmes, elle ne recèle pas de choses qui pourraient retentir en elle autrement qu’au-dehors, elle est sans recoins d’un autre ordre). Et la nature aime rattraper – mais sans violence – ses déséquilibres (comme le mouvement elliptique le montre, p.121, l’ellipse étant à la fois manque – elle manque la perfection du cercle – et pirouette – elle dote d’une allusion instruite son retour à elle-même). Si la nature vivante est promesse de nouveaux possibles, c’est une promesse immanente, strictement indigène : une Providence extérieure laisserait notre poète de marbre. Comme l’eau d’une rivière (p.77) se sent déjà plus loin, « déjà ailleurs », « muette », « lointaine » (sans souci aucun pour les belles arches de ponts qu’elle franchit), la nature va son cours avec une « quiétude indélébile » (p. 117 – indelible stillness) – Comment s’effacerait le contexte qu’elle est à elle-même ? s’oublierait l’histoire qu’elle se raconte ? se romprait l’équilibre qui la ramène à elle-même ? Si le jour au crépuscule abandonne l’oiseau diurne, celui-ci lui rend la politesse et s’endort. Et demain, dit la page 83, la lumière tombera à travers le même silence. La paix des formes est toujours assurée puisque l’art de la Nature est son propre comptable.
« Si calme désormais que le plus léger mouvement
perturbe tout
Qu’est-ce à ces heures (What is it at these times)
Dans le soir tôt le soir quand le vent tombe
et que les oiseaux commencent à s’installer pour la nuit
chacun sur sa branche posté dans l’obscurité
Qu’est-ce que cette existence qui est nôtre pas nôtre
Faible remous
Et partout la quiétude
comme s’il y avait une veille (a watching) tout l’ensemble observé
et une attente (a waiting) s’il s’agit bien de ça » (p.78)
Parfois, l’inquiétude écologique de l’auteur semble se méfier de l’esprit poétique lui-même. Car l’esprit humain, même le lyrique, est fureteur et insistant par principe (ses habitudes restent en lui, et parlent de plus en plus fort). Il lui faut « trouver des histoires à ces arbres/ les récits de leur feuillaison/ une raison à leur densité » (p.87). La Nature se défend mal d’un esprit pouvant se poster partout, aboutir à n’importe quelle échelle d’elle depuis n’importe quelle autre, et, dès lors, « peu de choses résistent à l’interprétation/ se défendent avec succès/ contre la compréhension » (id.). Comment déjouerait-elle les guetteurs d’un tout autre ordre que nous sommes ? Notre chant lui est comme une niche de sens « piégée » – avec, pour elle, « nulle part où aller » (p.87), puisque l’esprit est présent partout où (et dès qu’) il se représente l’être ? Quand l’esprit fait découler la nature d’elle-même, ne trahit-il pas son pur et simple écoulement ? Dans le texte, ce recouvrement abusif de « s’écouler » par »découler » se dit dans la tension entre « to flow » (p.88) et « to follow » (p.84) : l’ondoiement propre de la nature n’est pas notre consécution d’elle. La solution (imparfaite ?) est de savoir qu’on est seul à parler dans la maison de l’être (« pas de mouvement sauf mon mouvement/ pas de sons sauf les sons que je fais » p.25 – ainsi le ventriloque sait n’être qu’un pétomane de la haute), et qu’il faut donner le change en se croyant occupé dans le monde à autre chose qu’à le chanter (« C’est plus facile de parler n’est-ce pas/ quand on fait quelque chose/ à la cuisine par exemple/ ou en promenade ou en un long voyage/ Comme si les mots/ ne pouvaient supporter leur propre poids/ et que nous avions besoin de quelque chose d’autre/ une activité qui n’aurait rien à voir/ avec ce qui était en train de se dire » (p.69). Grand-mère officiellement affairée à son tricot peut alors se risquer aux plus effarantes confidences. Ce n’est pas alors qu’elle est heureuse; c’est que le bonheur ne lui est plus un problème. De même, disait très tôt dans son oeuvre, le subtil et doux Geoffrey Squires :
« Je suis heureux de trouver
le monde à ce point indifférent (…)
Je suis heureux de trouver
le monde à ce point absorbé en lui-même
comme quelqu’un s’apprêtant à dormir » (p. 21)