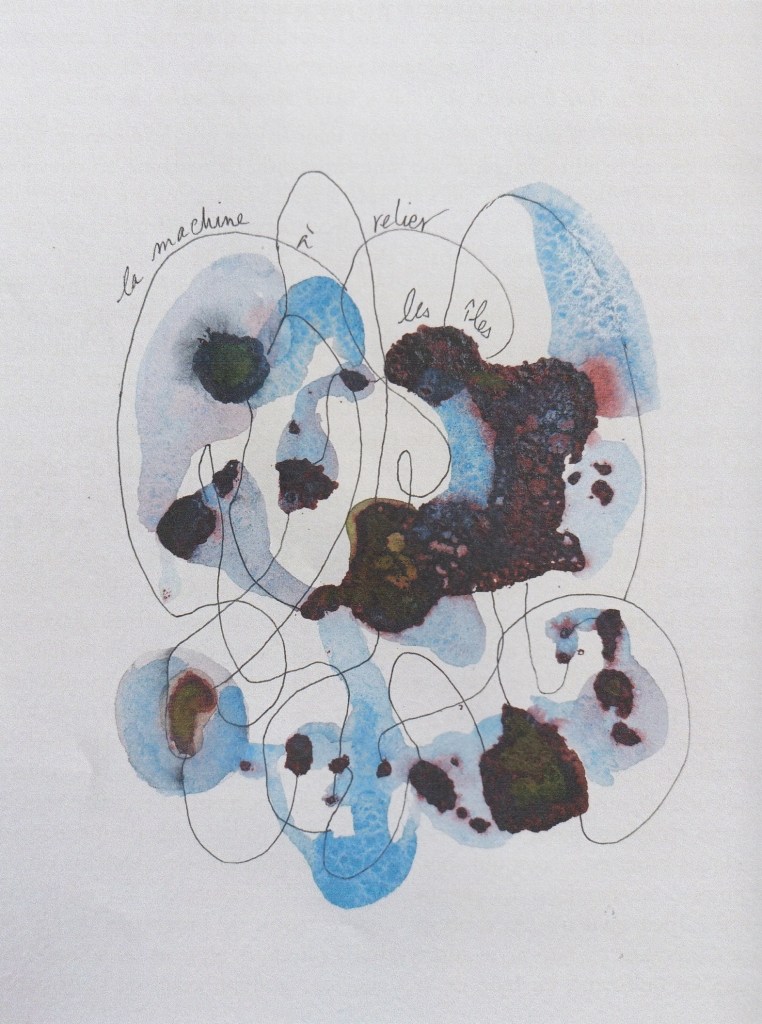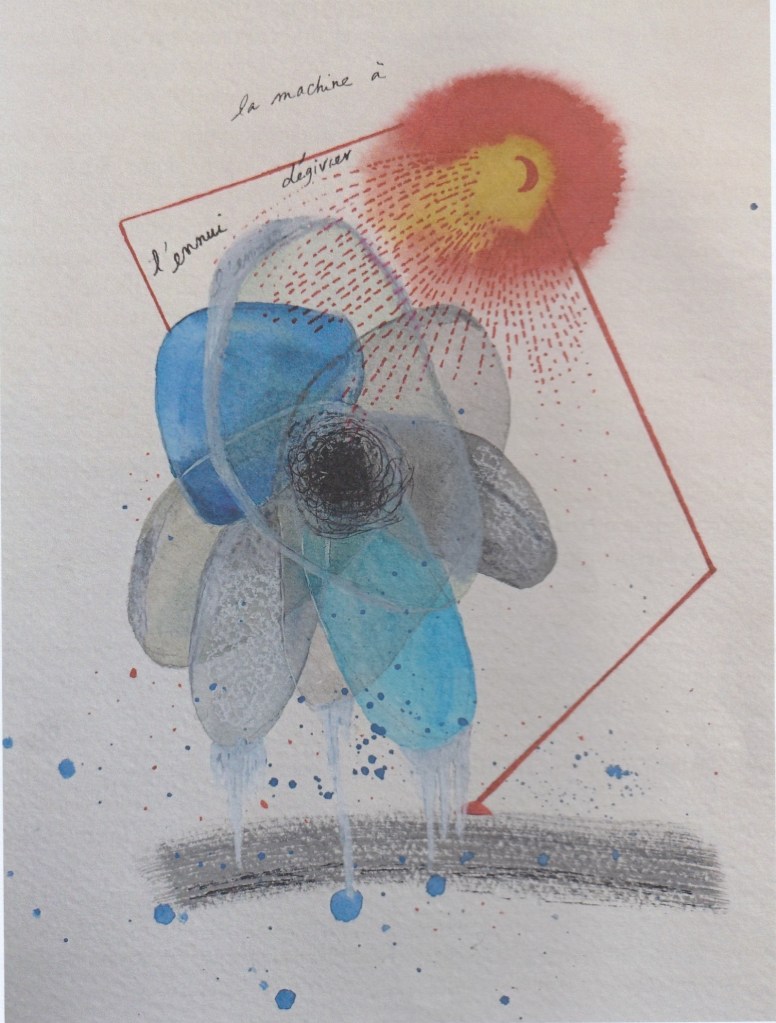Une chronique de Marc Wetzel

Camille LOIVIER, Nature en décomposition, Backland éditions, 116 pages, octobre 2024, 17€
« on nage la bouche ouverte dans la vase
on se souvient d’avoir été bercée
la douceur furtive de l’eau est celle
d’une queue de belette passant sous le nez du dormeur
(je ne sais pas ce que tu veux
tu ne cesses de t’écouler – )
alluvions et têtards ensevelis dans la vase
y étouffent sans bruit
– quel dommage de ne pas les suivre sans retour … ») (p.62)
Le titre de ce recueil de poésie « Nature en décomposition » pourrait, à tort, faire penser à un cri d’alerte écologiste (sur une nature déréglée par la pollution, et y perdant son ordre), ou à une observation d’agronome ou de simple promeneuse sur la putréfaction locale – par l’âge, les saisons ou les intempéries – d’un mince ou large biotope, mais (même si l’auteure, semble-t-il, jardine ou herborise volontiers), pas du tout ici ! La décomposition même du livre en « éléments » (sept « cycles », ici des pierres, du bois, de l’eau … jusqu’au feu et à l’air) signifie donc nettement : une analyse de la nature (en ses caractéristiques dominantes, en ses aspects matériels majeurs) – mais comme dramatisée (« décomposition » n’est pas neutre, et on sent comme une gêne ou un prix à payer dans la réduction de la complexité naturelle à ses forces et formes simples). La « décomposition d’un visage », par exemple, dit tout autant la division observatrice des traits par un portraitiste avisé que leur altération par une situation troublée. Pour le dire familièrement, affronter, épingler et disséquer la nature quand on n’est ni Linné, ni Lavoisier, ni Tarzan (ni même Lucrèce ou Spinoza) est périlleux : si la nature ne se déduit pas plus que la vie, c’est que chacune des deux découle, non d’un principe, mais d’elle-même. Et si elle ne s’analyse pas plus aisément que le temps, c’est que, comme lui, la nature se recompose indéfiniment et aussitôt elle-même ! D’ailleurs, « nature » en général veut dire aussi bien « essence » que « jaillissement », et elle est donc – promesses d’une difficulté redoutable – aussi bien principe de son propre écoulement que simple passage de ses raisons d’être. Mais notre poète, intègre et subtile, sait tout ça, et ce qu’elle se propose d’écrire connaît ce double constant défi de circonscrire ce qui s’échappe, et comprendre ce qui se relance. Et, de fait, rien de ce qu’on lit dans ce dense recueil ne prétend suffire, sans jamais pourtant renoncer à avancer. Comme « traduire« , dit quelque part Camille Loivier (elle-même traductrice), « est comme une lecture en trois dimensions » – car il y faut déchiffrer à rebours le flux des mots jusqu’à leur source, pour qu’ils sachent rejaillir en une autre langue – « décomposer » la nature, c’est la faire revenir d’où elle vient pour qu’elle redéploie, au ralenti et comme à neuf, son style d’advenue. Voilà sa marche, son épiphanie farouche et tremblée.
Que trouve donc la poète dans cette « décomposition » de la nature ? Une vie plutôt minérale et végétative qu’animale (malgré un ours, une belette, un crapaud que déloge une bêche et quelques oisillons plus morts que vifs). Pas d’humains. C’est que l’affect qui règne ici est sentiment, plutôt qu’émotion ou passion : il n’existe pas d’émotion végétale (car réagir intensément à ce qui trouble suppose une sensori-motricité), et les passions ne sont qu’humaines (l’émotion de peur est animale, mais la passion est émotion du désir même, comme la jalousie est peur d’être trompé, l’ambition peur d’être devancé ou l’avidité peur de manquer…). La plante n’a certes pas de sentiments, mais tout sentiment (comme la confiance, l’anxiété, la tendresse, la rancune …) suppose d’être constamment exposé à quelque chose, de se sentir participer à un milieu de vie ou en être exclu, d’être dans la lenteur d’un retentissement positif ou négatif – ce qui est l’être-au-monde végétal même. Et, par exemple, tout le recueil déploie comme une anxiété de longue haleine, buissonnante, ramifiée, une sorte d’anxiété sûre de sa prévalence, voire de son bon droit ! Extraits d’anxiété, qui parlent d’eux-mêmes :
« ne faut-il pas exorciser une maison
avant de lui donner son sommeil » (p.96)
« les dieux sont des morts qui s’éloignent dans le vent
ils longent les murs
on les fuit
ils ont le goût amer du passé
chaque jour il faut se cacher
éviter leur regard à l’aube
avant qu’ils ne s’endorment … » (p.98)
« … montagne qui erre en moi, qui rampe en moi
(je coupe à travers)
montagne rasée
sa tête, son crâne (…)
quelqu’un arrose
j’entends le bruit de l’eau
et encore l’odeur de brûlé
la poussée d’une autre montagne » (p. 101)
Et c’est avec tous les moyens qu’elle rencontre, en elle comme hors d’elle, que la poète sent médiumniquement la vie s’ouvrir ou se fermer à elle, et la substance des choses se sauver ou se perdre. Tous moyens du bord : son oreille (p.15), qu’elle colle aux pierres pour y déceler des sortes d’échos fossiles, et « la dilatation de leur corps comme un murmure ». Ses yeux (p.87), qu’elle ferme soudain pour que le ciel étoilé tombe au sol d’un coup ! Sa voûte plantaire même (p.86) :
« ce n’est pas encore l’obscurité
mais presque
pieds nus je reconnais la direction des racines
ma plante se courbe au-dessus de leur courbe
(je n’existe qu’à ce moment-là) »
Mais encore une cuiller (p.77), une hache (p.44), une manivelle de pompe Japy (p.68), et même une brosse à dents (p.83) :
« dans ma bouche
frotte la brosse à dents en écrasant les poils«
La bouche, omniprésente, car en elle les éléments à la fois boivent et sont bus. La présence de choses de deux côtés de la peau obsède la poète, comme la hante être des deux côtés de l’eau à la fois :
« l’eau pénètre les bottes par l’intérieur
peu à peu
peau contre peau
l’eau du corps
et l’eau hors du corps
se rejoignent » (p.62)
et :
« car, si fraîche, on boit l’eau dans
laquelle on se baigne
nous imprégnant des deux côtés de la peau » (p.57)
car la vie même n’est qu’une eau compartimentée, boostée, se relançant elle-même, se « rongeant de l’intérieur » (p.77) pour se sauver de sa propre noyade. Le vivant est mystère d’une eau manoeuvrant sa propre décomposition pour se reformer toujours autrement. Ainsi fait la nature entière, pressent et suggère Camille Loivier, qui prête sa voix heurtée, profonde et fragile, à cette souveraine indéfinie recomposition. Poète aux si singulières postures (ici, la lumière lui fait un croche-pieds (p.28); là, une ombre appuie sur ses omoplates (p.86); là encore, l’onirisme est extraordinairement présenté comme l’impérieux phototropisme du pauvre, du démuni du jour:
« tout tombe quand vient le soir
j’enfonce la pédale de sourdine (…)
je cherche encore
les rêves sont le seul lieu où il fait clair
mais il faut leur céder » (p.90)
Voix qui nous convie, en quelque sorte, au bivouac onirique de sa si étrange nostalgie (tant d’existences laissées en suspens, avant nous, dans le courant universel !) :
« Le rêveur vit dans un passé qui n’est plus uniquement le sien, dans le passé des premiers feux du monde« , écrit ainsi Bachelard (cité p.95)
Le même (car le monde de cette poète fait penser à un rare trio que Bachelard formerait avec Dickinson et Tarkovski !), qui se serait adressée à elle, certainement, ainsi : « Il faut guérir l’âme souffrante; et d’abord débarrasser l’âme des fausses permanences, des durées mal faites, la désorganiser temporellement« .
Trouver la vraie succession de nos états en extirpant celle, seulement consciente ou officielle, de nos images, c’est ce que fait l’humble et intrépide Camille Loivier, en « personne bien née » (à elle-même !), comme dirait Valéry (dans sa « Petite lettre sur les mythes ») :
« Il n’est point de personne bien née qui manque, chaque matin, à retirer de ses propres gouffres quelque énormité abyssale, quelque poulpe de forme obscure qu’elle s’admire d’avoir nourri«
Et qu’elle nous décompose ici avec succulence.