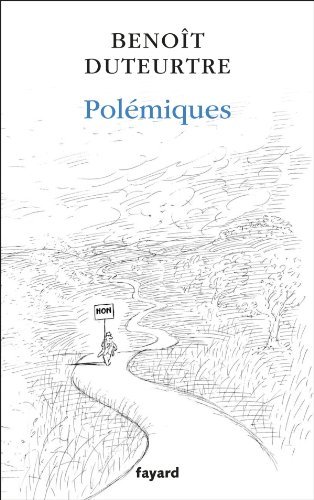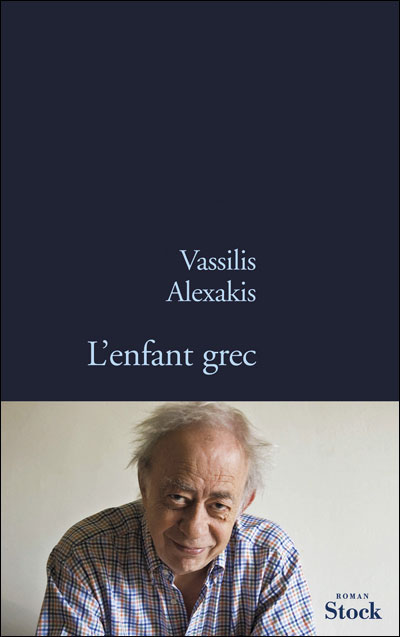Chronique de
-
Benoît Duteurtre, Polémiques, Fayard (17€ – 225 pages)
La couverture de Polémiques, signée Sempé, parle d’elle même. Ce « non » brandi annonce le ton vindicatif de l’ouvrage. Benoît Duteurtre y brosse un portrait tour à tour au vitriol ou admiratif de ses contemporains, dévoile ses goûts artistiques, livre une litanie de réflexions sur la société et ce qui lui paraît scandaleux (le tabou sur la mort assistée). Il brasse de multiples thématiques, depuis la politique, la vie au quotidien jusqu’à l’esthétique, rassemblant des bulletins d’humeur.
Benoît Duteurtre, romancier lui-même, aborde une réflexion sur le renouveau du roman français.
Il donne sa conception de « la bonne littérature » qui, pour lui, doit rimer avec humour « un excellent indicateur, presque indissociable de l’art romanesque ».Il met en lumière les « esprits drolatiques » qui savent poser « un regard décapant sur le monde. Il inventorie les ouvrages de quelques humoristes majeurs. Parmi eux: Philippe Jaenada, Martin Page, Igor Gran, Bernard Quiriny et Olivier Maulin. Ne boudant pas le name dropping, il en mentionne une pléthore d’autres qui savent aussi manier l’humour, l’ironie avec brio, comme Serge Joncour, David Foenkinos, Jean-Claude Lalumière ou Marin de Viry. Où sont les femmes ? « au royaume de la douleur, du cri ».
Il n’hésite pas à pratiquer le « Angot bashing », qualifiant cette auteure de « championne de France de l’autofiction ».Il s’étonne de voir « les experts en modernité » l’encenser, la critique littéraire accorder du crédit à son écriture. Quant à Michel Houellbecq, cet arpenteur du dernier rivage, il lui dresse un piédestal, balaie son œuvre et montre comment il a imposé sa plume dans le paysage littéraire contemporain. N’ont-ils pas en commun cette clairvoyance acide sur le monde et notre finitude ? Chez Benoît Duteurtre, on devine la hantise du vieillissement et cette façon d’anticiper sur l’évolution pressentie et redoutée qui est l’élégance du pessimisme.
Ceux qui aiment Monet auront plaisir à partager l’engouement de Benoît Duteurtre pour ce peintre dont il se sent proche pour diverses raisons qu’il analyse. Dans une envolée dithyrambique, il explique en quoi sa peinture a modifié sa vision des choses. La magie Monet opère.
Si certains dressent la liste de leurs envies, Benoît Duteurtre décline celles des choses qui l’agacent, l’insupportent, l’indignent, l’horripilent. Qui n’a pas pesté contre « la terreur des trottoirs » qu’est un cycliste pour le piéton ? Et l’auteur de dénoncer l’absence de verbalisation. Ou contre « un char d’assaut » désignant ainsi la poussette que vous devez éviter, contourner.
Comment ne pas déplorer l’intoxication du lexique par l’anglais, la francophobie de certaines nations étrangères ? Et l’auteur de retracer des pans d’histoire afin de disséquer les raisons de cette vague antifrançaise. Comment ne pas adhérer à cette revendication d’acheter français ?
Comment ne pas être irrité quand les ondes n’ont rien d’autre à offrir que du sport ? Cette uniformisation des contenus au détriment de la littérature, du cinéma, des arts laisse perplexe.
Benoît Duteurtre souligne également la disproportion budgétaire, le sport devenu un vrai business.
Certains passages apparaissent comme un droit de réponse à ceux qui l’ont éreinté, en ce qui concerne le mariage pour tous. L’auteur fait part de sa stupéfaction face aux conclusions hâtives et sectaires d’un jeune journaliste pour qui toute personne opposée au mariage gay est homophobe.
Il s’insurge contre cette tendance à « cultiver la part de l’enfance », contre le culte de la famille cellulaire. Il n’hésite pas à afficher clairement ses opinions sur l’ère de l’enfant roi. En tant que musicologue émérite, Benoît Duteurtre ne pouvait pas faire l’impasse d’un chapitre sur la musique.
Il revient avec ironie sur la déroute face à un épisode neigeux d’une ampleur exceptionnelle, comparant aux hivers combien plus rigoureux que ses ancêtres ont connus. Non sans un brin de malice, il distille de précieux conseils en cas d’un éventuel futur blocus.
Par ce regard caustique, sans complaisance, que Benoît Duteurtre pose sur notre époque, la comédie humaine, l’auteur rejoint la confrérie des humoristes , de ceux défendent la langue et luttent contre l’invasion de l’anglais. Car trahir la langue n’est-ce pas trahir notre vraie patrie selon Barbara Cassin ? Dans Polémiques, on retrouve également ses récurrentes bouffées de nostalgie. Ne cherchez pas ce pourfendeur invétéré dans les cafés. Il les fuit ! Il s’interroge sur l’avenir, y voyant « le versant noir de la modernité », voué à l’obsolescence programmée de nos objets usuels.
Polémiques, avec ce ton grinçant du pamphlet, de la diatribe déjà remarquée dans les ouvrages précédents de Benoît Duteurtre, ne sera pas sans susciter les réactions des détracteurs. Mais en passéiste, il ralliera ceux qui militent comme lui pour sauvegarder la beauté, la poésie des paysages. Et de revendiquer « l’amour du passé » pour suppléer au manque de fantaisie du présent.
Ne passez pas à côté de cet essai audacieux, coup de poing, qui dézingue, étrille, éreinte, décapite, brocarde à tout va, mais aussi encense et valorise le beau, l’authentique.
On ne peut qu’apprécier cette approche.
©Nadine Doyen