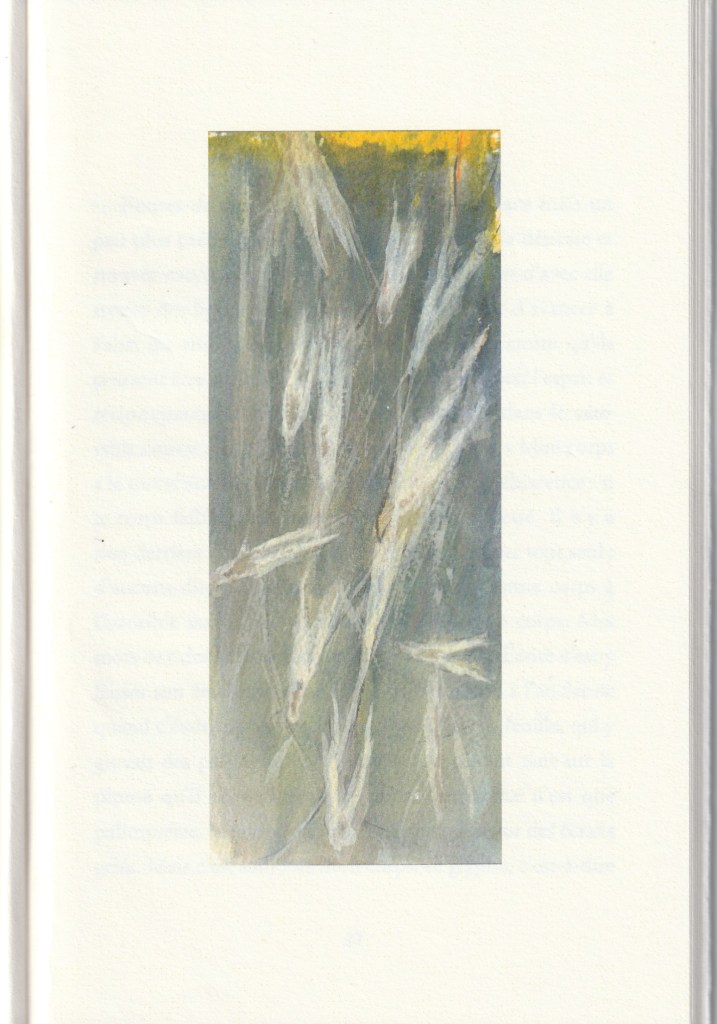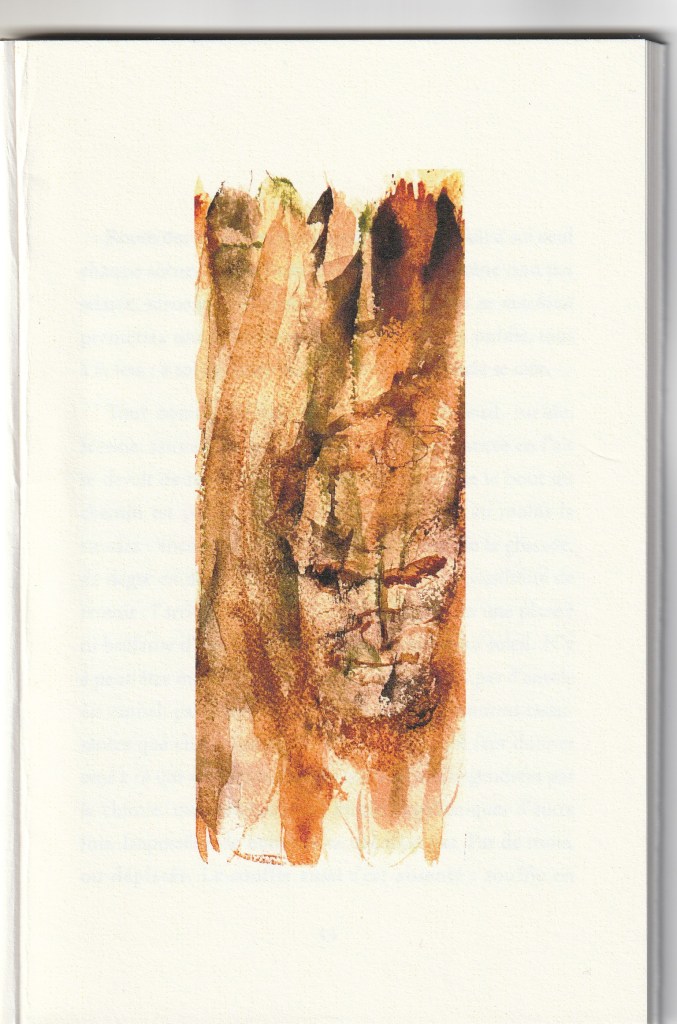Une chronique de Marc Wetzel
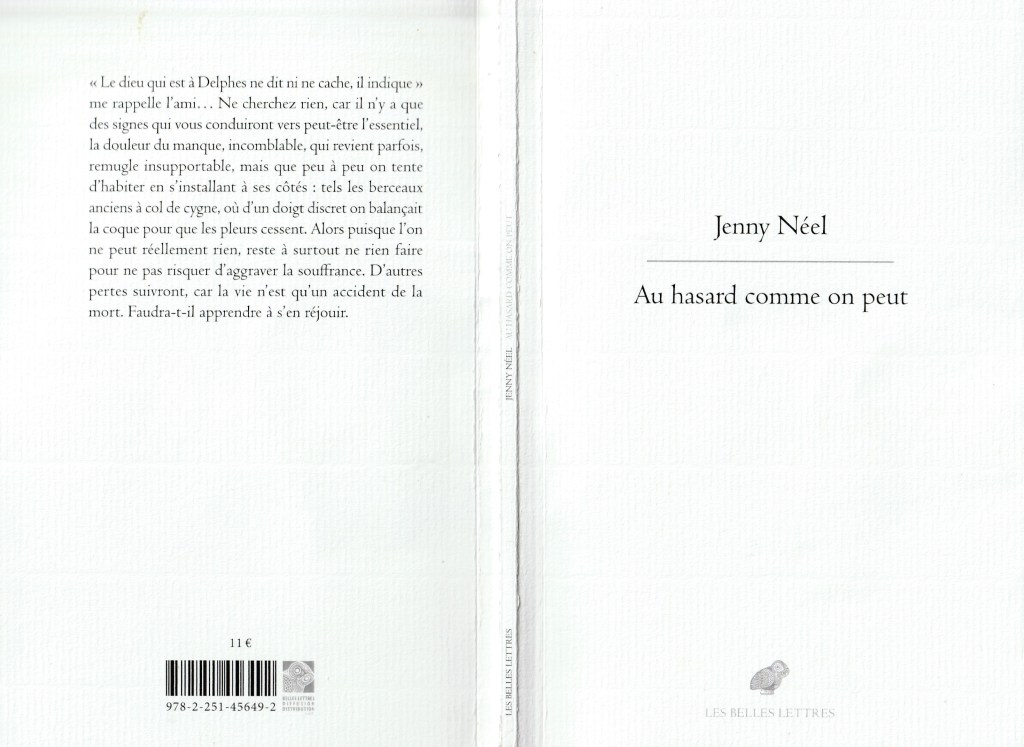
Jenny NÉEL, Au hasard comme on peut, illustrations de Jean Naudin, Les Belles Lettres, janvier 2025, 48 pages, 11€
Ce très court texte – publié sous résolument féminisé pseudonyme ! – est un étonnant chef d’oeuvre (une chose lyriquement très rude, d’une constante et magnifique profondeur), qui fait se succéder quelques « routes » qui s’ouvrent, diverses voies d’existence ( nommées : malheur, urgences, petits riens, tendresse, menace …) où l’auteur fut engagé, qu’il rapporte avec rares franchise et justesse. Voies tragiques pour l’essentiel, chemins donnant les uns sur les autres et sur leur exclusif rescapé, qui dit d’eux tous ceci : d’abord, « l’errance » est « la seule voie certaine puisqu’elle conduit là où l’on ne s’attend à rien » (p.7). Ensuite : on aura pu, à chaque fois, « aller jusqu’au bout sans crainte puisque le chemin fut l’essentiel » (p. 31). Enfin, le souci s’est imposé, toujours, d’y être délicatement seul, de n’importuner ni les personnes ni les choses d’explications à exiger ou fournir. Ce dernier point est particulièrement celui de la « route de la main tendue » …
« de celle qui s’ouvre mais ne se referme jamais totalement, refusant de posséder, de tenir, de com-prendre. J’ai refusé de comprendre, me laissant guider par une fatalité douce, laïque, sans signification et qui fait que ce qui arrive arrive et que l’hôte d’abord étranger vous devient familier, n’exigeant aucun pourquoi, aucune raison d’être là. Comme le disait l’ami-poète, l’essentiel est de laisser l’univers en l’état, quoi qu’on fasse. Se glisser dans les draps de la vie en les froissant le moins possible … » (p.39)
Voici donc, en clair, notre auteur caché : une sorte d’hygiène cosmique, et portant l’aléatoire en discrète bannière plutôt qu’en spirituelle armure !
Oui, l’aléatoire, en version « pas de vague », désabusée et laborieuse, comme la célèbre réplique de Jocaste, conseillant à son fils – craignant de se découvrir bientôt son mari – de retenir sa curiosité au seuil de l’invivable (dans l’Oedipe-roi de Sophocle), dont est tiré le titre de ce livre :
Oedipe : « Et comment ne pas craindre la couche de ma mère ? »
Jocaste : « Et qu’aurait donc à craindre un mortel, jouet du destin, qui ne peut rien prévoir de sûr ? Vivre au hasard, comme on peut, c’est de beaucoup le mieux encore. Ne redoute pas l’hymen d’une mère : bien des mortels ont déjà dans leur rêve partagé le lit maternel. Celui qui attache le moins d’importance à de telles choses est aussi celui qui supporte le plus aisément la vie » (trad. Paul Mazon)
C’est que la différence entre pessimisme et optimisme n’est toujours qu’une nuance sur même fond de hasard. « Ce que le hasard t’a offert, il te le reprendra » (p.28), voilà la défiante mélancolie. Mais la confiante disponibilité, que se dit-elle sinon : « ce que le hasard t’a pris, il te le ré-offrira » ? Hasards de disparaître et d’apparaître ne font alors qu’un, qui s’équilibrent indéfiniment, sans visée ni plan !
La chance, la « fortune », c’est tomber sur quelque chose de désirable en poursuivant un objectif tout différent (une pièce d’or, par exemple, en jardinant) – ou comme une mutation « favorable » (= plus adaptative) que l’organisme enregistre et ne se cherchait pas. C’est comme une utilité qui tombe du ciel, et un but atteint sans l’intention de le poursuivre : une issue inconstructible, et dont l’occasion s’offre. Si le réel est le tout qui est, il est donc capable de tout, mais à ses propres conditions (qu’il ignore, ou plutôt : qu’il ne peut connaître parfaitement en aucun endroit de lui-même) : la fréquence d’advenue de ce qui peut arriver dépend, non de Providence (à laquelle rien du réel ne pourrait échapper), mais d’une complexité telle du réel qu’elle ne peut en retour que lui échapper ! C’est cette richesse d’éventualités même (comme la prodigalité d’un aveugle) qui fait qu’on ne sait celle qui, au cas par cas, sera retenue. Il n’y a que par et pour un Dieu (que notre auteur écarte) que le réel pourrait connaître (et donc peaufiner) ses propres détails. Puisque la vie est réelle, elle doit donc toujours aussi, incompressiblement, aller au hasard. La seule chance directionnelle du réel serait donc qu’il n’oublie, à mesure, rien de ses propres états; mais l’amnésie des « conditions initiales » est la loi d’un devenir qui ne poursuit sa course qu’en se devenant autre. « L’oubli est roi : la mémoire n’en est qu’un accident, provisoire » (p.21). Et la vérité même (qui est l’apparition continuée de ce qui rend les choses réelles) n’est ici que fortuite et temporaire.
Vérité que s’interdit d’esquiver l’auteur, y compris quand il avoue, dans la troisième route qui suit ici, « avoir esquivé et non vaincu la mort« (p.21)
Les trois premières « routes » du livre disent, d’ailleurs, le tout de notre auteur.
« Route d’Emmaüs », d’abord, où deux pélerins, « courbés sous le poids de l’absence« , qui peinent à reconnaître leur Sauveur dans le vagabond qui s’était joint à eux, en partageant le pain qu’il rompt, submergés par « l’espoir, ce cancer de l’existence » (p.7), sont soudain à nouveau égarés, déçus, abandonnés – car l’Apparition leur paraît d’un coup « se nourrir de leur faiblesse« , et les tenir par leur illusoire voeu même de se changer. Dans une version clairement non-évangélique de l’anecdote, il ne faut donc pas moins, à ces errants d’Emmaüs, que se guérir du Christ pour considérer et assumer l’exclusive vérité de l’absence. La reconversion est ici de complète désillusion. L’auteur suggère ceci : nous sommes faits d’atomes, et qu’est-ce qui serait plus dérisoire que des atomes confiants en leur sort, et s’imaginant sauvables ?
« Route du malheur », ensuite : c’est un nourrisson dont le « lit n’eut pas le temps de garder la trace du froissement des draps » (p.9) – la même image sera reprise, on l’a vu plus haut, page 39 – parce qu’il lui arrive (« la nuit a eu lieu« ) bientôt de mourir – « pause alchimique inversée qui change l’or en rien« . Cette enfant « ne fut qu’un frisson de l’existence, que nous ne sûmes réanimer » (p.9). L’auteur sait dire comme personne ce retour vers rien :
« Il y avait. Il n’y a plus. On ne peut que pleurer, sa vie durant, ce qui a quitté la cage, fleurie, pourtant pleine de petites alvéoles d’aérations pour que circule librement ce qui doit se passer sans raison, que rien ne tenait enfermé. Elle n’est pas revenue. Son aura hante jour et nuit, mais ce n’est qu’une aura » (p. 9-10)
Troisième chemin enfin, ici : l’auteur lui-même qui, terrassé par une attaque, part mourir aux « urgences ». Le bref récit dit la dégringolade de réalité, « l’impossibilité de retenir; l’arrivée sur une place vide, est-ce bien une place ? » (p.13). Il se sait mourir, dans la sereine évidence suivante : larguant son dernier souffle, il sort l’accompagner, voilà tout. Et quand l’improbable remontée se fait, quand un infime souffle vient reprendre du service, quand l’attirail minimum de la présence se reforme « au hasard » (puisqu’il n’y a et n’y aura jamais « d’absent de l’indicatif à conjuguer »), et « comme on peut » (car le silence même qu’on saisit revenir atteste qu’on est soi-même revenu), alors …
« la surprise passée, il est temps d’apprendre à nouveau à se tenir vivant. Gestes, attitudes, réactions, bref faire en sorte que personne ne se doute qu’on est ressuscité. Évitons les visites au temple et les vérifications des trous, mains et côtés, de peur de se sentir ridicule » (p. 17)
Ce livre désespéré (rien de plus sursitaire, lit-on ici, qu’un miraculé !…) n’est pourtant en rien désespérant. Comme chez Nietzsche, la conscience tue mal, mais n’est au fond que conventionnelle et « tardive » : nous « reste alors la sensation si sur elle nous acceptons d’être en prise, si nous sommes avec elle en consonance : battre à l’unisson de ce métronome jusqu’à l’épuisement » (p.32). Comme chez Marcel Conche, la mort gagnera, mais sans pouvoir nous priver de ce que nous aurons vécu (qui saurait donc dévaliser un fantôme ?). Comme chez Clément Rosset, la joie peut « plonger dans la fissure (angor) » même « qui s’ouvre et que seul le rien pourrait combler« . Mais notre auteur est à part : il a la légèreté d’un Bobin dans … l’opaque vertige d’un Schopenhauer. Et, lui, sans jamais attendre de la pensée ce qu’elle ne peut fournir :
« Route des petits riens, de ceux qui laissent un goût d’inachevé et pourtant sont l’essentiel de l’existence, parce qu’accomplis. Se protéger du vent ou fermer les yeux sur ce que l’on ne veut voir, continuer à vivre en marge de l’insupportable, se calfeutrant dans ce cocon d’existence qu’on appelle la pensée avec cette lucidité de se dire que le vécu est bien au-delà du pensé et que vivre est ce qu’il y a de plus difficile; c’est là que tout se joue : ne jamais être totalement à la hauteur, s’apparaître dans sa lâcheté constitutive qui vous fait fuir ce qu’il faudrait regarder en face; et on le sait bien … » (p.35)
Un ton de grave fraternité (tous les chemins sont ouverts, mais c’est le Tout qui s’arrête à chacun de leurs bouts) et de sereine compassion (c’est un devoir, pour toute évanescence, de pardonner à celle des autres) fait enfin la force d’un prodigieux livre d’oubli – que l’on n’oublie plus :
« Je me souviens du personnage de Joyce, dans Ulysse, à qui l’on demande qui est Dieu ? Sa seule réponse : un cri dans la nuit. Cri certainement d’épouvante de celui qui soudain comprend qu’en dérangeant la nuit, il inventa la mort » (p.23)
Cinq sobres et intrigantes illustrations (de Jean Naudin, le célèbre psychiatre- phénoménologue de Marseille) viennent moins orner le texte qu’accompagner les efforts de son auteur, et nous rendre plus clair non ce qu’il dit, mais ce qu’il approche et tente. Et cet accompagnement empathique est aussi soutien, et comme compensation : là où ce texte dit quelqu’un qui va s’absenter, qui n’est pour ainsi dire plus là, chaque trait de ces images paraît, lui, venir dire : je suis là, je viens pour prendre part à la présence. Et là où Néel affronte souvent la décomposition (de l’espoir, de la disponibilité, de la sauvegarde), la « composition » des images de Naudin (ici, un visage né de justesse, là une sorte de porte de terre ou d’écorce suspendue, là encore une eau remontant sa chute et l’ingénieux contournement d’un brouillard) vient rappeler que même la décomposition suivait un ordre, et que les tensions de la solitude, parce qu’elles-mêmes viennent du monde, pourraient y ramener. Ici, la création picturale, comme la littéraire, rappelle, avec douceur – et peut-être même joie – que si, comme on dit, elle vient « de rien » (de rien de connu ou d’équivalent en tout cas), précisément parce qu’elle ouvre ce rien jusqu’à nous (comme disait Maldiney), elle n’y retourne pas (et nous l’épargne au moment même où elle nous y expose). L’irradiation de l’art, c’est vrai, va elle-même « au hasard, comme elle peut », mais ne fait jamais machine arrière : ce qu’on en surprend avance !