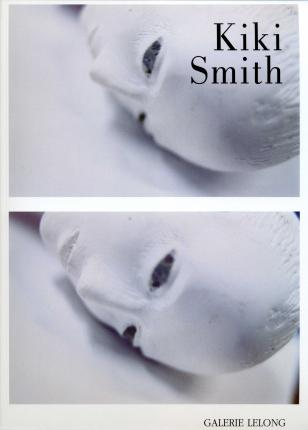-
Santiago Montobbio, LA POESIA ES UN FONDO DE AGUA MARINA. Editions Los Libros de la Frontera, Collection « El Bardo », 2011.
Le recueil de Santiago Montobbio contient une sélection d’environ deux cents des poèmes qu’il a écrits en 2009, lorsqu’une vague créative impérieuse lui a imposé plusieurs centaines de textes en quelques semaines. Grâce à cette importante sélection, le lecteur peut désormais se rendre compte des inflexions nouvelles et des constantes dans les grands thèmes de la poésie de Montobbio.
On sera d’abord touché de lire sous la plume de Santiago Montobbio les mêmes déclarations manifestes que dans les années 80 sur l’importance fondamentale, existentielle, de la poésie (« Si j’abandonne la poésie, j’abdique ma condition d’homme »), sur sa nature ésotérique (« La poésie est clandestine / elle doit s’écrire dans la solitude et en cachette ») et sur le curieux paradoxe de l’inutilité absolue d’une activité aussi vitale (« Il n’y a aucune différence entre ma vie et mon silence / et mes paroles. Dans mes poèmes et dans leur absence, que j’ai peut-être / soutenues, je suis tout entier présent »). Montobbio le rappelle fréquemment : on ne choisit pas d’être poète, on n’écrit pas comme on se rend à son travail quotidien, la poésie vient un jour comme une grâce et rien n’arrête sa coulée et les œuvres qu’elle laisse en dépôt.
Après vingt années sans poèmes, Santiago Montobbio a retrouvé une voix, et il n’est donc pas étonnant qu’il contemple le retour de son art avec une fascination étonnée. Les poèmes de 2009 sont souvent des vignettes brèves sur des objets ou des scènes immédiats, quotidiens, que le poète voit ou vit, et auxquels il cherche à donner un sens.
Si rien dans ce quotidien n’est anodin, ce qu’y voit le poète n’est pas forcément ce que tout un chacun y voit. Les poèmes de La poesía es un fondo de agua marina sont, bien plus que les textes plus anciens de Montobbio, localisables dans la Barcelone que le poète habite depuis toujours. Des rues, des quartiers, des immeubles célèbres sont fréquemment cités, mais l’auteur nous prévient que sa Barcelone lui est propre, voire qu’elle est invisible, et que ce serait une erreur de vouloir la chercher dans les lieux réels. Ce n’est pas tel ou tel immeuble construit par l’architecte Gaudí qu’il évoque (« Je ne suis jamais monté sur le toit de la Pedrera »), mais le petit café au sol de planches qui en occupait jadis le rez-de-chaussée et où il allait prendre son café à l’adolescence. Toute chronologie a disparu, et les évocations de Montobbio sont autant le taxi pris le jour même qu’une remarque faite il y a 35 ans dans le cercle familial par un parent mort aujourd’hui (« Nous sommes peuplés par les phrases / et les expressions que nous écoutons / et qui nous accompagnent depuis notre naissance, / par des gestes, par des silences, par des oublis, par des saveurs / et des affections qui sont au fond de nous-mêmes »). Toute chronologie a disparu, puisque ce qui compte, c’est la force de l’impression, celle qui permet l’évocation, d’autant plus prégnante qu’elle est mystérieuse.
Même si les questions ontologiques qui se posent à Santiago Montobbio le torturent moins, même si l’on trouve dans le recueil quelques poèmes nostalgiques de la foi innocente et naïve de l’enfance du poète et de son milieu d’origine, même si Dieu n’est plus comme jadis l’un des noms du vide, le doute et l’ironie métaphysiques sont toujours chez Montobbio des thèmes majeurs. La tentation du suicide, le sentiment du vertige, la solitude, l’absurde sont toujours présents, mais ils sont traités de manière plus sereine, plus apaisée. Pour un poème qui proclame que l’enfer est vide, pour un autre qui se conclut sur le verdict « L’âme est seulement dans les mots », un troisième fait confiance à Dieu pour donner à l’homme un destin. On a même parfois l’impression que les objets sur lesquels Montobbio s’appesantit, les bicyclettes, les bouteilles, les extincteurs, les boîtes à lettres, prennent une force de témoignage sur l’existence d’un grand horloger qui n’a pas pu créer un univers totalement absurde. Si le poète de 20 ans côtoyait l’insupportable et le regardait fasciné, le quadragénaire d’aujourd’hui a adouci son regard et sa passion et reconnaît l’importance du biologique (les mots semilla (la graine) et latido (le battement du cœur) reviennent sans cesse) pour la vie.
©Jean-Luc BRETON