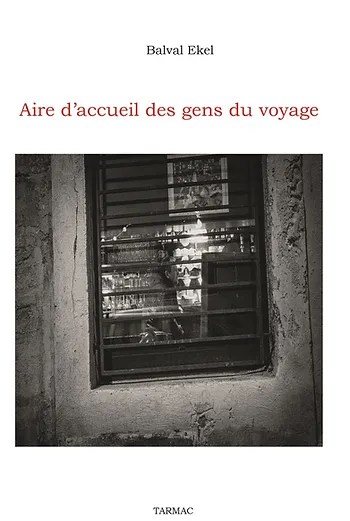Une chronique de Lieven Callant
Natalie Diaz, Quand mon frère était un Aztèque, When My Brother Was an Aztec, édition bilingue, Édition des Lisières, 205 pages, 2020, 22€.
Le premier poème ne donne pas que son titre au livre, il donne aussi le ton, le rythme et préfigure les thèmes qui seront évoqués avec force, ironie, intelligence. La poésie de Natalie Diaz sertie d’allusions littéraires, politiques ou historiques dénonce, provoque, raconte sans jamais devenir un simple slogan ou un pamphlet.
Rien n’est simplement vécu puis transformé en récit, en histoire, rien n’est purement et simplement imagé. Le poème et son écriture prennent part à la vie, se nouent à elle par les sentiments et les émotions qu’elle provoque. Haine, amour, peur, doutes et certitudes. Les poèmes deviennent presque la traduction littérale d’une blessure faite à tout un peuple, hommes, femmes et enfants sur plusieurs générations.
Natalie Diaz est née et a grandi à Needles dans le village Indien de Fort Mojave, en Californie, sur les rives du fleuve Colorado. Elle est Mojave et travaille en tant que directrice de Fort Mojave Langage Recovery Program avec les derniers locuteurs de langues Mojave. Elle est également professeure à l’université d’État d’Arizona.
Le titre fait allusion non sans humour à la méprise totale par les colonisateurs des spécificités culturelles, sociales, spirituelles de chacune des populations qui habitaient le continent américain, une confusion qui célèbre volontiers les aspects violents, négatifs au détriment de la nuance, de la beauté ou de la justesse.
Diaz répond aux clichés par d’autres clichés qu’elle a joyeusement retravaillés pour qu’ils nous prennent à la gorge. Par exemple les textes: L’évangile selon Sans-Cheval, Mary de la réserve, ou La dernière Barbie Mojave.
Les dieux aztèques mi-homme, mi-animal réclament sacrifices sanguinaires avec violence. Le félin aux griffes acérées, aux crocs saillants avec des ailes sur le dos, représenté sur la couverture du livre fait partie de cet univers fantasmagorique et fantastique auquel se réfère régulièrement l’auteur, en faisant de multiples référence à l’oeuvre de José Luis Borges (Le tigre bleu) ou à celle de Federico Garcia Lorca.
Le frère est tour à tour une sorte de démon quand il est sous l’emprise de drogues (méthadone), ou un enfant troublé, perdu, blessé. Cette auto-destruction du fils ainé se fait l’écho d’autres destructions imposées aux peuples natifs du continent américain: Les prisons à ciel ouvert que sont les réserves laissent peu d’espoir. La pauvreté, le chômage, la ségrégation, le racisme sont des armes de destruction massive infligées comme un venin aux peuples autochtones qu’on a sciemment déracinés. Le véritable dieu sanguinaire et tyrannique c’est l’impérialisme colonialiste et capitaliste, son idéologie consumériste et individualiste. L’appétit du monstre ne connaît pas de limite.
Il y a dans les textes de l’auteur une force brute sans artifice, créatrice qui transforment la violence subie, la souffrance, les blessures en oeuvres d’art, en mythes, en contes ou légendes.
Certains poèmes deviennent presque intraduisibles tant le message est prenant, pressant d’où l’intérêt de cette version bilingue. Entre les lignes se partagent un sentiment de révolte, un sentiment d’acceptation et d’amour. En écrivant, on choisit, rien n’est imposé, ce choix est la liberté sur laquelle Natalie Diaz construit, pour elle et pour ses lecteurs.
Naturellement persiste ce qui ne guérit jamais et meurt, ce qui nous rend tellement étranger à l’autre et qu’il ne comprendra jamais. Une étendue désertique, un fleuve, une langue. On ne cherche ni l’oubli, ni le pardon. La réconciliation, la reconnaissance sont encore et toujours hors de portée.
« L’histoire a les lèvres gercée, on ne peut l’embrasser sur la bouche « P45

L’ombre du frère toxicomane plane sur tout le livre à la manière de ces dieux aztèques, à la façon d’un fantôme, d’un Minotaure. La vie est l’une de ces fêtes des morts mexicaine, un labyrinthe, un carnaval auquel sont conviés en tant qu’animaux de cirque, les autochtones. Leur participation dans la vie publique n’est pas prévue sauf peut-être après assimilation par le monstre. Peut-on s’extraire du labyrinthe? Pas vraiment.

Un sac de jute plein de tigres se débat dans nos poitrines –
ils martèlent, traquent nos coeurs, érigent une prison
de leurs rayures. Chaque queue une mèche. Chaque oeil une cendre.Poitrine traduite par bombe.
Bombe devenue chanson –la plainte rongée de honte du tambour.
La toile de jute n’est pas faite pour les prières ou les mains.
La réserve n’est pas faite pour une jungle.
Mais nos ventres grondent. Quelque part en nous
se trouve un roi, et quand nous le trouverons…P65
Ayons en tête aussi ce qu’a écrit Jorge Luis Borges:
Le temps est la substance dont je suis fait.
Le temps est un fleuve qui m’emporte, mais je suis le fleuve ;
c’est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre ;
c’est un feu qui me consume, mais je suis le feu.
Hier est bien plus proche qu’aujourd’hui-
baïonnette noire portée entre les omoplates
comme une démangeaison ou le bourgeon d’une aile P66Ses yeux ont des larmes vides. Sa bouche, un O sombre.
Encore stupéfait de ce qu’est devenue sa vie.