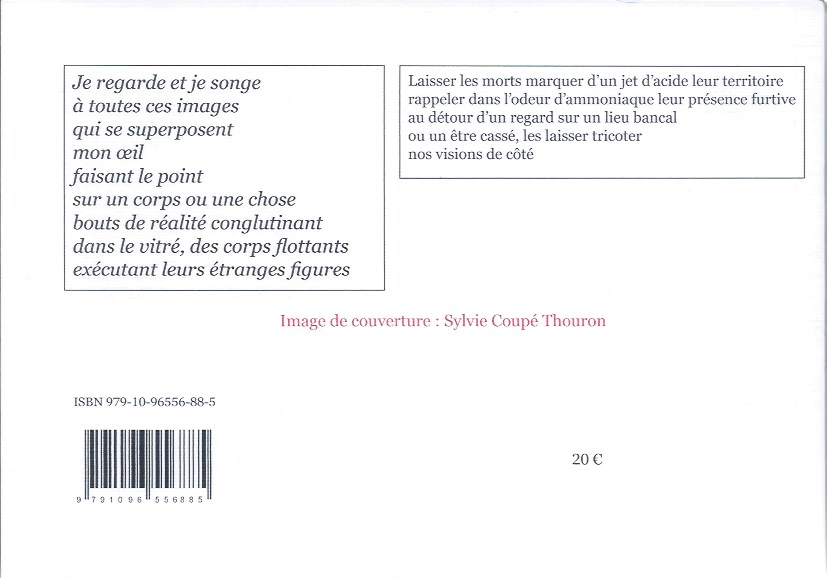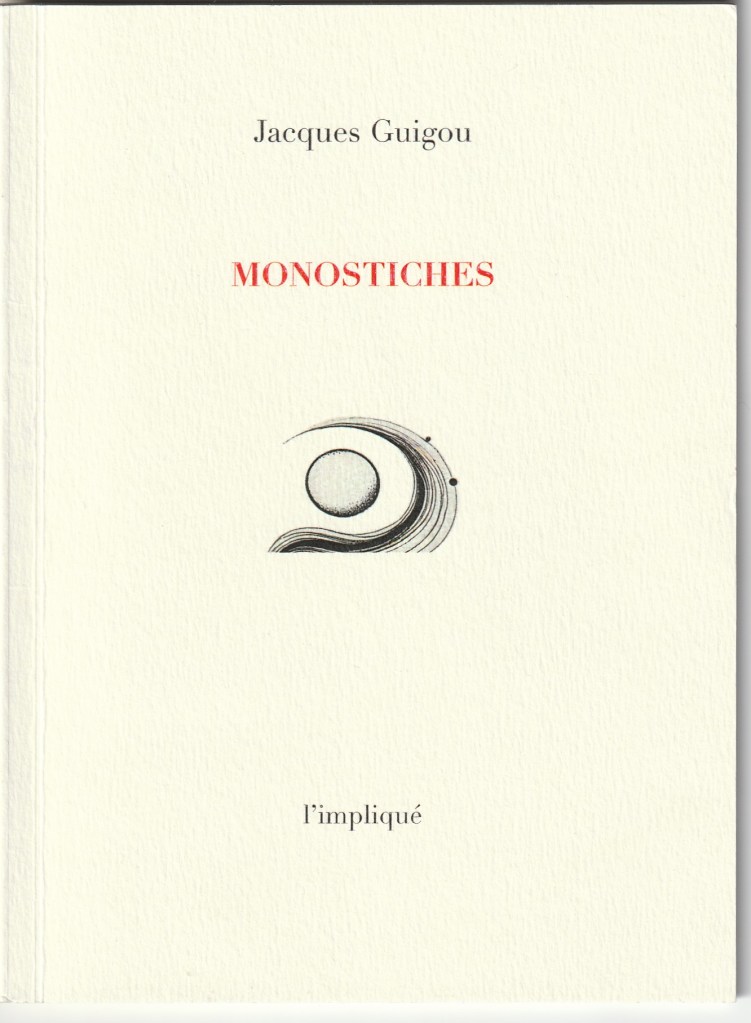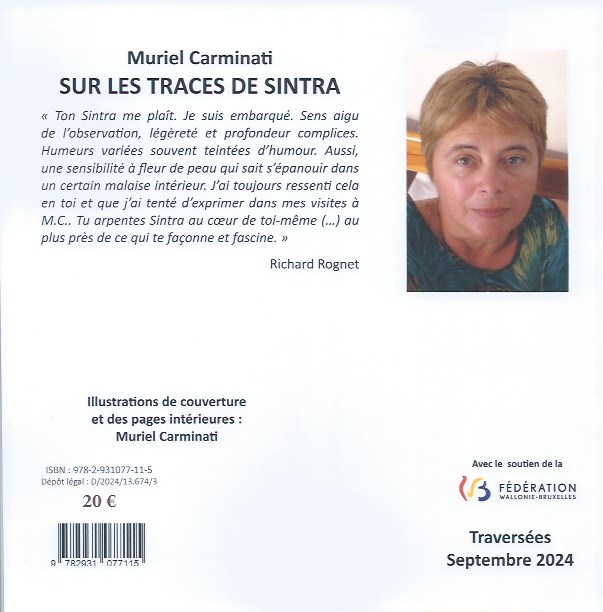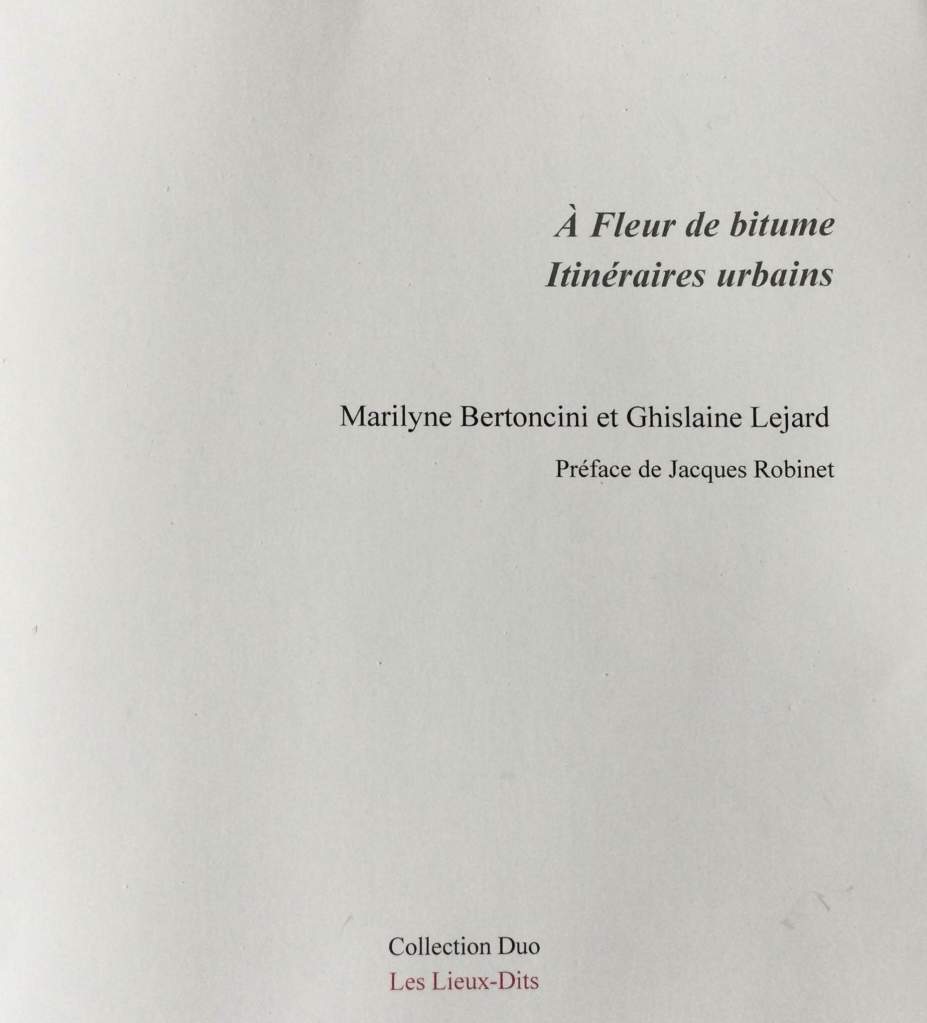Une chronique de Lieven Callant
Murièle Modély, Des figures et des corps, Tarmac Éditions, 99 pages, 20€, Image de couverture: Sylvie Coupé Thouron, préface de Christine Saint Geours.
Sur la couverture, un personnage marche en nous tournant le dos et se retourne une dernière fois pour regarder ce qu’il quitte avant de regagner quelques troncs encerclés par la nuit. Cette forêt étrange, cette étendue de terre ocre, les quelques traits de crayon pour signifier des herbes, des ombres me font penser à l’épiderme, surface sensible et dernière frontière matérielle du corps. Le personnage n’a pas de visage et pourtant on sent qu’il est plus qu’une figure.
Est-il question de limites? De seuils de tolérances ? D’ultime frontière ?
Tout au long de ce livre, il est fait référence à un carnet blog. L’auteur questionne, analyse sa propre écriture en devenir. Les figures deviennent alors la forme qui s’impose à l’écriture: le style ou ce qui forge le style et qu’on applique au corps du texte. Afin qu’il ne se résume pas à une structure vide, l’écriture a à chercher ses racines dans la vie quotidienne. Ce que tente de révéler Murièle Modély est l’ étroit et invisible lien entre l’oeuvre écrite et l’oeuvre de la vie. Ce qui touche, se rapporte à ses pensées, touche immanquablement son corps. Et ce qui blesse le corps, blesse l’écriture.
Dans la première partie de ce livre dédié à son père, la figure est la répétition. La répétition en miroir. L’utilisation d’images qui se font écho. Les crabes pour une maladie qui ronge l’intérieur. La sensation, le sentiment, l’expérience intime de la maladie se heurtent à la cécité du docteur. Comme s’il devait exister et perdurer une imperméabilité entre les deux couches de vie. Comme s’il fallait ainsi conjurer la maladie, la mort.
le docteur persiste et signe: tout est dans votre tête
d’accord, mais que veulent ces bêtes, poète? P12
la bête ne se cache-t-elle pas depuis toujours
sous les quatre lettres de la peur?P15
Dans cette histoire de bêtes
chaque patient vient
avec son monstre
qui son crabe
qui sa méduse
qui sa raie mantra P24
Pour vivre, il nous faut nos figures, trouver une parade à ce qui ne se contente pas toujours d’une réponse claire et unique, à ce qu’on refuse d’accepter, à ce que l’on peine à digérer. C’est donc avec une infinie pudeur, guidée par une écriture venue des profondeurs de la vie émotionnelle que le livre s’écrit et ne cesse de s’ouvrir à l’autre.
Le reste du livre à travers diverses figures (énonciation, paratexte, palimpseste, points de vue) cherche à exprimer le plus lucidement, avec une réserve respectueuse, la mort. Pas n’importe quelle mort. Celle qui survient après s’être annoncée par la maladie. La mort qu’on refuse et qui pourtant frappe l’être que l’on aime. Un père, son père.
« Quand papa est mort
je n’ai pas touché sa joue
je n’ai pas mouillé son visage
je me suis juste tenue
tout au fond de la salle
comme lui raide
et froide
moi debout
lui couché » P45
À partir de cette expérience, énoncer la vie, écrire, fait partie d’un processus jalonné d’efforts personnels, intimement liés à ce que nous sommes et que la maladie, la mort nous enlèvent malgré nous. Ce lent et difficile parcourt traduit celui d’écrire un livre. À moins que ce soit l’inverse, l’exigence de l’écriture rend la vie invivable parce qu’elle n’est souvent pas capable de contourner les écueils. Dans ce qu’elle montre de nos structures sociétales, corps parfaits, bonheurs lisses, la vie ne fait plus de place pour la mort. On est invité à faire son deuil en silence, à gommer la maladie, à ne pas voir la souffrance, à ne pas reconnaître les états de faiblesse comme autant de moments indispensables.
« le temps est un élastique tendu
une droite où un pointne rejoint jamais l’autre
où hier est aujourd’hui
le jour d’après »« la mort pourtant c’est toujours
prendre une profonde inspirationet tout relâcher » P49
Ce parcourt nous interroge sur ce qui s’impose à nos corps. Les figures ne sont plus les phares éclairant une possible route mais au contraire des structures imposées, loin de permettre une liberté et la place nécessaire pour être soi et non pas une figure de plus dans un corps anonyme.
« Des figures et des corps » me pose aussi la question de ce qui est supportable, acceptable. La perte d’un être cher ne l’est pas. Malgré ce qu’on veut nous faire croire, on n’oublie pas, jamais. Que la mort soit brutale, suite à un accident, paisible ou violente, conséquence dictée par une longue maladie, agonie ou suicide. Cela ne veut pas dire qu’il faille s’enfermer dans le chagrin, refuser la vie. Au contraire, Il faut se surpasser.
L’écriture poétique pose les mêmes exigences: elle demande à ce qu’on se surpasse, qu’on aille au-delà de certaines limites. Cela implique parfois de ne pas tenir compte des injonctions, des gentils conseils, des habitudes sociales.
Au delà des mots, entre les lignes, j’ai cru lire une injonction qui prône un puissant respect et je me suis sentie l’envie d écrire en bas dans la marge « au delà de ce que disent les faiseurs de poèmes, tu te laisses à être toi-même » et c’est ce que fait cette poète avec infiniment de dignité et d’élégance.
« tu songes que tout tient dans la paume
chiffonnés en boulele mouchoir
la douleur
ton recueil
le corps rigidifié » P63« la réalité nous sidère
si souvent
que les mots échouent
à dire nos désordres »P70
À la page 66, on peut lire:
« Dans le carnet blog, j’avais relevé ces mots d’un autre blog: « L’interprétation de la poésie est semblable à celle du rêve. Elle se fait à partir du texte du poème. Elle vise bien à y comprendre quelque chose. Mais ce quelque chose n’est pas ce que dit le poème. » Ces mots que je comprends à peine, dont je ne connais ni l’auteur, ni la source, dont le sens s’approche dans sa dérobade même.
Tout dans ce livre est subtil, élégant, puissamment pensé et écrit. La préface de Christine Saint Geours et l’illustration de couverture de Sylvie Coupé Thouron nous en donnent un parfait avant-goût.