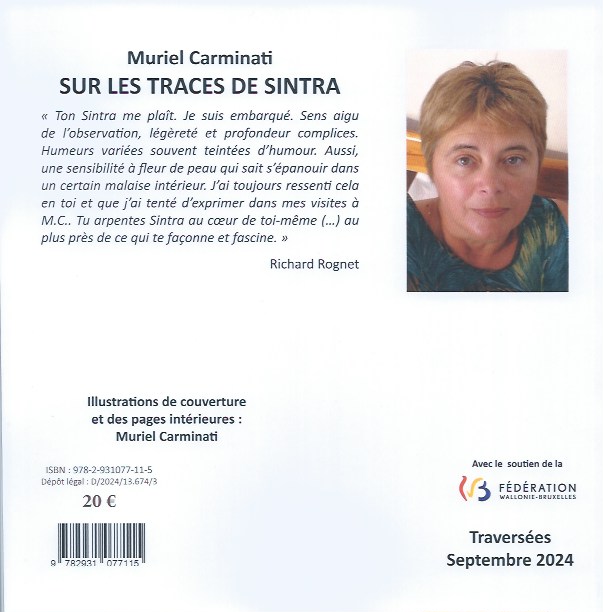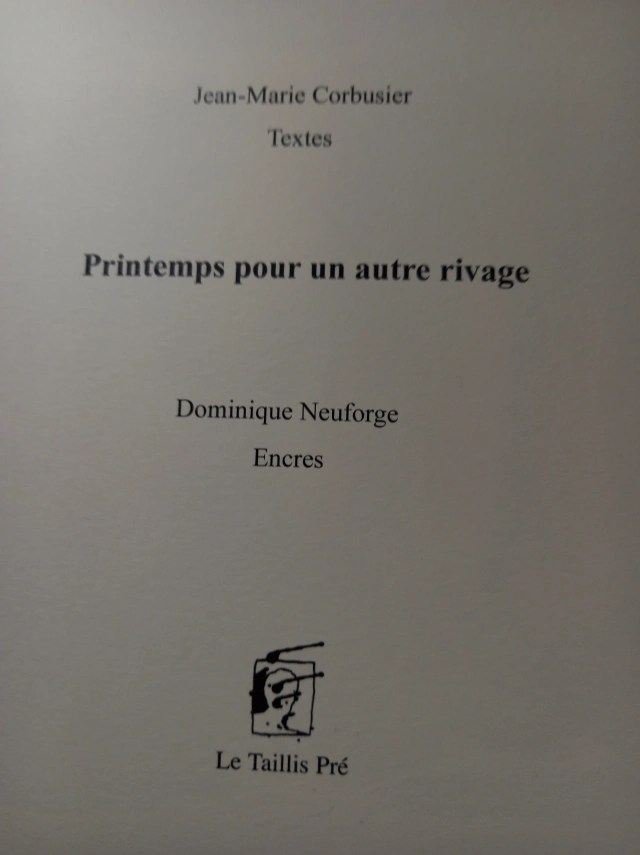Une chronique de Marc Wetzel
Michel LAMART, Fragments d’absolu, Cahiers du Loup bleu, Les Lieux-Dits, poème en douze parties sans pagination, 2024, 7 €
Qu’un poète contemporain intitule son recueil « Fragments d’absolu« , même si cela n’est pas une mystification (« absolu » est ici sans majuscule, et ce n’est donc pas un Principe inconditionné unique et universel, auquel personne ne croit plus, dont on prétendrait présenter ici extraits ou échantillons), reste une provocation. Ce terme d’absolu, qui suggère beaucoup sans incarner grand-chose, ne se dit désormais plus qu’en adjectif – pour signifier qu’une institution fixe elle-même ses propres règles d’exercice (« pouvoir absolu »), qu’une chose vaut sans restriction ou à tous égards (« valeur absolue »), ou qu’une fonction saisit son objet en lui-même sans devoir le comparer à un autre (« oreille absolue ») – mais « absolu » ici ne fait que qualifier l’emploi, la portée ou le sens d’une chose qui ne prétend pas du tout, elle, être l’absolu : un pouvoir, une valeur ou une oreille qui se voudraient l’absolu feraient rire, crier ou compatir. Pourtant, dit Michel Lamart, il y a de l’absolu en certaines choses : une goutte d’eau (car elle est purement elle-même et pourtant pareille à toutes les autres), un fruit (car il contient à la fois ce qui l’a permis et ce qu’il permet), l’encre (qui est à la fois le sang des signes d’imprimerie, et le signe d’un monde vidé de ses chairs brouillonnes et de leur sang tenace) …
« À la goutte
La goutte seule ressemble
(Ici flaque d’absolu) » (…)
« La substance absolue
Eau et pain mêlés
Telle l’offrande du fruit
Dans la sobriété du don
Dans l’extase de la passion » (…)
« Ah ! transfuser
En mes veines
L’encre qui me fera
Signe
Vidé d’un sang
Sans descendance
Et d’une mémoire
Échappée au bordel
Sociétal
Tel un caillot d’oubli » (11)
L’auteur ne se (donc ne nous !) raconte pas d’histoires : si « absolu » se dit positivement ou favorablement de certaines choses, puisqu’il est l’inconditionné – l’absolu est le détaché, le dégagé du reste, donc aussi le laissé libre, l’indépendant ; l’absolu est l’absous, l’acquitté de toute imputation, donc l’insoupçonnable, l’éminemment respectable; enfin l’absolu est le complet, l’achevé, donc ce qui fait sens par lui-même et forme assez totalité pour s’auto-suffire … il est aussi, envers de médaille, puisque pour les mêmes raisons, l’indéterminé – son indépendance est un enfermement, une asphyxiante auto-incarcération ; sa façon de ne dépendre de rien d’autre fait de lui une réalité intransigeante, non-négociable, omniconditionnante, ne supportant aucune réserve, n’accordant aucune concession, fermée à toute nuance; enfin son indépendance à l’égard de tout repère le rend logiquement insaisissable, c’est-à-dire bien sûr : à l’existence indécidable, voire contradictoire (puisque toute existence le riverait aussitôt à des conditions d’existence, spatiales, temporelles, causales etc.) :
» L’absolu
Sans lieu
Ni temps
Pure allégorie
De soi inscrite
Dans le miroir mort
D’une icône » (4)
Le poète, ici encore, y va fort (et y vient vrai !) : « sans lieu ni temps » constate que tout emplacement déterminé ou tout écoulement propre attribués à l’absolu le dissiperait ou corromprait aussitôt : mais ce qui est sans place est sans forme, et ce qui est hors-durée n’arrive jamais (quelle beauté prêter à ce qui est sans forme ? quel bien attendre de ce qui ne peut se produire ?); « pure allégorie de soi » signifie qu’un absolu ne peut jamais être objectivement distingué de sa représentation – image ou tableau – et donc qu’on peut toujours le soupçonner de n’être rien d’autre que cette image ou ce tableau ; « miroir mort d’une icône » rappelle cruellement que l’icône d’un être divin est censée être elle-même l’oeuvre de cet être, nous regardant le regarder – mais « miroir mort » indique que rien de vivant ne se trouve dans ce regard absolu prétendûment posé sur nous. Tout ceci semble condamner sans appel toute possibilité (et toute requête) de présence absolue, et Michel Lamart, pourtant, maintient son exigence dans la parole seule capable d’elle qu’est la poésie :
« Ta dureté minérale
Balise des chemins
De parole
Qu’on n’écoute pas
Qu’on n’écoute plus
Convaincus que le sens
Nous est interdit
Et cependant
Si nous nous égarons
À ne les vouloir suivre
Nous nous perdons
En nous-mêmes
Là où la mer
Les fit sable » (11)
Pourquoi donc continuer à chanter – même fragmentairement – l’absolu ? D’abord parce que l’absolu fait forcément cercle, puisqu’il s’engendre lui-même, et inclut tout ce à quoi (et tous ceux à qui !) il échappe. L’idée précise est chez Comte-Sponville (« Que nous n’y ayons pas accès – sinon relativement – n’empêche pas qu’il nous contienne« ), et déjà Pascal jouait des deux sens du verbe français « comprendre » : ce que nous ne saurions pas comprendre ne peut que nous comprendre (car c’est l’avance même de son ampleur qui fait le retard de notre accueil en retour) . Mais le Tout réel ne « voit » que lui-même !
« Cercle de l’absolu
Ni origine
Ni but
Ni départ
Ni arrivée » (12)
« L’absolu
C’est ces yeux
Dans le ciel
Qui regardent
Sans me voir » (7)
Mais si le Tout ne voit logiquement que lui-même, et est aveugle à ce qui le constitue (et sourd à ce qui participe à lui ?) – d’ailleurs un Absolu soucieux de ses ingrédients serait aussitôt conditionné par eux ! -, ceux qui, sans rien en attendre, considèrent le Tout, le contemplent, le célèbrent sans jamais céder à la tentation de la prière, et tels sont les poètes, ne sont-ils pas déjà dans l’illusion ? L’absoluité du Tout est peut-être une apparence, ou la simple conséquence (et non la cause) du fait que tout accès à lui est relatif. C’est alors nous qui absolutiserions le Tout du réel, rêvant (comme Job, cité par l’auteur, XIX, 23-24) de pouvoir graver en un Absolu l’effacement même de nous qu’il opère, ou imaginant (comme dans la démultiplication des pains et poissons par Jésus en Mathieu XIV, 19, passage également cité) qu’un Maître des créatures pourrait par lui-même produire ce qu’il vient leur ajouter. Mais le langage humain n’est-il pas lui-même un démultiplicateur indéfini de signes et d’énoncés, et si « l’absolu est en nous » (1), la transmutation poétique n’est-elle pas un prodige accessible au courage inspiré, « changeant ainsi en or la cendre de nous-mêmes » (id.) qui nous conduisait. Les mots humains savent viser ce qui est hors d’eux, et l’on peut, alors, dans une certaine mesure, faire dépendre d’eux l’accès à ce qui nous échappe :
« L’absolu
Mémoire de ce qui pourrait
Advenir si les mots
Épaulaient la volonté
De viser l’inaccessible » (3)
Le langage, c’est vrai, nous conditionne, et notre refuge dans le langage peut mutiler. Mais la poésie est justement cet art dans lequel l’esprit peut jouer de sa propre dépendance à la parole. Elle peut faire évoluer ce que la langue peut pour nous. L’absolu, c’est vrai, nous confronte à l’exclusive présence du Tout, et cette présence nous diminue à proportion, nous abolit – en tout cas (c’est sa fonction !) nous relativise ! Mais la poésie, justement, nous permet de n’être que langage face au Tout, et (dit extraordinairement notre poète) dans sa parole, l’universel a, en quelque sorte, trouvé son « organe » :
« L’absolu confronte l’être
Au vide de soi
Les mots alors
Occupent tout le corps
Et font de la langue
L’universel organe » (11)
La poésie est ici le simple pari que le Tout, nous entendant parler sa langue, ne retienne enfin plus la sienne. Et vive de s’en sentir lui-même « changé »! Et, nous contenant, nous fasse vivre de son changement même ! Trois courts quatrains de la dernière partie (12) de cet étonnant recueil semblent bien l’oser :
« Aller au bout
De soi pour renaître
Indéfiniment
Autre
Attendre sa mort
De pied ferme
Dans le vide
Où s’écrit le po&me (…)
Alors tel
Qu’en lui-même
L’absolu en serait-il
Changé ? »