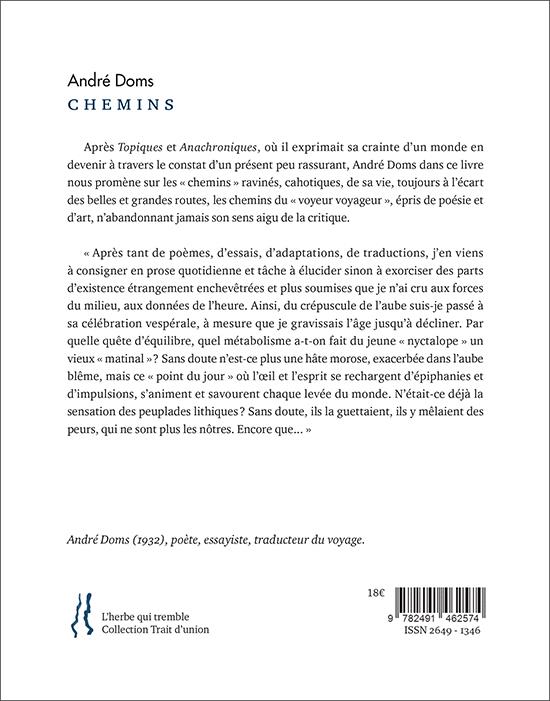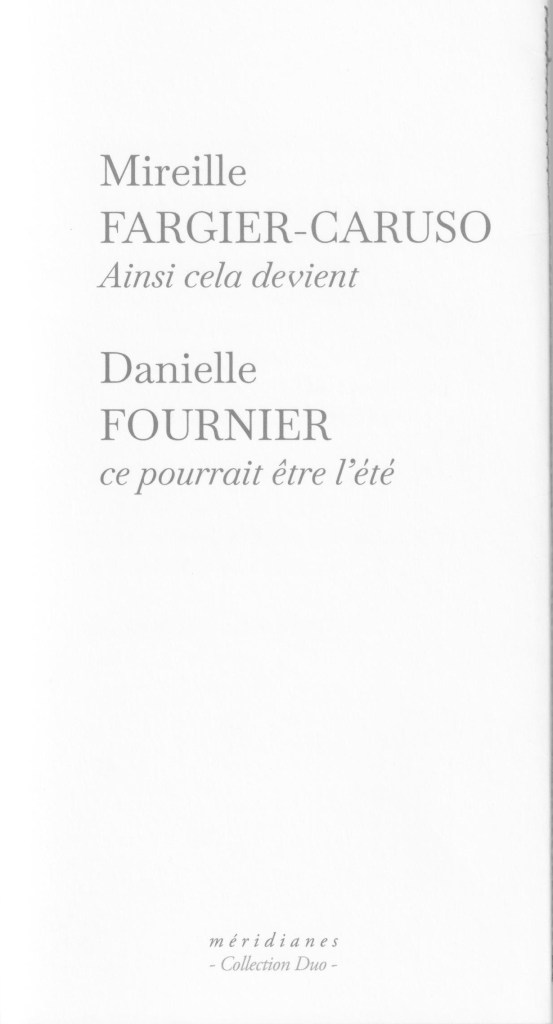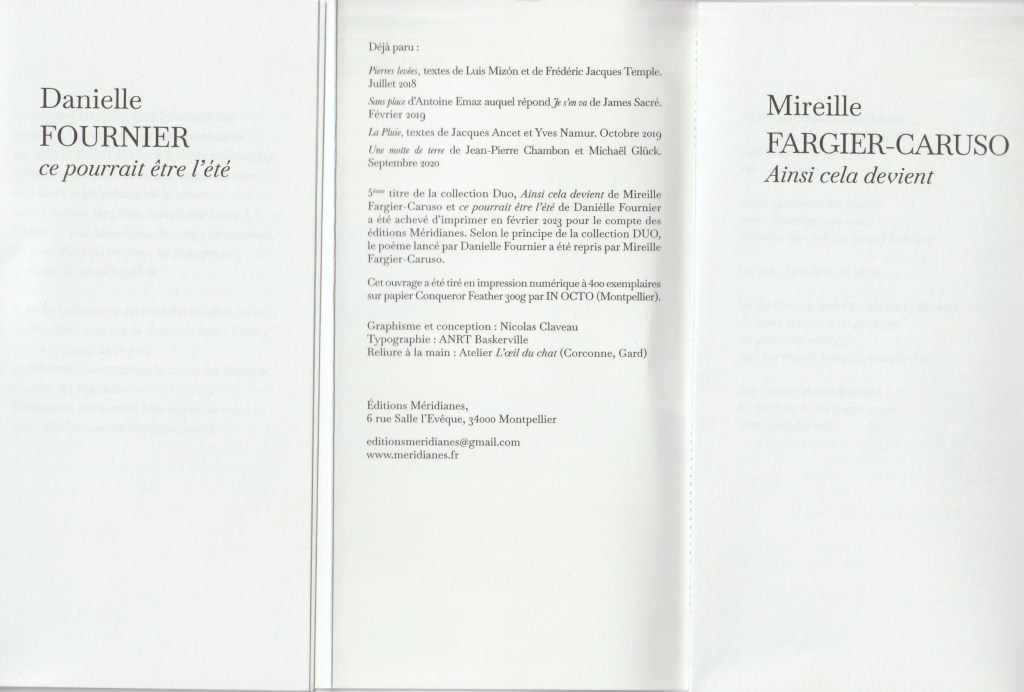Une chronique de Sonia Elvireanu
Michel Herland, L’Homme qui voulait peindre des fresques, Paris, Andersen, 2023, 136 p., 14,90 €.
Michel Herland, Peintre du social et de l’exotique
Le nouveau recueil de poèmes de Michel Herland L’homme qui voulait peindre des fresques dévoile par son titre une intention poétique. Car le poète est aussi bien le peintre du social que du paysage tropical. Parfois sarcastique, il peint le Monde sans concession. L’humanité est la même partout, les faibles sont exploités, manipulés par des puissants qui s’enorgueillissent de leurs richesses. Ce qui n’empêche pas d’apprécier les beautés de la nature, plus douce ici, dans les paysages provençaux que là, sous les tropiques où éclate la somptuosité des couleurs. Le recueil est divisé en plusieurs parties censées aider le lecteur à se repérer entre les divers genres que cultive le poète : social, exotique, érotique, ou simplement fantaisiste.
Le poète lève le voile qui cache la misère, dénonce les aspects les plus cruels d’une société qui méprise, viole les droits, entretient le chômage, la pauvreté, l’humiliation, contraint à la migration, à la révolte :
« Parfois du fond de l’humiliation
un peuple relève la tête
il crie sa haine et son envie » (Nouméa Culpa)
Observateur impitoyable, Herland met en évidence le contraste entre les nantis, d’un côté, et les prolétaires, les migrants, les clochards, de l’autre côté, entre le luxe des uns et la précarité des autres : « le riche orgueilleux se régale », « trime l’ouvrier miséreux », « la finance se porte bien », « les puissants ne manquent de rien » :
« Orient régiments laborieux
Air pollué puanteur acide
Fourmi automate livide
Trime ouvrier miséreux
À Shanghaï le luxe s’étale
Maserati Lamborghini
Jambes étirées robes mini
Le riche orgueilleux se régale
Chômeur au visage fermé
Anpe bureau immonde
C’est le triste sort du vieux monde
Irrésolu et désarmé » (Le cac 40 caracole)
Il suffit de descendre dans la rue, d’ouvrir un œil attentif pour constater la cupidité, le pouvoir de l’argent, l’iniquité, l’indifférence, la violence, la cruauté, sans oublier les guerres absurdes dont l’homme ne tire aucune leçon :
« Faut-il remémorer la longue litanie
de notre espèce les terribles avanies
Guerres anciennes ou modernes
Péloponnèse ou Dardanelles
guerre de cent ans ou guerre éclair
guerre impériale ou coloniale
dans les tranchées ou dans les airs
les occasions ne manquent pas
de s’entresuicider »(Guerres et pandémies)
Nombre de poèmes dénoncent un mal qui semble s’aggraver avec le temps, peignant le visage amer du malheur qui se cache derrière les apparences :
« Nord ou sud partout des chômeurs
Perdus dans leur vie de misère
Ils ont renoncé au bonheur
Tout autour d’eux les désespère
Noirs ou pâles sont les migrants
Même s’ils sont toujours précaires
On les sait pleins d’espoir vibrant
Ils ne sont plus prêts à se taire » (Itali-ques)
La voix du poète est souvent grave, grinçante, révoltée, voire sarcastique comme noté plus haut, conformément à une intention clairement exprimée en exergue de la seconde partie, Amères destinées : « Ma poésie est une porte qui claque ».
Le poète est révolté par l’injustice, l’indifférence des riches face à la misère, l’humiliation des pauvres qu’il a rencontrées partout où il est passé mais il est aussi un peintre de paysages, ceux de sa Provence comme ceux de la Martinique où il est installé désormais. Il lui rend hommage dans le premier cycle de poèmes intitulé Tropiques. La beauté du paysage tropical, la végétation luxuriante, les villages et les petits ports, les pêcheurs, les barques colorées, les montagnes couvertes de forêts, enfin la grâce des femmes noires, ensorcelantes composent de véritables tableaux :
« Ô femme d’ébène
Arbre que soutiennent de solides racines
Fleur de ma passion
Dont la corolle gracieusement s’incline
À la douceur d’un soir
Que trouble quelquefois le chant du crapaud-buffle
Ô Négresse d’amour
J’aime quand tu balances
Les rondeurs de tes hanches
Tu me laisses effleurer
Le creux de ton échine
Et je vais m’enivrer
Des senteurs de la Chine
Ô fille d’Afrique
Tes lèvres au sucre de corossol
Ta langue suave comme une mangue
Ta bouche rose de porcelaine
Tes seins deux cocos de mon jardin
Tes jambes de bambou
Et tes bras les lianes pour m’attacher »(Le chant du crapaud-buffle)
Le paysage tropical incite aux délices de la passion, aux plaisirs de la vie :
« Quel étourdissement
Chez les tendres amants
Le désir brille dans leurs yeux
La soif des plaisirs merveilleux » (Au village de Sainte-Anne)
C’est ce paysage qui inspire les poèmes d’amour, leur confère un accent de vérité. Le lecteur sent l’attachement du poète à son île remplie de merveilles. La femme est peinte sous les traits d’une noire déesse, sensuelle, excitante, langoureuse – réelle ou chimère, qui sait ? – apte en tout cas à susciter la passion.
Michel Herland s’avère nostalgique de la poésie classique, de ses rimes et de ses mètres, de sa musique. Il semble avoir une certaine prédilection pour le sonnet. Il est résolu en tout cas à suivre sa propre voie, adepte d’un postmodernisme qui permet le mixage des époques, des styles et des langages. Il ne cache pas son attachement aux poètes d’autrefois dans Le Petit Manifeste qui ouvre son recueil. C’est ainsi que ses poèmes jouent sur plusieurs modes, empruntant parfois à l’air du temps, parfois à celui de temps révolus.