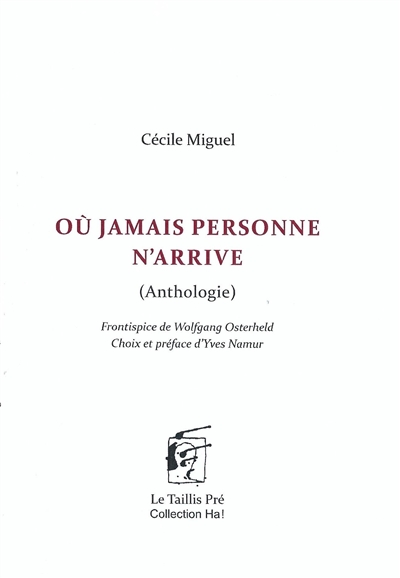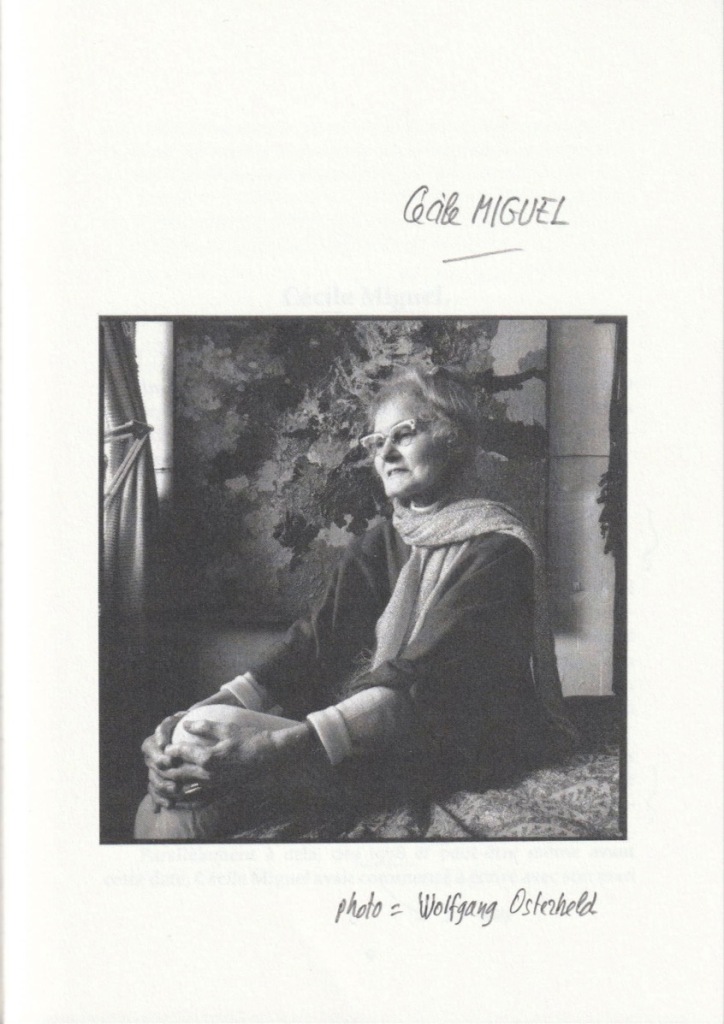Une chronique de Marc Wetzel
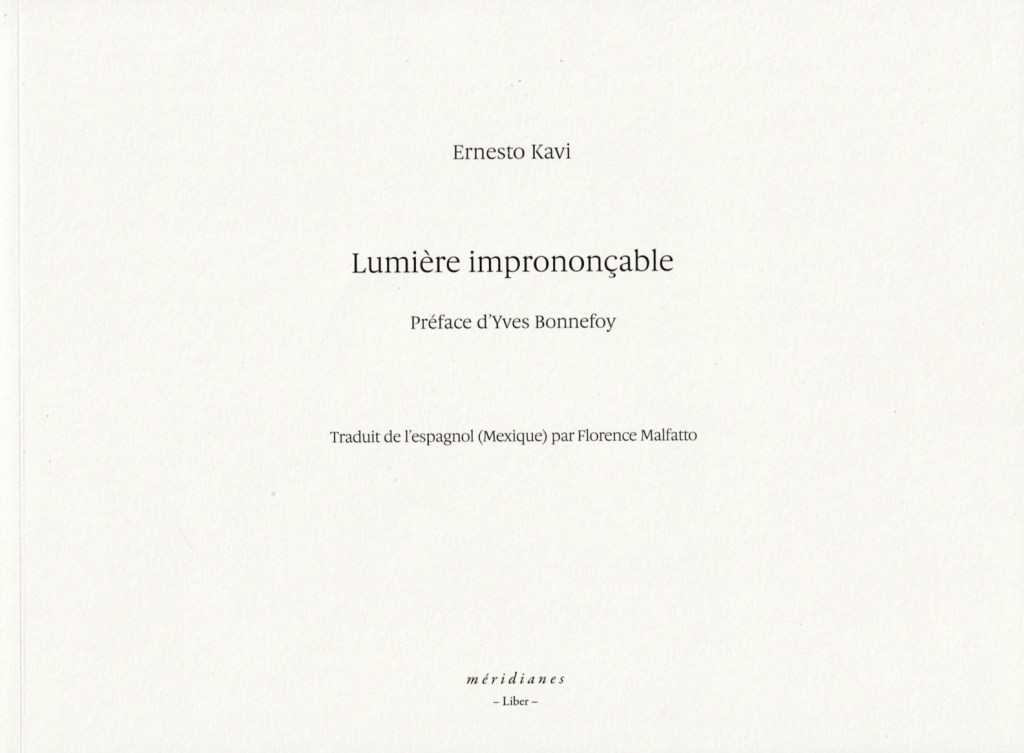
Ernesto KAVI, Lumière imprononçable, Préface d’Yves Bonnefoy, traduit de l’espagnol (Mexique) par Florence Malfatto, Éditions Méridianes, 72 pages, juin 2024, 15 €
On connaît le message déroutant et angoissé (« tout est vanité et poursuite du vent ») de l’Écclesiaste biblique. Le Qohélet qui s’y exprime et nous fait part de ses amères expériences de vie (« Qohélet » signifie celui qui parle à ceux qu’il assemble devant lui) nous exhorte à prendre conscience, comme lui, des mauvais côtés de l’énigme de la vie ! On s’est souvent demandé ce que venait ainsi faire (un peu comme le Livre de Job) dans le texte sacré un livre si manifestement fermé à l’espérance, et hostile aux pieuses effusions : après tout, à quoi bon respecter les lois de Dieu si vraiment la vie humaine est absurde ? Pourquoi se soucier d’un salut aussi « vain » que tout le reste « sous le soleil » ? Si chacun a, jusqu’à sa mort, son âme sur les bras, incertaine, fuyante et qu’aucune aide surnaturelle ne peut éclairer, cette âme même n’aimera Dieu que confusément, et ne le craindra que pleutreusement. Comment se satisfaire d’un bonheur ou se consoler d’un malheur l’un comme l’autre sans raisons ? Et, si vingt-trois siècles plus tard, un poète (mexicain, né en 1981, polyglotte et éditeur) reprend fidèlement le message, et vient faire chanter, à nouveaux frais, cette lucide amertume et ce lyrique désabusement, – et c’est exactement ce que ce recueil fait ! – à quoi bon ? Oui, à quoi bon ressasser ce message même de l' »à quoi bon », alors même que l’auteur nous y montre, lui, peut-être, une perplexité sans piété (si toute vie humaine est décevante, pourquoi estimer encore qu’un Dieu intéressant et bon nous l’aurait donnée ?) et une sagesse sans horizon (doit-on, au temps du dérèglement climatique et des guerres entre souverainetés également fichues, sérieusement « imaginer » – pour plagier Camus – « Qohélet heureux » ?).
Pour parler rudement, qu’est-ce qu’un poète actuel (même intègre, intelligent et humaniste) peut encore vouloir nous apprendre d’un tel message (oui, disait Qohélet, oui, « il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir; un temps pour lancer des pierres et un pour en ramasser; un pour déchirer et un pour coudre; un temps pour se taire et un temps pour parler … », merci du scoop ! …) alors même qu’une telle sagesse de pure et simple opportunité est périmée par la simultanéité forcée de l’interconnexion mondiale, et ridiculisée par notre fin même des temps ? Pourtant, l’auteur ici non seulement nous émeut, mais (comme le vrai poète dont parle avec éloge Bonnefoy dans sa préface) formule admirablement et pour tous la source même de l’émotion de vivre. Oui, tout est peut-être souffle, vapeur et buée, mais il est justement un temps pour le souffle (qui est celui de la vie !), et il y a un souffle pour la liberté même du monde (que nous ne pouvons chercher à réduire sans la relancer d’autant, et que notre propre anéantissement n’embarrasse ni n’altère) :
« Pour tout
il est un temps
mais la joie de l’homme
est sans fin
ne nous appartient pas
le souffle
et nul ne peut le retenir
nul ne peut rien
et le jour de la mort
est une guerre sans repos » (p.19)
On hésite à (naïvement, ou indiscrètement) commenter ce sobre chant d’une seule tenue et parfait. Les thèmes ne sont pas faits d’idées, mais qui lit ces douze chants se sent porté par les pensées qui les permettent : par exemple ici, tout a son temps, oui, dans le souffle même de son appartenance (locale et transitoire) au monde – mais deux choses en sont alors, par principe, épargnées : la « joie » qui n’est d’aucun temps (puisqu’elle est la plénitude même de l’occasion temporelle), et la « mort » qui exige et opère notre sortie même du temps (la mort coupe le souffle, comme le fait la joie). Reste seulement (et restera) le Souffle comme poussée universelle et naturelle de l’indéfinie succession des occasions. Bien sûr, tout destin personnel est naturellement perdant, et la mêlée des contingences est furieuse et sans issue ni répit (la perfection même suscite l’envie; n’est aveugle au mal que celui qui n’est pas né; chaque nuit « la souffrance de l’homme manque de paupières » (p.32) comme chaque jour son espérance a manqué d’yeux ; tout vivant est misère et violence puisque la vie exige de se poursuivre partout ailleurs pour permettre la sienne : il ne peut jamais y avoir respiration privée dans le Souffle universel, ni de quant-à-soi établi et serein dans le Tout s’advenant toujours d’abord, prioritairement et à son gré. Mais le Devenir est son propre souffle, et cela seul importe, puisque cela décide de toutes les futilités, et de toutes les importances …
Ce texte n’émeut si fort que parce qu’il sait formuler la vie réelle de l’expérience humaine, et suggérer que sa naturelle complexité n’est ni complètement opaque, ni fatale. C’est un chant qui a la douceur des méditations véritables, et la consolation de leurs nuances. Par exemple, oui, la vie qui finit perd tout d’elle-même, mais on ne perd que ce qu’on laisse aux suivants (car l’occasion d’être renaît en et pour eux), et il est même faux qu’on ne laisse aux suivants que ce que l’on perd : nous avons à gagner au jugement d’être, une fois morts, littéralement livrés à eux. Seul un être immortel serait sans juge extérieur, mais que saurait-il un jour définitivement de lui-même ? Que le sens d’une vie dépende de ses seuls survivants, et eux-mêmes mortels, est-ce si aberrant ou ruineux, puisque, dit étonnamment le poète, rien n’est fait pour dépendre sensément de soi-même ? Ce qui dépend des guerriers n’est que la guerre; des héros, ne dépend que leur vaillance; de la puissance, que ce qu’elle impose; de la sainteté même, que ce qu’elle peut pour d’autres, non ce que le surnaturel peut pour elle etc. L’accomplissement réel ne peut être seulement autonome, ni l’autonomie être par elle-même don et saisissement. « Exister, c’est dépendre » disait Alain, et si toute vie dépend du souffle de vie, celui-ci à son tour dépend du mystérieux ordre du monde.
» J’ai vu encore
sous le soleil
que ne dépend pas des guerriers
la paix
des héros
la victoire
ni des amants
l’amour
ni de ceux qui souffrent
la peine
ni des puissants
la compassion
ni des saints
la grâce … » (p.37)
Ernesto Kavi, justement, ose lui-même « rendre grâce », sans imaginer un seul instant que la grâce vienne de lui, ou puisse avoir source claire (si l’ordre du monde était sans opacité, que viendrait donc transfigurer la grâce ?). Grâce, c’est perfection venue d’ailleurs se donner (sa gratuite générosité irradie), sans interrompre ni embarrasser ce qu’elle anime (c’est la « facilité inespérée » de la grâce dont parlait Raymond Bayer, qui ni ne sue ni ne dérange, qui se moque bien de la comptabilité de ses pseudo-influenceurs, et qui ne requiert de nous, en retour, que la pureté de notre surprise !). Ainsi la grâce du printemps (imagine-t-on un printemps invasif, ou qui rechignerait à faire jaillir ce qui pourtant le périmera ? p.46), la douceur de la lumière (qui ne prétend jamais hypnotiser les yeux qui la captent), l’aménité du soleil (qui nous laisse préférer ce qu’il éclaire à ce qu’il est, p.48) nous sont suffisantes leçons d’amour.
Bien sûr, la grâce est peut-être aussi vaine que la sagesse. Ce poète n’exclut pas que le laborieux et désillusionné contentement du présent soit tout le seuil vrai, et qu’il n’y ait rien derrière la porte de la présence. Mais son chant toque, humblement mais résolument, à cette porte : il se signale (et nous signale avec lui !) aux conditions mêmes de la présence, quelles qu’elles soient, au cas où, et cette sagesse du « carpe diem » (saisis le jour, tant qu’il y a des jours !) conseille, tout simplement, d’étreindre ce qui est digne d’être aimé (« bois ses baisers », p. 53) avant qu’arrive « l’absence », qui mettra, elle, tout moyen comme toute fin à l’écart, oui : toute présence possible au rebut. Être n’est peut-être alors qu’un répit, mais qui souffrira du raccourcissement des délais une fois mort le temps ? Le merveilleux (et final) chant XII le dit : qu’importe alors que « la puissance fatigue », que « l’épouvante gagne les hauteurs », que « le papillon » (qui n’a pourtant que quelques heures de vie pour se nourrir et s’accoupler) « s’endorme » ? Et même, qu’importe qu’un Dieu réel fasse ou non que « le nom des hommes puisse naître dans les lettres du sien » (p. 50), mystérieusement « semblable à l’oranger » jaillissant parmi les arbres du bois » ?
Car même si :
« Sans langue tu m’as appelé
Sans mains as recouvert mes yeux de cendre
Sans bouche tu m’as donné à boire la loi
Sans bras tu m’as maintenu captif
Sans vin m’as enivré
Sans demeure m’as consolé sous le soleil de ta splendeur » (p.58)
reste que, ajoute l’âme,
« je suis orphelin de ton destin
comme un cerf tu as fui
nul ne connaît les traces
de tes pas … » (p.59)