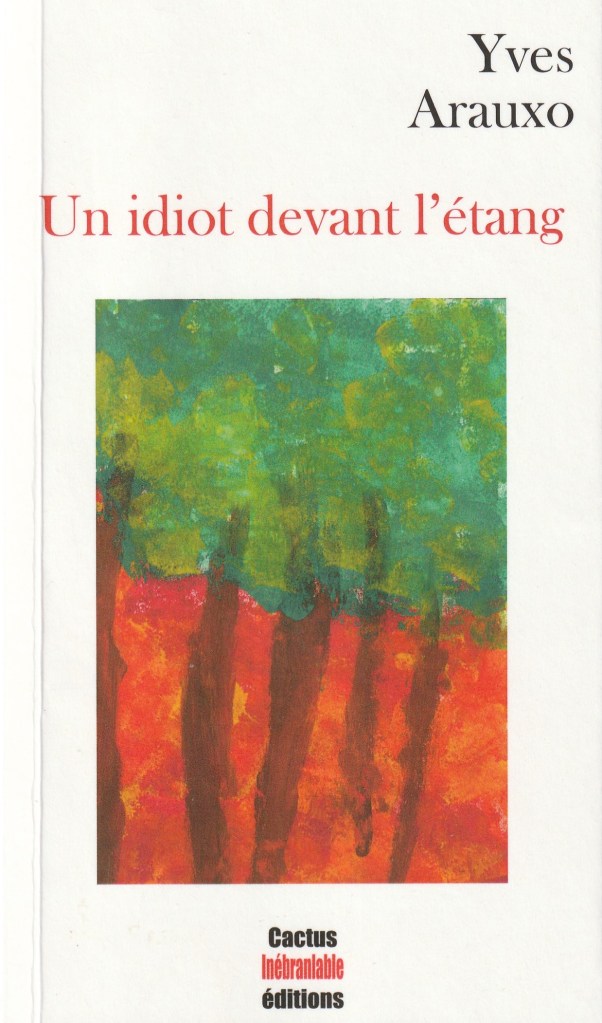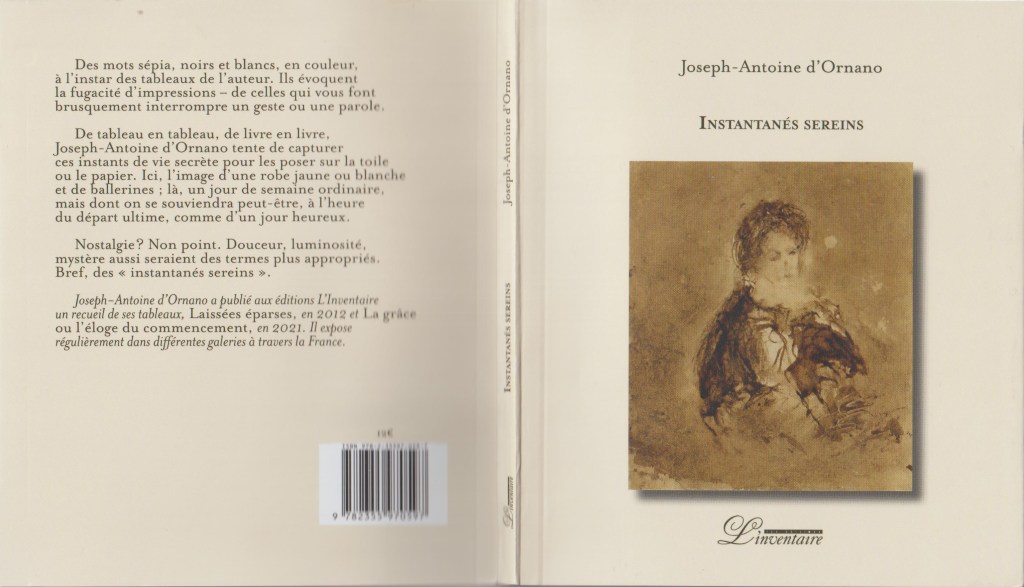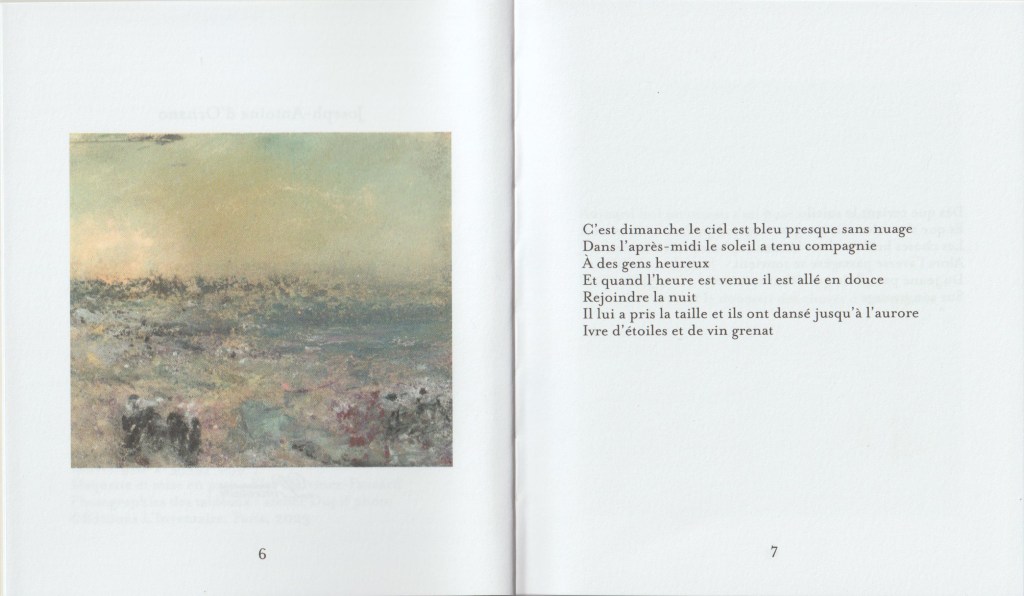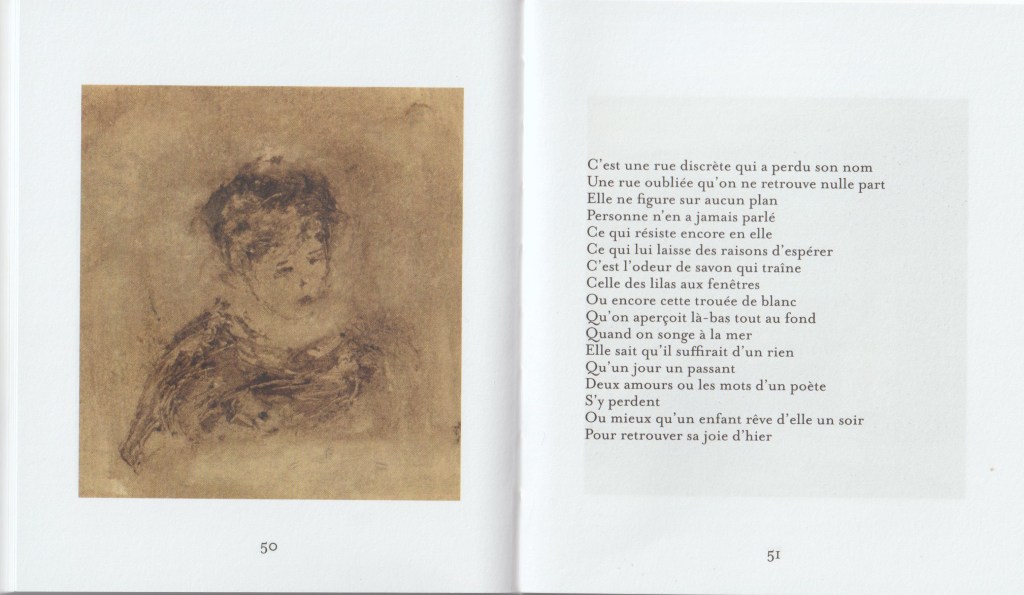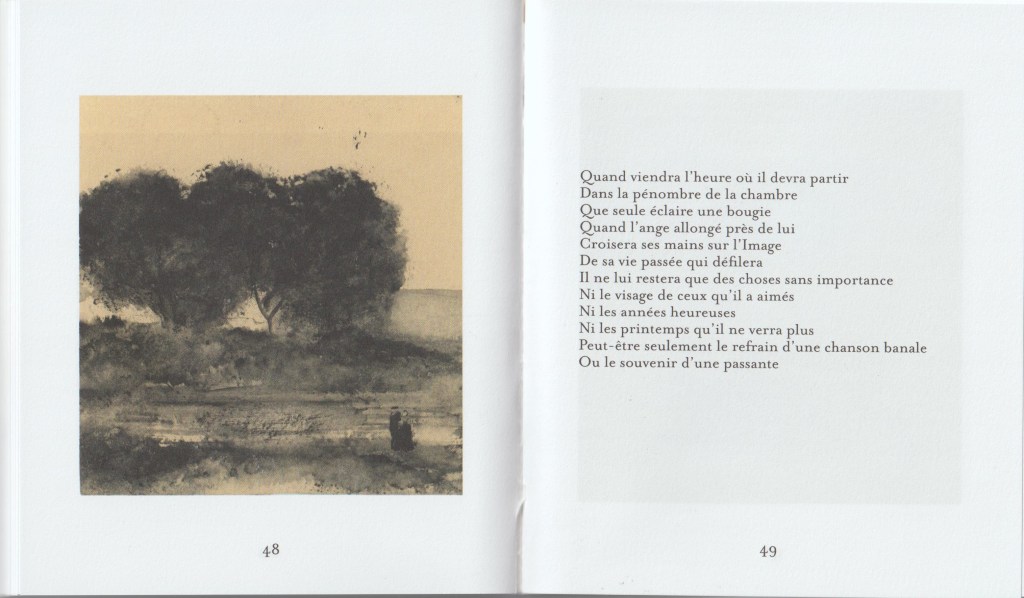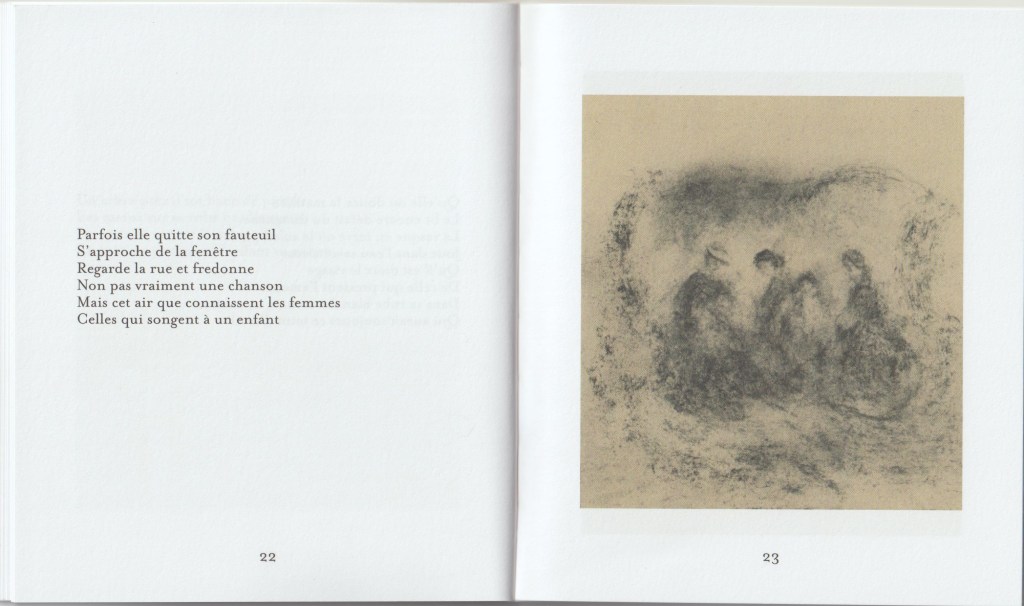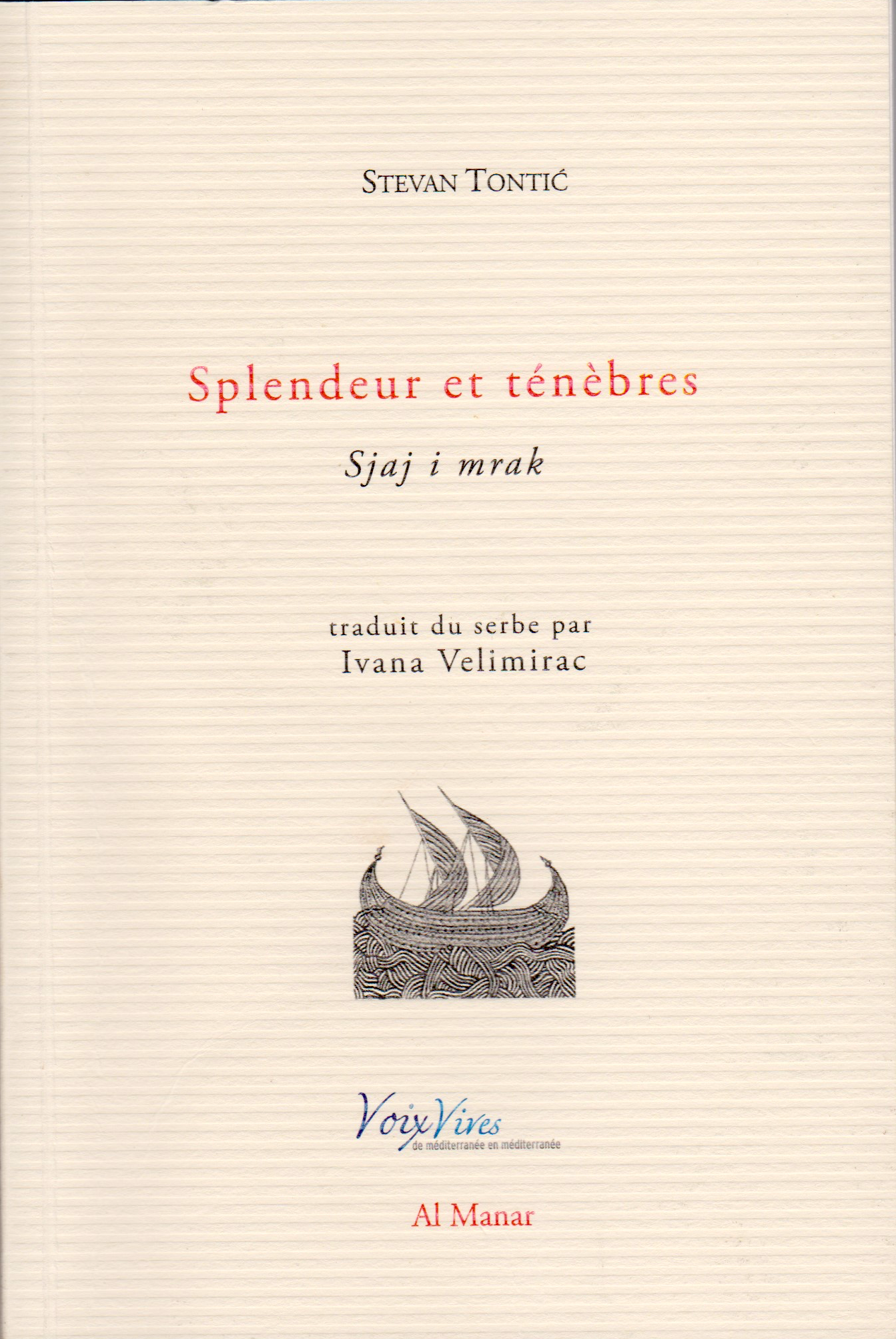Une chronique de Marc Wetzel
Yves ARAUXO – Un idiot devant l’étang – Cactus inébranlable éditions, automne 2023, 62 pages, 12€
« Un idiot devant l’étang » est d’abord le titre d’un tableau (de 1926) connu (un mixte à la fois malicieux et inquiétant de Chagall et d’Otto Dix) de Frits Van den Berghe, qui montre un « idiot du village », massif, béat, se tenant à l’écart avec roulotte et canards, les yeux clairs comme vide muré, mains-battoirs et pieds-palmes, à la fois épouvantail et corneille, et, surtout, à la très complexe stupidité : c’est un abruti, mais d’une rare mélancolie, qui semble porter le deuil de l’intelligence; un « innocent », mais redoutable, qui pourrait bien n’avoir oublié le mal que le temps d’une pose; enfin, un ogre disponible – une qualité peu courue chez les ogres – comme si celui-ci nous avertissait n’avoir rien contre varier ses menus. Bref, cette oeuvre éponyme de Van den Berghe (peinture expressionniste et naïve à la fois, un peu cubiste, un peu surréaliste, un peu symboliste encore …) est ici la parfaite sentinelle – balourdingue et incorruptible – de ce petit livre riche, profond, tonique et merveilleusement réussi, d’Yves Arauxo (1973).

L’Idiot devant l’étang (1926)
Musée des beaux-arts de Gand
Les penseurs sont souvent fanatiques, car ils projettent leurs chères idées partout (les imaginant aisément irrésistibles ou scandaleusement moquées), et les poètes, eux, sont volontiers superstitieux, car ce sont les signes du monde que leur lyrisme, à tort et à travers, multiplie partout. Mais les penseurs-poètes, eux, – en une synthèse magnifique qui les rend si rares – sont tempérés (ils savent que leurs idées ne sont que des signes parmi d’autres) et lucides (ils examinent les signes aussi précautionneusement que des idées, et doutent de la pensée de la Providence aussi méthodiquement que Descartes de la sienne propre). Yves Arauxo est un tel penseur-poète, qui médite (comme ne font jamais les fanatiques) et contemple (comme ne font jamais les superstitieux). Un méditant, en effet, ne gendarme jamais les prières d’autrui, nous laisse juges de ce que nous attendons de Dieu, et ne se prétend certes pas bras armé (et impatient) d’une volonté supérieure (le fanatique, lui, exagère la colère de Dieu pour s’en offrir prétexte à diviniser la sienne !). Un contemplatif, de même, laisse la beauté reposer devant lui sans l’enrôler dans ses lectures, concède aux choses l’initiative de leur propre présence, et laisse tranquillement s’évanouïr – sans s’en estimer trahi ou volé – les apparences décevantes, inconsistantes ou ne méritant pas d’autre examen (le superstitieux, lui, est addict à la révélation : il préfère un monde lui promettant malheur et ruines à un monde qui n’aurait simplement rien à lui dire : comme dit Comte-Sponville, même la vérité lui paraît au service du sens dont il rêve). Le contemplatif prend le monde comme celui-ci se débrouille pour arriver, comme le méditant prend la foi (la sienne, comme celle des autres) comme une simple tentative de fixer ce qui mériterait d’être, sans prétendre faire saisir mieux ce qui est. « Finalement, vivre n’aura rien changé : on est toujours aussi démuni qu’avant » (p.51), voilà exactement ce qui scandalise un croyant, et ce qu’un méditant, lui, trouve évident et normal.
« L’oeil ne voit que sa pierre, un trou s’il la soulève » (p.42)
Contemplation n’est pas pour autant concentration, car celle-ci immobilise, et fausse l’évolution des choses et des êtres. L’esprit doit rester mouvement pour comprendre celui du monde (et être ainsi fidèle à « l’évasion de la matière, le mouvement infini de ses rives » p.26) : une danse de papier (comme est l’acte d’écrire) vaut toujours mieux, avec sa tremblante « habitation de reflets », qu’une architecture de représentations ou une sculpture de sens dont la porte s’ouvre sur du définitif, et la fenêtre sert seulement à aérer ou éclairer la perfection donnée. Au contraire, « Écrire, c’est comme ignorer la porte et entrer par la fenêtre« – comme « délivré du geste d’écrire », et ne se sentant pas plus écrire que l’oiseau voler. (p.28). D’ailleurs, dit Arauxo, « quoi qu’on écrive, la page blanche reste blanche » (p.27); seule compte l’expressivité vivante des hommes, c’est-à-dire « porter haut le combat avec les forces qui les traversent » (p.27). Tant que l’on peut traduire quelque chose de ces forces qui luttent en nous, la joie reste possible, et le bonheur hante le parcours de leurs passations secrètes.
Le poète Yves Arauxo est penseur quand il réfléchit sur l’acte de connaître, le pouvoir de méditer lucidement sur l’ordre des choses. Sa maxime est quelque chose comme : contempler le monde pour décrisper nos visions de lui, pour comprendre qu’on ne sait pas (en tout cas on ne sait pas comment l’on fait pour savoir !), pour avancer autrement vers ce qui nous est donné. Il écrit : « On ne voit le monde que de dos », ou : « on ne voit le monde qu’à travers un miroir », ou encore : « on a beau regarder, on ne voit que ce qui nous reflète ». C’est dire que nous sentons le réel (avec les moyens embarqués de la sensori-motricité), mais ce qui fait être le réel, nous n’en sentons rien : nous conjecturons, déduisons, calculons, modélisons, interprétons … mais la vérité, elle (l’apparition dans le discours de ce qui rend réel ce dont il parle) échappe à toute présentation directe. (« La matière est confuse, il faut briser la vitre« , p.15). Ce qu’on saisit sensiblement est partiel et partial; mais ce qui se passe régulièrement partout et objectivement reste imperceptible. Petite consolation : en comprenant mieux les limites de sa perception, l’homme recule d’autant celles de ce qu’il perçoit. Mais l’effort intérieur y est constant (« L’univers est une vague, je surfe« , p. 10, quoique le surf soit un art, et toute mer un abîme !); d’ailleurs aucune subjectivité n’est la panacée, car toute intériorité vibre, vacille et isole – comme l’écrit rudement, mais lyriquement, Arauxo :
« Nous avons tous une forêt intérieure. Les arbres y sont pleins de pendus mais, ça et là, ruisselle la lumière » (p.25)
À ce que le poète nomme fortement « l’entorse d’être né homme« (p.16), – la torsion qui toujours distend les articulations de la conscience, et fausse le pas de la liberté ? – répond ici une tension (méditative) qui détord les nerfs, déforme et transforme leurs influx, motivée par on ne sait quelle sereine gratitude : « Unité provisoire de mes cellules, je me disperserai comme des nuages sur l’horizon » (p.17). Autrement dit : le réel m’a fait l’honneur de me composer; je me décomposerai donc dans une joie reconnaissante et sage ! En attendant de rejoindre le silence ultime, la poésie le fait comme préventivement réagir : « Le poème parle au silence et le silence lui répond » (p.30). Et le poète (dans « l’ombre fraîche de la grotte buccale » p.32) sait sa relève assurée :
« Patience, tu viendras aussi à mourir … D’autres oiseaux garderont le silence » (p.49)
On laissera mieux découvrir le « talent pur » (Jean-Pierre Otte) et le ton unique de cet auteur, à l’humour humble, douloureusement lucide, extraordinairement nostalgique, et tendre, en lui laissant six fois la parole :
« Si je n’avais pas crié, on ne m’aurait pas vu naître » (p.43)
« Trois quarts d’heure plus tard, il était mort.
Il avait à peine bu son thé (…)
Ils refroidirent ensemble » (p.41)
« La douleur n’est pas un seuil comme les autres : c’est celui où naît la conscience que tout est seuil » (p.40)
« Si j’étais un autre, je ne serais pas mon ami » (p.43)
« Nous avons toujours des racines mais elles flottent dans le vide. Nous ne pouvons plus nous nourrir que du souvenir qu’elles gardent de la terre » (p.45)
« Peut-être sont-ils nombreux ceux qui, partiellement du moins, me ressemblent et n’oseraient le confier à personne ? » (p.48)
Ce petit livre, intègre et sublime, étonne, même quand il charme et convainc. C’est là un auteur à la fois très subtil et très fraternel, qu’on sera ravi (mais aussi transformé !) de découvrir. La quatrième de couverture cite cet aphorisme de la page 47 : « Qu’opposer à l’intelligence artificielle (I.A.) sinon l’idiotie naturelle ?« . J’ajoute seulement : qu’opposer à l’idiotie culturelle, sinon … Y.A. ?