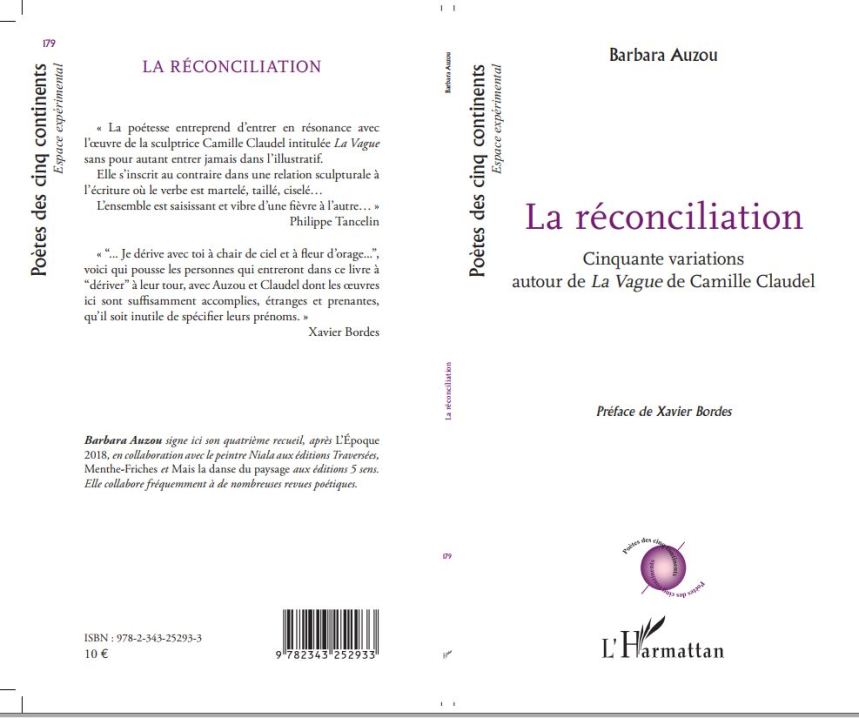Une chronique de Lieven Callant
Que ma mort apporte l’espoir, Poèmes de Gaza, Édition bilingue arabe-français, OrientXXL, Éditions Libertalia, Novembre 2024, 230 pages, 10€
Cette édition a été préparée par Nada Yafi, Jean Stern, Charlotte Dugrand, Bruno Bartkowlak et Nicolas Norrito et comporte des poèmes consécutifs à l’offensive israélienne du 7 octobre « Glaive de fer » et des poèmes d’avant le 7octobre. La guerre impitoyable livrée par Israël à la bande de Gaza et aux Palestiniens remonte bien plus loin que le 7 octobre 2023. L’offensive n’a en fait jamais vraiment cessé, revendiquée par Israël sous l’expression cynique de « tondre le gazon ».
Les poèmes de ce livre témoignent du dénuement de la population et de ce qu’elle subit. Les mots ne servent pas à fabriquer des pamphlets amers mais trouvent souvent le chemin de la simplicité pour évoquer un quotidien qui ne l’est pas. Certains poèmes ont été écrits sous le feu des balles, d’autres dans l’urgence d’apporter un témoignage, d’apaiser la douleur, de construire un espoir, de mesurer l’ampleur du désastre. Des femmes, des hommes, des enfants meurent, d’autres tentent de survivre avec des blessures qui probablement ne guériront pas. Des poètes se taisent. Des vies se tarissent.
« Dans chaque poème vit l’âme d’un être humain, qui l’a entreposée là. Il faut les lire avec cette attention-là« . C’est ce qu’écrit dans sa postface, « J’aurais voulu être un magicien », l’écrivain palestinien Karim Kattan. Il nous demande aussi de mesurer l’ampleur du silence. Des pages blanches, rien que du vide et du silence. Une place immense laissée par ceux qui se sont tus, qu’on a tués, qu’on a réduits au néant.
À l’image des poèmes cités pour cet article, ce que réclament les textes du livre, c’est le respect, le droit à être un humain, de vivre à l’air libre.
« Une étoile disait hier
À la lueur de mon coeur
Ô lumière
Nous ne sommes pas de simples passants
Ne vacille pas!
Sous ta clarté
Marchent encore
Quelques promeneurs errants »
Hiba Abu Nada, poétesse et romancière de Gaza née en 1991 dans une famille de réfugiés, tuée par un bombardement le 20 octobre 2023
À travers les yeux de trois enfants – – Fidad Ziyad
« Je vis ce génocide à travers l’imaginaire de trois enfants
Le premier se cachait sous les draps
En disant je voudrais être un fantôme
Pour que les avions ne me voient pas
Le deuxième disait, du fracas des navires de guerre
C’est la voix de la pieuvre dans la mer
Et le troisième, une petite fille: je voudrais être une tortue
Pour cacher tout le monde
Sous ma carapace
Ô toi la main de l’imaginaire
Berce le sommeil de ces petits
Préserve pour eux tous ces rêves
Ô toi la main de l’imaginaire
Ne va pas plus loin que l’horreur du réel »
La guerre ne s’était pas endormie — Othman Hussein
« Elle était tranquillement assise, la guerre
Puis elle s’est levée timide les premiers jours
Dissimulant son visage et son souffle
Le premier mort aura un nom et un numéro
Et peut-être se rappellera-t-on jusqu’à la couleur de ses chaussures, fera-t-on résonner trompettes et tambours
Il aura de la chance
« Le martyr » dira-t-on de lui
… Puis les nombres se multiplient
Sans numéros et sans récits
La guerre s’est enfin dressée, grande discorde funeste
Elle ne s’était point assoupie, comme elle l’avait prétendu »
Un pays oublié dans les valises des migrants — Hachem Chaloula
« Chaque centimètre que je foule est désormais une tombe »
« Un enfant tombe tel une feuille du figuier de la vie
Et tombe avec lui la pluie du coeur d’une femme-rivière
Telle est l’histoire de notre automne, abattu dans un carnage
Qui s’étend du Nil à l’Euphrate »
« Nous sommes nés du cri
Nous y avons vécu mille ans
Sans nous demander de quelle gorge nous étions sortis
Et soudain tout s’est tu
Plus de gorge pour le cri
Alors quelqu’un a dit
Qu’une épopée avait dissous nos traces »
Pour ouvrir cette édition bilingue français-arabe figure un poème de Mahmoud Darwich, poème écrit en 2000 et intitulé « Mohammad » en hommage à Mohammad Al Durra, cet enfant de Gaza froidement abattu par un sniper israélien, alors qu’il se blottissait contre son père, lequel tentait désespérément de le protéger. J’en reprends ici quelques morceaux.
« Mohammad
Il se niche dans le giron de son père,
Oisillon affolé
Par l’enfer qui tombe du ciel, retiens-moi père
De m’envoler là-haut
Mes ailes
Sont encore trop frêles
Pour ce vent fort
Et la lumière est si noireMohammad
Il veut juste rentrer à la maison
Sans bicyclette sans chemise neuve
Retrouver les bancs de l’école
Le cahier de grammaire et de conjugaison »
Lorsque j’ai entamé la lecture de ce livre, je venais de finir « Chaque jour, est un arbre qui tombe ». La merveilleuse écriture de Gabrielle Wittkop et l’intelligente structure du roman m’ont fait comprendre que chaque jour, chaque instant de vie disparaît de manière irrévocable et s’éloigne de nous pour ne jamais revenir que sous la forme d’un souvenir que la mémoire ne cesse de réécrire. Un arbre tombe, un univers s’écroule avec lui à jamais. Mais au lieu de se satisfaire de cette prise de conscience, il y a chez Wittkop le refus de se résigner. Elle fait face, elle fait front.
Les poèmes de Gaza résonnent aussi de cette fatalité de la mort qui révulse, qu’on refuse en tout état de cause. Pour survivre, il faut se familiariser avec la mort sans jamais s’avouer vaincu. Quand elle est omniprésente et s’impose à nous avec la constance, la violence et la brutalité d’une guerre qui ne finit pas, quelle doit être notre réponse? Qu’est-ce qui pousse un être humain à en détruire un autre? Une haine profonde, une discorde aveuglée? Comment empêcher l’anéantissement? La dérive suffisante qui veut nous faire croire que l’autre n’est qu’un ennemi, un monstre, un terroriste, un animal, un vulgaire chiffon, un déchet.
Il est des saisons terribles où les oiseaux se taisent, où les insectes ne bourdonnent plus, où les sèves végètent, où les arbres meurent. Le silence devient absence. Le monde s’effondre. Quand un arbre tombe, quand un être humain disparaît, on comprend ce qui s’écroule avec lui. Une vie, un réseau de vies, une architecture complexe, un temps long, infiniment long. Un univers. Une peuplade, des civilisations. Une culture.
Ce livre n’a évidemment pas l’ambition de répondre à ces questions mais il interpelle ses lecteurs, écoutons ces voix multiples avant qu’il ne soit trop tard. Définitivement trop tard.