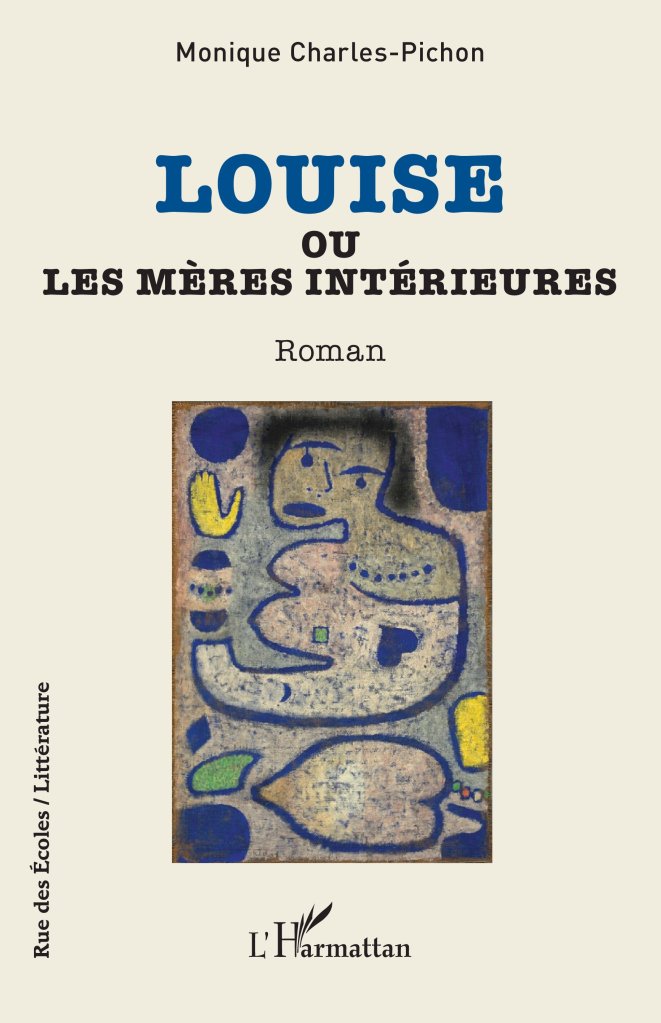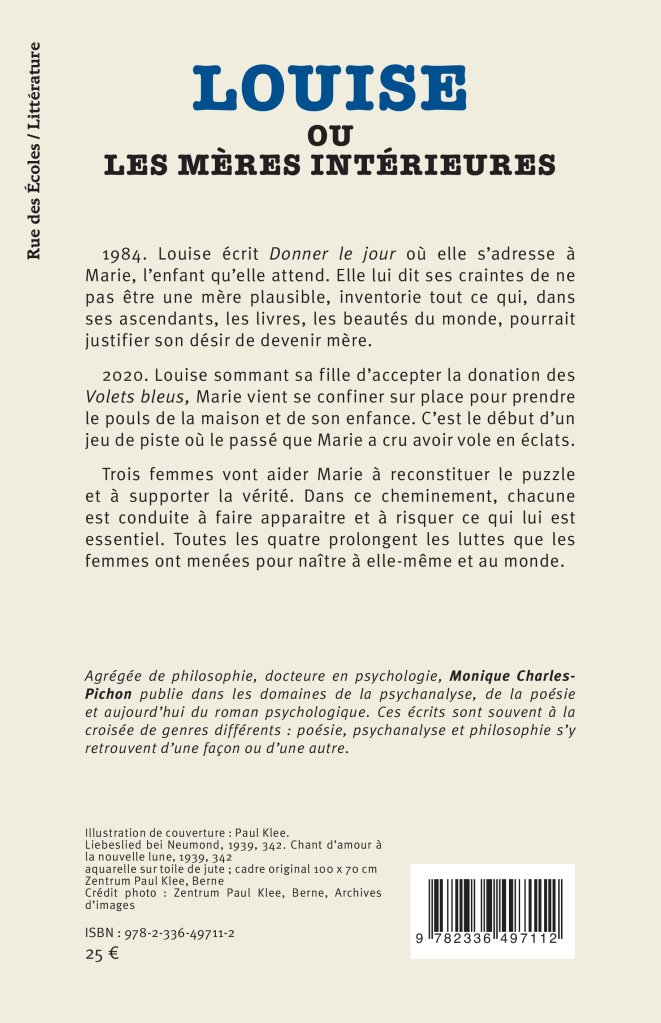Une chronique de Patrice Breno
Monique Charles-Pichon, Louise ou Les mères intérieures, roman, L’Harmattan, 2024, 275 pages
« Tout ce que j’écris, vois-le comme une trousse à outils, de secours, une pioche, des varias d’inquiétudes et d’amour où tu peux grappiller librement »
Les mères intérieures, ou « Les guerres intérieures » (roman de Valérie Tong Cuong), ou Les tourments …, Les espoirs … et tant d’autres à imaginer.
Monique Charles-Pichon nous emmène dans un roman hybride entre psychanalyse, philosophie, entre espoir et renoncement, désir et refoulement, attente et déception, …
C’est de toute façon aussi l’histoire d’un amour floué que nous décrit Louise dans son journal/manuscrit qu’elle intitulera Donner le jour.
Trois parties charpentent ce roman.
Louise, 1984
La maman de Marie, Louise, ne citera les intervenants – surtout ceux de sa famille, ses parents, ses grands-parents, ses marraines, sa fille … que par leur prénom. Elle ne dira jamais « papa », « maman »…
Elle vit avec Louis et a un désir absolu d’avoir un enfant. Pourquoi souhaite-t-on avoir un enfant ? Pour avoir un projet de vie, pour consolider son couple, pour partager ses acquis, pour servir de relais entre hier et demain … Pour tout cela et surtout par amour, pour la plupart d’entre nous, du moins je l’espère !
Louise et Louis, ça ne s’invente pas ! Louise va lui « faire un enfant dans le dos », comme dit l’expression, car de progéniture, Louis n’en veut pas. Mais notre héroïne cherche avant tout à garder son compagnon et c’est la seule alternative à laquelle elle songe.
Alors Louise imagine un dialogue avec son enfant à naître : elle sait d’ores et déjà qu’il s’agit d’une fille. Ce dialogue qui est en fait un monologue, puisque celle qui vit en elle ne peut lui répondre. Une forme de catharsis en quelque sorte qui lui permet de tenir bon et de se dire que Louis ne va pas la quitter, comme ça, sur un coup de tête. Elle dit à son enfant à naître celui qu’elle a été, lui décrit les passages difficiles qu’elle a connus et les personnages qui ont compté pour elle, disparus ou encore présents.
Marie 2020
Ici, c’est Marie qui prend le relais, à 35 ans, Louise avait cet âge quand Marie est née. La mère veut léguer à sa fille Les Volets bleus, maison de son enfance, où elle a été élevée par sa génitrice et ses deux marraines, Hélène et Joan.
« Je voudrais faire comme toi… écrire la suite de Donner le jour, ce pourrait être ça, un carnet de bord qui détecte les lignes de force du passé et du présent. »
« Le suicide et l’infanticide pour crier à Louis l’horreur de l’abandon, qu’il ne s’en remettre jamis. »
« Louis, je l’ai expulsé ».
Louise devenait folle car – en réalité – Louis l’avait quittée, abandonnée. Cette folie conduisit la mère presqu’au suicide et à l’infanticide ; ce que découvre avec horreur Marie, en lisant le second manuscrit tout raturé et qui chavire en tous sens : Lettres de l’abandon. Marie se rend compte que sa mère devenait dangereuse pour elle-même ainsi que pour sa fille.
3ème partie : Hélène, 2021
Psychanalyste et amie de nos deux protagonistes principales, Hélène va aider Marie à remonter la pente ; Joan aussi. Ses deux marraines, en somme ! Les amitiés vont remplacer les cellules défaillantes et Marie – elle aussi – va se décider d’écrire et ainsi aller à l’essentiel : avoir une vie à soi, un espace de liberté, un endroit « intérieur » où chacun se soulage grâce à l’autre et tente de comprendre et d’aider l’autre.
C’est un roman prenant de but en blanc où les amitiés indéfectibles qui consolident et rassurent, les lieux de vie pour comprendre, l’amour des animaux, le recueillement pour solitude et introspection, l’écriture comme salut … sont les éléments fondamentaux que l’autrice développe pour aider à continuer, malgré les remous, les contraintes et les obstacles qu’offrent les rencontres probables et improbables d’une vie trop ou trop peu remplie …
Et si ces amitiés ne consistaient seulement qu’en une « renaissance » pour chacune des héroïnes.
Un roman féministe peut-être, mais surtout intimiste sur la difficulté d’être mère, de le vouloir et surtout de le pouvoir.
Etre mère, c’est pour moi quelque chose de phénoménal. Moi-même, je ne me suis rendu compte de l’importance, la force et le courage d’une maman que lorsque mon épouse l’a été…
Monique Charles-Pichon, à travers ce roman à multiples clés, nous fait rentrer dans un monde de questionnements, où la trajectoire d’une vie peut dévier si on est seul à s’enfoncer dans ses propres délires ou être « rattrapée » si on peut compter sur des appuis solides.
©Patrice Breno