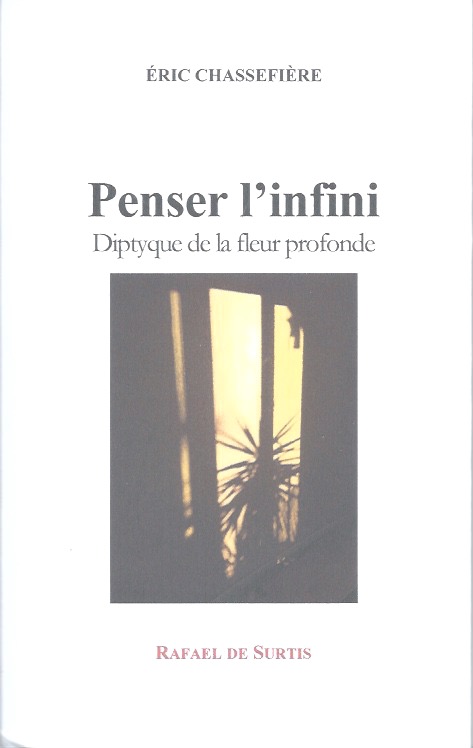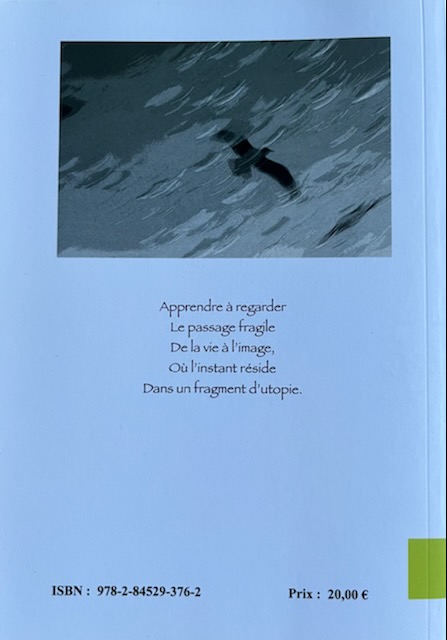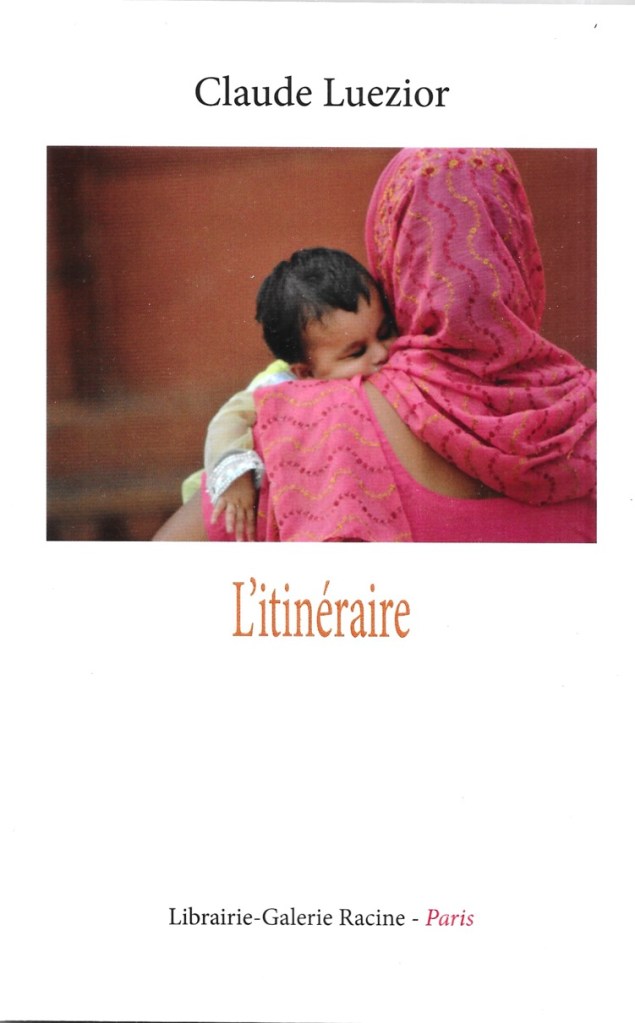Une chronique de Lieven Callant
Éric Chassefière, Penser l’infini, Diptyque de la fleur profonde, Éditions Raphaël de Surtis, mars 2024, 100 pages, 19€
« Le diptyque est un ensemble composé de deux unités distinctes qui entretiennent une correspondance. » En effet, « Penser l’infini » comporte deux parties: Premier infini, la voie profonde et Deuxième infini, la voie élevée. Le poète nous propose d’emprunter à tour de rôle, deux voies. L’une se réfère à l’ombre, à la pénombre, à l’absence de lumière, de bruit; L’autre se rapporte à la lueur, la lumière, au ciel, aux astres, à l’espace, à la voix. Qu’on ne confonde pas, le poète ne propose pas une vision binaire où s’opposent des contraires mais nous suggère qu’il est difficile de déterminer la frontière sur laquelle se pose la poésie. Car c’est par la poésie que l’on pense ici, l’infini. L’écriture est ombre, trace, la lecture devrait devenir lumière, clarté, évidence. La poésie prend sa source en une zone infiniment ténue. Les mots ne peuvent donc que déborder. Même si l’on se limite à quelques figures de style, à quelques évocations, qu’on trie au tamis fin.
Éric Chassefière le sait. Pourtant, il tente sa chance, choisit de se poser en lisière du monde, de rester sur le seuil, d’ouvrir porte ou fenêtre, d’attendre sur le balcon. D’intégrer l’infime différence entre l’espace intérieur de la chambre où l’on écrit, d’où l’on contemple et l’espace extérieur réservé au jardin, à l’arbre, à la faune et aux éléments. Vent, souffle, battements d’ailes, cris, chants d’oiseaux ou soupirs de feuille, de fleur. D’où provient le jour, la nuit? De quel infini? Distingue-t-on encore le songe, le rêve, de la réalité qui devrait nous servir de socle.
La fleur profonde quelle est-elle? Notre âme, son souffle, sa respiration ou le fruit de notre réflexion? La fleur profonde, une ombre ou le dessein concret et merveilleux d’un être vivant? Sa profondeur se limite-t-elle à cet instant bref où l’on perçoit une sorte de matérialité. Saveur, goût, sensation, émotion. L’amour prend corps, « fait visage » refait surface.
Par les nombreuses citations qui vont suivre, j’espère marquer la progression du poète, comment il construit son univers, son infini et le pense grâce au langage poétique qu’il construit peu à peu.
« la lampe et le livre chacun miroir de l’autre
pour que la nuit soit de pure intériorité
il aime au seuil du matin quand ici s’ouvre sur ici. » P18
À partir d’un seuil, l’auteur observe, contemple, se positionne, cherche à être.
« nulle autre profondeur que le dégradé de la lumière à l’ombre » p24
« mots qu’il faut dire avec les lèvres
comme on embrasse » P27
« faire jardin de la pensée » P29
L’auteur construit ses propres expressions comme « faire visage » ou « faire jardin ».
« Il se sent bien là à chanter le temps
adossé à la pénombre de sa mémoire »P29
« Habiter doucement les mots
la fleur d’encre des mots sur la page
entendre murmurer les mots
dans l’ombre mouvante du feuillage
sentir comme la figure en est légère au souffle
comme naît le poème de cette légèreté
comme il suffit de peu pour en dissiper le sens » P42
« La fleur d’encre » désigne ici le résultat d’un processus, une finalité en soi, l’écriture sous son aspect matériel et fait naturellement allusion à la sensibilité, la sensualité qu’elle matérialise et qui peut si facilement se dissiper.
« On se tient là dans ce pur vacillement de l’instant »P44
Dans la deuxième partie du livre, le cheminement de l’auteur se mesure à ce qu’il implique: travail sur soi et solitude. Il faut se délester pour atteindre « cette hauteurs des sens » et « se laisser respirer au gré des mots » P59.
« Vivre ainsi à la hauteur de sa solitude »
(…)
écrire pour alléger le corps
écrire comme le chemin se perd » P57
« Il aime cette hauteur des sens
ce bruissement du monde qui s’élève
ce roucoulement dans l’infini
(…)
« Quelques pas du piano au balcon
de la pénombre de la musique
à la lumière du silence
le soir le ciel s’éclaire
(…)
Limpide ciel du soir P62
À la « fleur d’encre » s’ajoute la notion de la « fleur qui s’ouvre ». Le poète et le musicien s’accordent pour désigner le plein que l’un et l’autre recherchent, le fruit par ce qu’il n’est pas encore. L’avant poème et le silence, la trace écrite et l’absence de musique.
« que toucher avec les mots c’est offrir l’instant
que le silence est une fleur qui s’ouvre » p76
« n’être que pour être »
« sentir comme la vie est équilibre » P78
L’équilibre est plus que sensible, délicat, de lui dépend la vie, mais ne se résume pas en une position acquise pour toujours. La difficulté est bien là, il nous faut penser l’infini sans en avoir les moyens. S’inventer un langage nous force à observer nos propres limites. Ces mêmes limites nous informent sommairement sur ce qu’est l’infini. Une fleur profonde, une ombre, une lisière un « scintillement de l’obscur »?
« Il se tient là au seuil de lui-même »
« il se sent bien là dans la paix des limites P82
« suspendu à sa vie
arrêté en plein vol entre mémoire et devenir »P83
« ouvrir la fenêtre pour ouvrir la nuit
ouvrir la voix au scintillement de l’obscur » P85
Le projet poétique qu’ouvre ce livre sensible, juste, discret, revendique une sobriété intelligente. De réflexion en réflexion comme dans un jeu de deux miroirs qui semblent reproduire leur propre image à l’infini. La bordure c’est l’ici, le maintenant, la fenêtre d’où je regarde. C’est ce livre comme point de départ, l’image qu’il me renvoie est un poème, dans un autre poème, dans un autre poème, ….