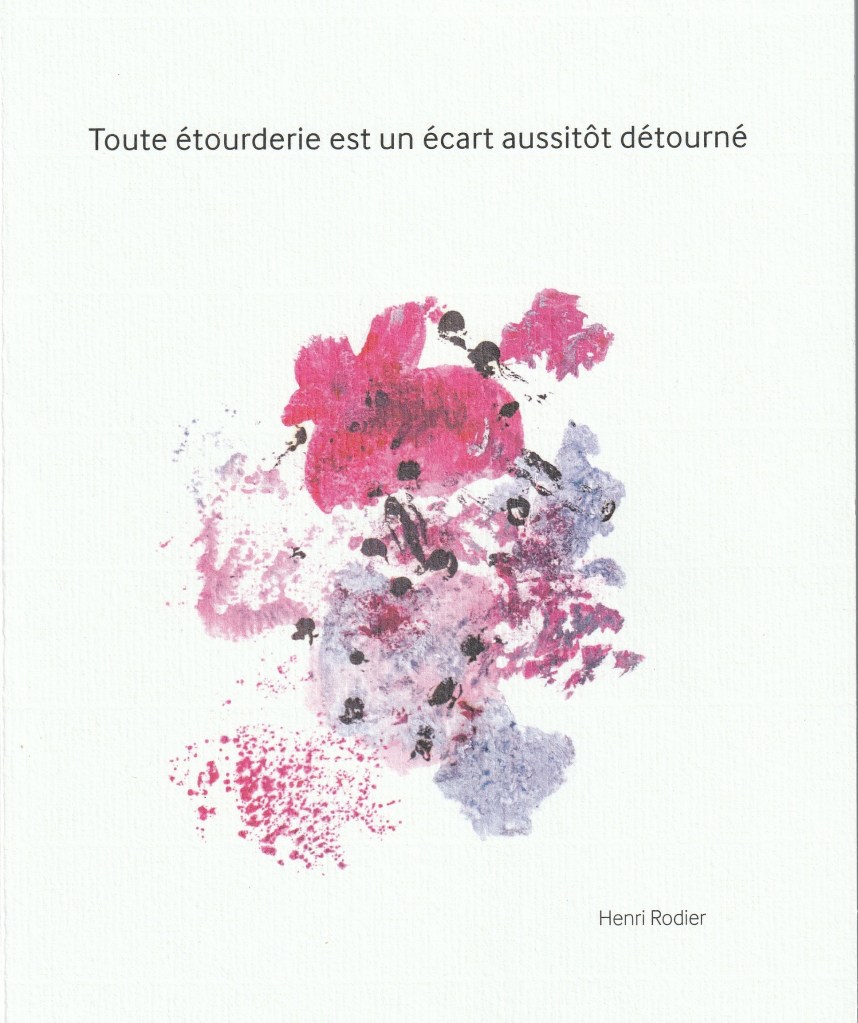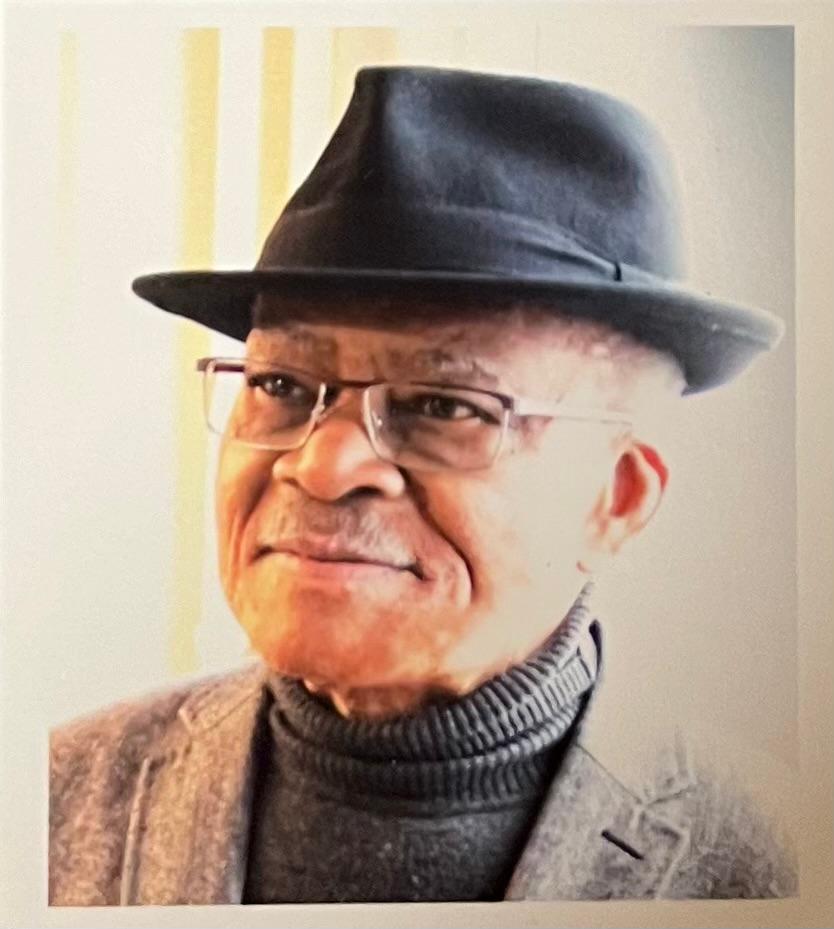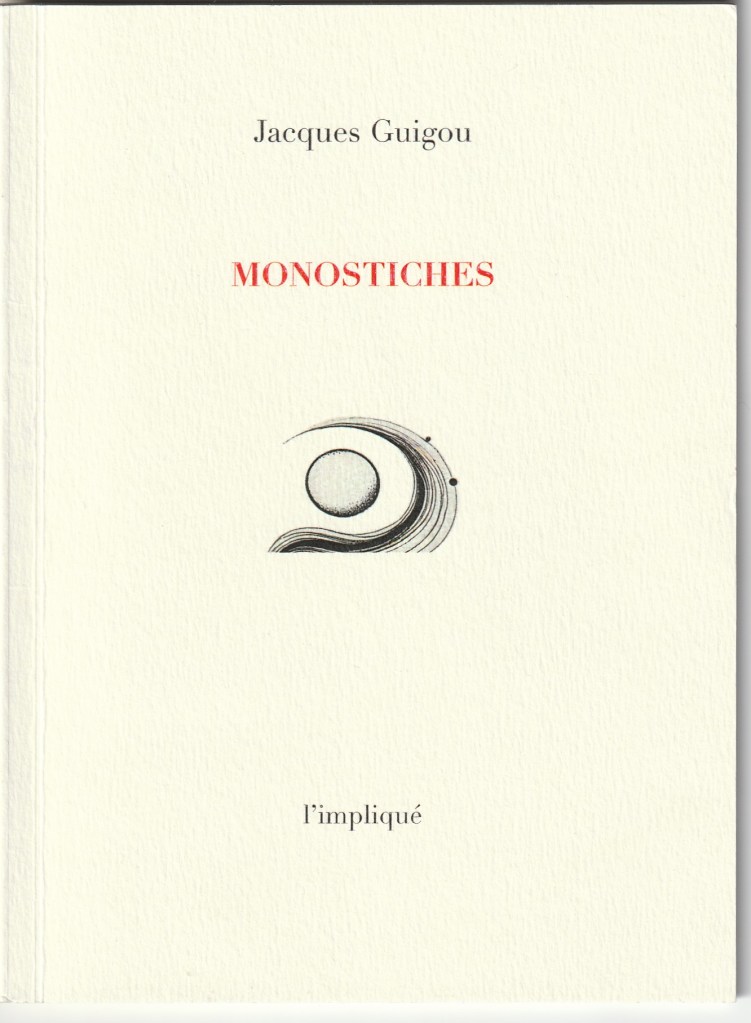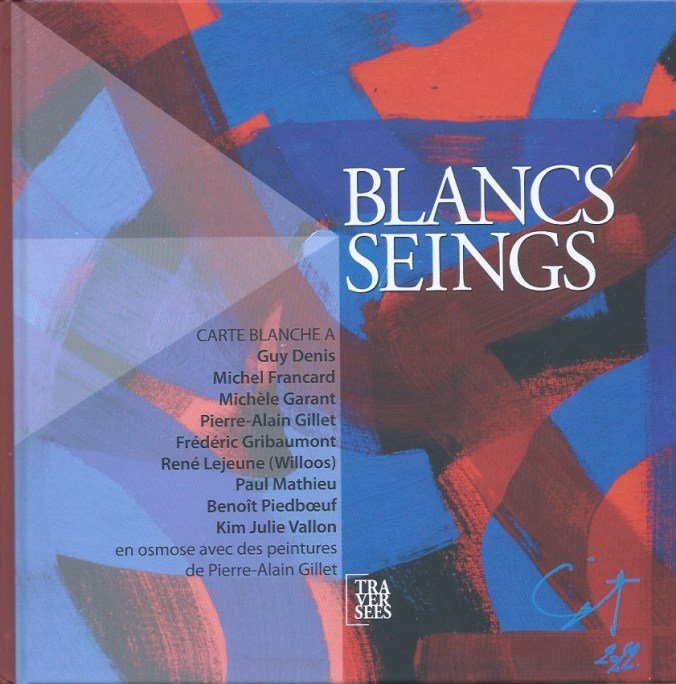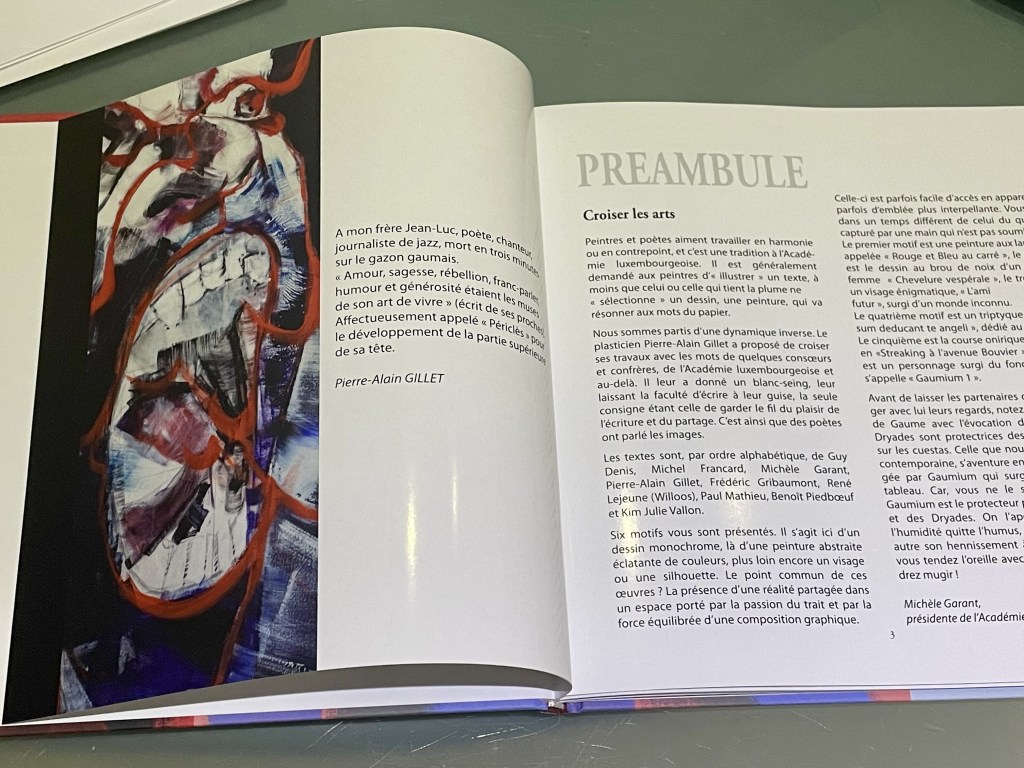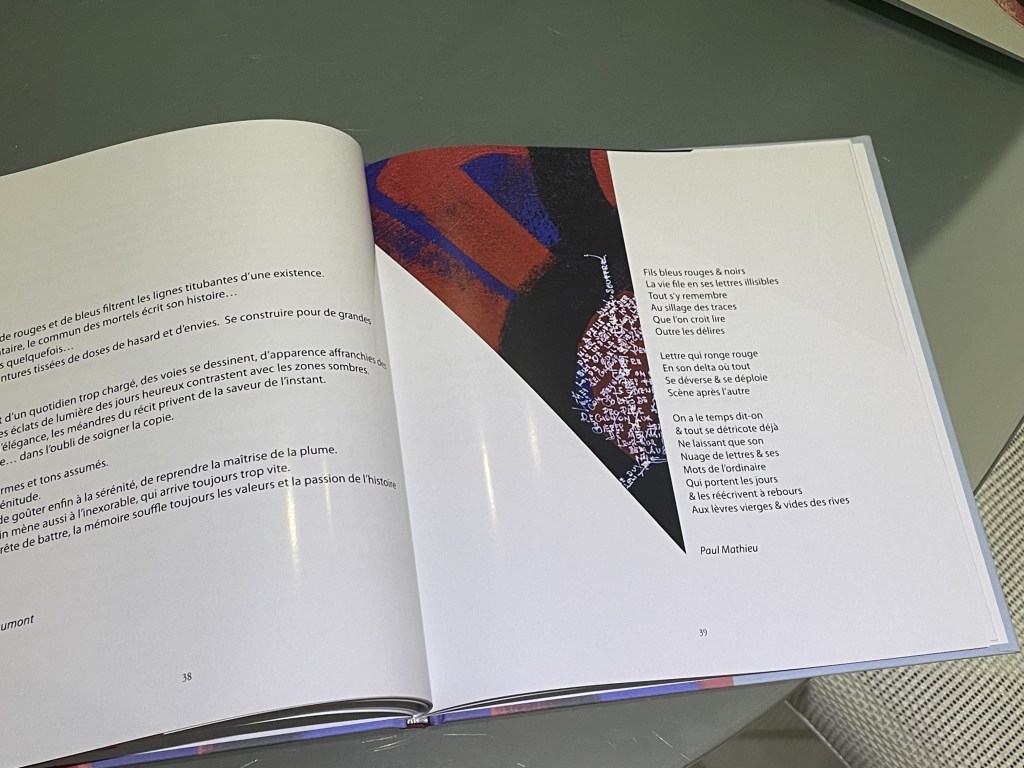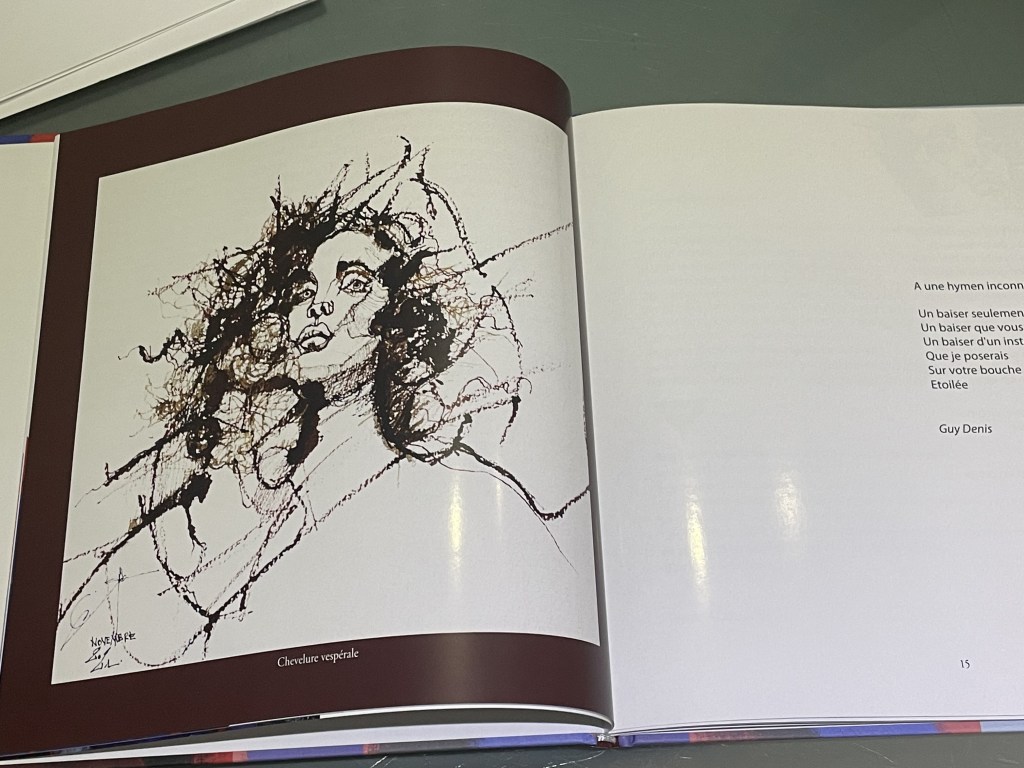Une chronique de Sonia Elvireanu
Gérard Le Goff, Aires de vent, Encres vives, collection Encres Blanches, 2025, 32 p., 6,60 euros
Après L’inventaire des étoiles (2024), Gérard Le Goff fait paraître la plaquette poétique Aires de vent. Le titre nous renvoie à l’idée de voyage. En effet, l’avant-propos de l’auteur nous confirme cette supposition. Le poète explique lui-même le titre : les aires de vent représentent les 32 subdivisions de la rose des vents avec ses quatre points cardinaux. « Chaque aire de vent ou rhumb est une subdivision constitutive du tour d’horizon qui indique la direction d’un vent en référence aux pôles, au levant et au ponant. Un vrai navigateur sait toutes les routes de tous les vents ».
La composition du recueil suit cette forme de la rose des vents avec ses aires de vent. Les 64 poèmes sont structurés en quatre parties : Est, Sud, Ouest, Nord. Chacune comprend 16 poèmes, un métissage de poésie et de prose poétique, dans sa totalité deux tours d’horizon, affirme le poète. Il se projette en piètre navigateur ayant perdu le Nord, « un voyage sans boussole », une errance son retour, telle la vie entre ses deux pôles biologiques. On pourrait dire un tour d’horizon du poète sur les saisons de son existence, avec nostalgie, regret, amertume, sur la vie troublée par tous les vents.
Les poèmes de l’Est sont traversés par la nostalgie de la beauté éphémère du printemps, « la saison claire », avec « son effusion de sève », la floraison, les jours radieux de la jeunesse. Dans les pages de prose poétique, le poète crayonne des tableaux émouvants de vie de campagne et des paysages de rêve, tel un peintre inspiré en dialogue incessant avec lui, la nature, les gens. Le lecteur se laisse emporter par la beauté des tableaux où respirent les bribes de tendres souvenirs, la rêverie et les traces des mythes anciens.
Sud évoque l’été. Si le printemps est le temps de la joie, de la frénésie, de l’amour, l’été est le soleil ardent, le silence, la brûlure de la vie, le temps des aveux. Des souvenirs s’égrènent de la mémoire affective comme des ombres d’une vie qui n’est plus : un village, une ville, une femme. On se souvient des faits, on s’interroge, on réfléchit à ce qui est advenu. Un « souvenir revient avec la violence d’une lame lancée par une main invisible » : l’absence de l’être aimé, emporté trop tôt dans un autre monde. Gravé dans la mémoire, son image s’effrite, l’oubli efface lentement le vif: les yeux, la voix, les cheveux. Les mots sont impuissants, ne peuvent l’arracher aux ténèbres, seulement esquisser les traces de son vécu. La mélancolie s’empare de l’âme du poète face au sentiment de la fuite du temps qui engloutit nos vies.
Ouest correspond à l’automne rouillé, dégarni, au temps des vents, des pluies, des pertes, des ombres du passé, des frissons. L’insomnie s’installe, les idées noires tournent dans le cerveau, l’inquiétude perce l’âme, les spectres des disparus reviennent à la Toussaint. Le chagrin, la peur, le pressentiment de la mort sont accablants. Une image émouvante revient : la silhouette de la femme aimée se détache un instant dans le noir, aux traits estompés pour s’évanouir aussitôt comme les volutes de fumée. Ce n’est qu’un spectre qui renforce le sentiment de solitude et obscurcit le monde du poète.
La dernière partie, Nord, évoque avec amertume l’hiver de l’homme et de la nature, le nadir de la vie, « le temps du vent noir », la fin où tout gèle. Le poète se retire dans la solitude de sa chambre, entouré de livres et d’objets familiers, s’abandonne au rêve et aux souvenirs délivrés par sa mémoire affective. C’est un temps de souffrance, mais sans désespérance, car un sentiment d’espoir l’anime, de voir triompher la vie.
La profonde sensibilté du poète, son goût de la contemplation du paysage se concertent avec la réflexion lucide d’un intellectuel qui nourrit sans cesse son inspiration de son vécu et du trésor culturel universel. Parfois les résonnances de ses lectures poétiques transparaissent dans ses poèmes par son désir de rappeler un poète, Paul Verlaine, pour la musique de ses vers et la volonté d’imprimer la même harmonie musicale à son texte en prose : « Laisse le vent mauvais emporter avec lui les jours anciens que nul ne pleure. Et demeure. ».
L’ironie et un certain humour se mêlent à la mélancolie du poète surtout quand il évoque les fêtes de l’automne et de l’hiver, opposant la perception des enfants à celle des adultes.
Gérard Le Goff partage ses réflexions sur le chemin de la vie à travers les quatre saisons de l’année, autant d’étapes de notre parcours existentiel, dans un sensible alliage de lyrique et d’épique qui rend compte de sa double vocation de poète et de prosateur.