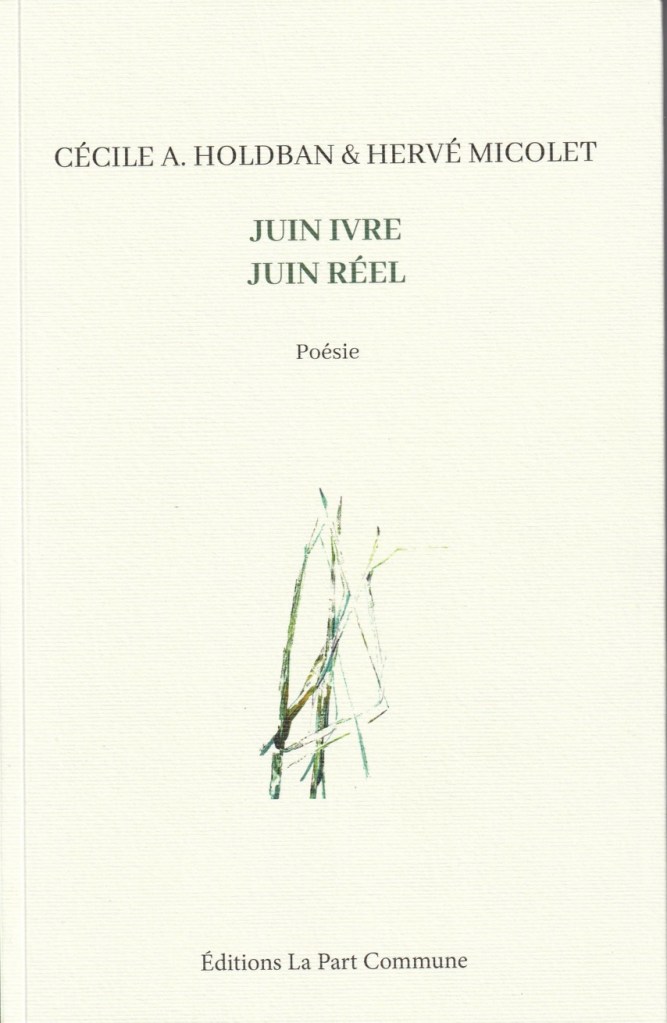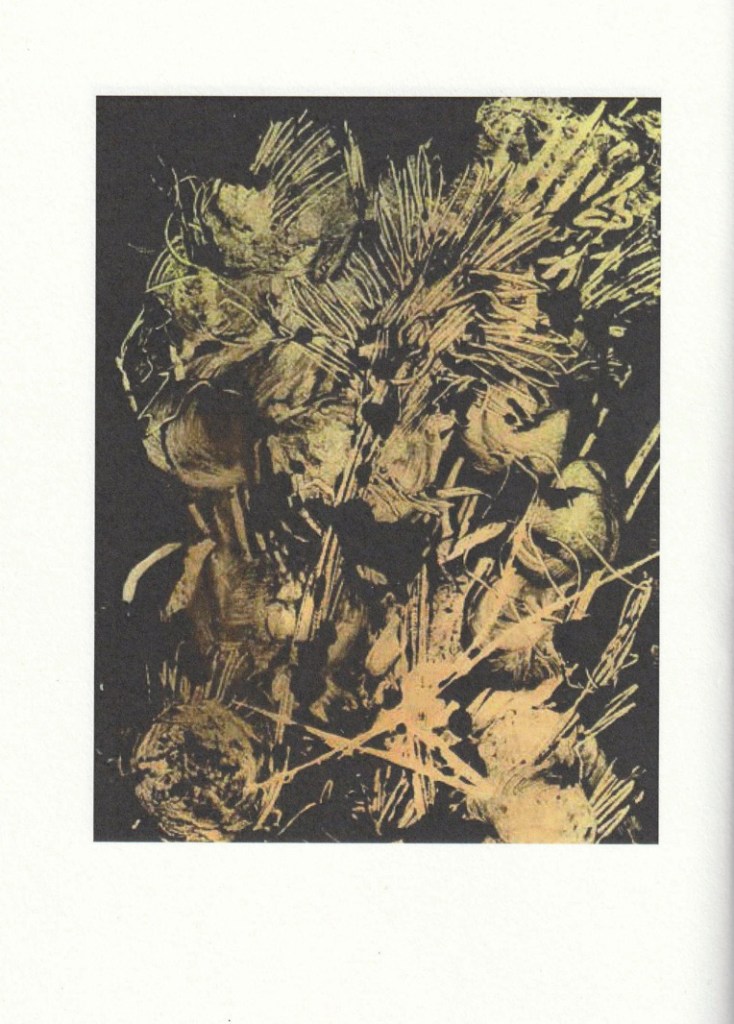Daniel ILEA
Dostoïevski – réflexions sur le Dieu-homme / l’homme-Dieu
« Et certainement il est également vrai, et qu’un homme est un Dieu à un autre homme, et qu’un homme est aussi un loup à un autre homme. »
(Thomas Hobbes, De Cive [Le Citoyen, 1642], « Épître dédicatoire »)
Une des lettres (août 1867) de Dostoïevski à son fidèle ami poète, Apollon Maïkov, pourrait contenir, implicitement, l’« idée-sentiment » que Jésus-Christ (l’homme-Dieu, ou le Dieu-homme) évincera nécessairement Dieu lui-même : « Mon Dieu ! Le déisme [en fait, le monothéisme, m. n.] nous a donné le Christ, c’est-à-dire une conception de l’homme si élevée qu’elle impose la vénération et qu’il est impossible de penser que ce ne soit pas à jamais l’idéal de l’homme ! » – cf. Joseph Frank, Dostoïevski. Les années miraculeuses (1865-1871), trad. de l’américain par Aline Weill, Actes Sud, 1998, p. 317.
À la longue – paradoxalement, dialectiquement –, « l’idéal de l’homme » deviendra l’homme lui-même : l’athéisme, l’humanisme, la suprématie de la personne, de la raison, de la subjectivité. Rappelons juste cinq repères, sur ce chemin vers la modernité : Érasme, Éloge de la Folie, Adages, Colloques, Le Libre Arbitre ; Montaigne (grand lecteur d’Érasme), Les Essais ; Descartes (grand lecteur de Montaigne), Discours de la Méthode, Méditations métaphysiques, Principes de la philosophie ; Hobbes, Léviathan ; Spinoza, la Grande Pensée-élucidation de la Bible de son Traité Théologico-politique, son Traité de l’autorité politique et – le couronnement – la proclamation « Deus sive Natura » de son Éthique.
En fait, de par sa nature, le christianisme – théandrisme / anthropothéisme – a cette vocation d’évincer Dieu, ce qui se fera au travers du dogme de la Trinité : de prime abord, en Occident, grâce au (ou à cause du) Filioque catholique, qui prône la parfaite égalité entre le Christ et Dieu (« le Saint-Esprit procède du Père et du Fils »), et, plus tard, en Europe orientale, avec le Per Filium (« le Saint-Esprit procède du seul Père par le Fils ») orthodoxe, qui maintient une différence dans l’identité.
À l’opposé, dans le judaïsme, Yahvé gardera par rapport aux hommes la distance absolue, l’invisibilité, leur inspirant ainsi la « crainte-vénération » (qui est aussi le début de la sagesse, d’après le Psaume 111 ou l’Ecclésiastique), ne communiquant avec eux que par le biais de ses prophètes ; Allah procèdera de même, dans l’islamisme. Les deux monothéismes intacts se conserveront, résisteront mieux de cette façon.
Pour Dostoïevski, le point de non-retour, son « écharde dans la chair », c’est-à-dire dans l’esprit, sera, probablement, la contemplation atterrée (toujours en août 1867, au musée de Bâle) du Christ mort de Holbein le Jeune – qui (dirais-je) trouvera son correspondant littéraire dans le cadavre puant du starets Zossima des Frères Karamazov, le roman de la mort de Dieu.
Voici le précieux témoignage de son épouse Anna Grigorevna Dostoïevskaia (dans son Journal) : « Fedor, cependant, a été complètement subjugué par lui [le Christ mort, m. n.], et il était si désireux de le voir de près, qu’il est monté sur une chaise […] » (in J. Frank, op. cit., p. 320). Dans ses Réminiscences, Anna enchaîne : « Lorsque je revins au bout de quinze à vingt minutes, je le trouvai toujours cloué au même endroit devant le tableau. Son visage agité était empreint d’une sorte de terreur, une chose que j’avais remarquée plus d’une fois dans les premiers instants de ses crises d’épilepsie » (ibid.). Et, dans les notes sténographiques de son Journal : « il m’a dit alors qu’un tel tableau peut vous faire perdre la foi » (cf. Julia Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, Gallimard, Folio essais, 1989, p. 198/note 25).
Qu’est-ce que Dostoïevski a-t-il bien pu penser devant le visage de ce cadavre sacré ? Deux hypothèses : 1° le regard du Christ dit : « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?! » ; 2° ce regard ne dit rien – car il n’est pas, il n’est plus un regard.
Dostoïevski délèguera cette commotion à deux de ses personnages (Mychkine et Hippolyte de L’Idiot, 1868), qui, devant le même tableau, « doutent de la Résurrection » (J. Kristeva, op. cit., p. 198) : « Et si le Maître Lui-même avait pu, la veille du supplice, voir sa propre image, serait-il monté sur la croix et serait-il mort comme Il le fit ? Cette question aussi apparaît involontairement en regardant le tableau » (Hippolyte de L’Idiot, trad. par G. et G. Arout, Livre de poche Classique, 2013, p. 598).
Et quand on apprend, de l’historien russe G.P. Fedotov, le rôle central joué dans la spiritualité orthodoxe russe par la « kénose » – la descente ou, disons, l’abaissement par amour de la divinité dans un corps humain pour souffrir la mort –, on peut sentir « la crainte et le tremblement » de Dostoïevski devant le cadavre du Christ de Holbein !
Ajoutons, aussi, le témoignage sarcastique de son maître (plutôt ex-maître) Bielinski, devenu (après lecture de L’Essence du christianisme de Feuerbach) athée et de gauche : « C’en est attendrissant de le regarder [Dostoïevski]. Chaque fois que je touche au Christ comme maintenant, toute sa physionomie change, absolument comme s’il allait pleurer » (J. Frank, id., p. 331).
Et cette autre lettre à Maïkov (25 mars 1870), où Dostoïevski expose « son problème principal » en ces termes : « Celui qui m’a tourmenté, sciemment ou inconsciemment, toute ma vie – l’existence de Dieu » (id., p. 516).
L’épilepsie (le « haut mal ») de l’auteur jouera également un rôle clé pour Mychkine (L’Idiot) et pour Kirillov (Les Démons), à travers l’aura (pré- ou post-épileptique), déclenchant un vécu mystico-panthéiste-naturaliste, où les indescriptibles « cinq secondes » ne seront plus parentes de la « kénose », mais plutôt de la joie spinoziste du Deus sive Natura :
« Ce sentiment est clair et indiscutable. C’est comme si, d’un seul coup, vous ressentiez toute la Nature, et, d’un seul coup, vous disiez : oui, cela est juste. […] C’est… ce n’est pas de l’émotion, c’est seulement comme ça, de la joie. Vous ne pardonnez rien, parce qu’il n’y a plus rien à pardonner. Ce n’est pas que vous éprouviez de l’amour – oh, c’est plus haut que l’amour ! Ce qui effraie le plus, c’est que ce soit si terriblement clair, et une telle joie. Si c’est plus de cinq secondes – l’âme ne le supporterait pas, elle devrait disparaître. Pendant ces cinq secondes, je vis toute une vie et, pour ces cinq secondes-là, je donnerais toute ma vie, parce que ça les vaut. Pour supporter dix secondes, il faut se transformer physiquement » (Kirillov, Les Démons, troisième partie, trad. André Markowicz, Actes Sud, 1995, pp. 230-231).
Voyons comment ce vécu merveilleux – de l’aura épileptique – sera chez Kirillov (mais non plus chez Mychkine) comme intimement, structurellement lié à la révélation de la mort de Dieu, les deux produisant, paradoxalement, un même effet, un même bouleversement nécessitant une « transformation physique » de l’être, qui, désormais, ne pourra plus supporter de vivre ni le prolongement desdites cinq secondes, ni l’après-coup du « sentiment-idée » de la mort de Dieu.
Écoutons encore Kirillov : « Je ne comprends pas comment un athée, jusqu’à présent, a pu savoir que Dieu n’existe pas et ne pas se tuer tout de suite. Avoir conscience que Dieu n’existe pas, et ne pas avoir conscience, au même instant, que tu es devenu Dieu toi-même, c’est une absurdité, sinon, obligatoirement, on doit se tuer. Si tu as cette conscience – tu es roi, tu ne te tueras plus et tu vivras dans la plus grande gloire. Mais c’est seulement le premier qui aura eu conscience qui doit se tuer, obligatoirement, sinon, qui commencera et qui démontrera ? C’est moi qui me tuerai moi-même, obligatoirement, pour commencer, pour démontrer. Moi, je ne suis encore qu’un Dieu malgré moi, et je suis malheureux, parce que je suis obligé d’affirmer mon être libre. Ils sont tous malheureux, parce qu’ils ont tous peur d’affirmer leur être libre. Si l’homme, jusqu’à présent, a toujours été pauvre et malheureux, c’est qu’il a toujours eu peur d’affirmer le point essentiel de son être et qu’il n’a dit son être que sur les bords, comme un gamin. Je suis malheureux monstrueusement, parce que j’ai peur monstrueusement. La peur est la malédiction de l’homme… Mais moi, j’affirme mon être libre, je suis obligé d’avoir la foi que je n’ai pas la foi. Je vais commencer, et je vais finir, et je vais ouvrir la porte. Et je vais faire le salut. Il n’y a que cela qui sauvera les hommes, et, dès la génération suivante, pourra les régénérer physiquement ; parce que, sous mon aspect physique actuel, avec tout ce que j’ai pu penser, être homme sans le Dieu ancien, c’est impossible, totalement. Pendant trois ans de suite, j’ai cherché l’affirmation de ma divinité, et je l’ai trouvée : l’attribut de ma divinité, c’est l’être libre ! C’est le seul moyen que j’ai pour montrer mon insoumission sur le point essentiel et cette liberté terrifiante qui est la mienne. Parce qu’elle est vraiment terrifiante. Je me tue pour montrer mon insoumission et ma nouvelle et terrifiante liberté » (ibid., pp. 278-279).
Oh combien cette pensée « trans-nihiliste » de Kirillov, sa dialectique vertigineuse, dut-elle exalter Nietzsche, par une éblouissante coïncidence avec son Zarathoustra – plus précisément, pour annoncer « […] le dernier stade du nihilisme : le moment où l’homme, ayant mesuré la vanité de son effort pour remplacer Dieu, préférera ne plus vouloir du tout, plutôt que de vouloir le néant. Le devin annonce donc le dernier homme. Préfigurant la fin du nihilisme, il va déjà plus loin que les hommes supérieurs. Mais ce qui lui échappe, c’est ce qui est encore au-delà du dernier homme : l’homme qui veut périr, l’homme qui veut son propre déclin [autrement dit, notre Kirillov !, m. n.]. Avec celui-là, le nihilisme s’achève réellement, est vaincu par soi-même : la transmutation et le surhomme sont proches » (Gilles Deleuze, Nietzsche, PUF, 2008, p. 48).
On sait que Nietzsche a lu Les Démons (en traduction française) en 1888 (deux ans après Zarathoustra), par conséquent, il n’aurait pu s’en inspirer : on ne peut que rester pantois devant cette double pensée identique !
Peut-être les deux ont-ils trouvé leur source d’inspiration chez Maître Eckhart !
Si Dostoïevski a aussi pu s’inspirer pour son Kirillov de L’Essence du christianisme de Feuerbach (comme le pense Joseph Frank, car on sait l’influence de ce livre sur Bielinski), je pense, quant à moi, que la lecture de Traités et sermons de Maître Eckart lui a été plus proche, plus déterminante ; même s’il ne lisait pas l’allemand (que le français), il a bien pu connaître Maître Eckart à travers les œuvres du moine Tikhone Zadonski, « un ecclésiastique russe du XVIIIe siècle, canonisé en 1860, qui a laissé un abondant héritage littéraire (quinze volumes) très influencé par le piétisme allemand » (cf. J. Frank, id., p. 511). En mars 1870, Dostoïevski, toujours à Maïkov, écrit, au sujet dudit Tikhone Zadonski, que « depuis longtemps [il l’a] inclus avec ravissement dans son cœur » (ibid.). Rappelons que dans Les Démons c’est un moine du nom de Tikhone qui reçoit la confession de Stavroguine ; autre « coïncidence » : le nom séculier de Zadonski était Kirillov – dont Julia Kristeva, dans Dostoïevski face à la mort, ou le sexe hanté du langage, Fayard, 2021, p. 258, dit que Dostoïevski s’est « fortement inspiré » pour le sien. Tikhone Zadonski était un « grand écrivain » qui – d’après l’historien de la théologie russe Guéorgui Florovski – a connu « ce que saint Jean de la Croix appelait la noche oscura, la ‘nuit obscure’ de l’âme » (J. Frank, id., p. 512).
Voici (d’après moi) des passages de Maître Eckhart qui ont pu parler à Dostoïevski : « L’œil dans lequel je vois Dieu est le même œil dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l’œil de Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour » (Traites et sermons, trad. Alain de Libera, GF Flammarion, 1995, p. 299) ; « Et c’est pour cela que l’homme doit être tué et complètement mort, ne plus rien être en lui-même, soustrait à toute ressemblance et ne plus être semblable à personne : c’est alors seulement qu’il est vraiment semblable à Dieu. Car ce qui fait la propriété essentielle, la nature de Dieu, c’est d’être dissemblable et de n’être semblable à personne » (ibid., p. 332), et : « C’est pourquoi saint Augustin dit : ‘Dieu s’est fait homme, afin que l’homme devienne Dieu’ » (id., p. 404) – et par-là même évince Dieu, ajouterais-je !
Je ne pense pas, comme J. Frank, que Kirillov soit juste un prolongement du « côté démoniaque et luciférien de la personnalité de Stavroguine » (J. Frank, id., p. 648), comme c’est bien le cas – et, là, je suis d’accord avec J. Frank – de Chatov, qui représente bien « la quête de la foi si profondément enracinée en Stavroguine qu’il cherche à reconnaître ses crimes et s’en repentir » (ibid.).
Kirillov est un personnage singulier, qui respire une certaine grandeur – le nihiliste métaphysique-existentiel, qui, avant de s’arracher au monde sans Dieu, au monde tout court, a eu la folie de vouloir être au-delà du Bien et du Mal, mais, assumant une indifférence morale absolue, il s’est fait leurrer à rédiger et signer cette lettre (où il avouait le double meurtre de Chatov et de Fedka) que lui demandait Méphistophélès-Piotr-Stépanovitch, car il ne rend ainsi qu’un dernier service à la propagation du Mal dans le monde !
En se mettant à créer son Ivan Karamazov, l’alchimiste Dostoïevski a dû couler aussi en lui la substance – une synthèse – de Stavroguine et de Kirillov.
Car ses romans regorgent de doubles, demi-doubles, quarts de doubles ; en fait, il y a une mutation continuelle, comme si des « qualités », des « traits », migraient d’un personnage à un autre – le même/l’autre : il s’agit là d’un laboratoire ontologique, d’une work in progress. Tout comme le seront les œuvres de Musil, de Kafka, de Joyce…
Quand Dostoïevski (dans une lettre à l’éditeur Katkov) écrit que : « Stavroguine est un personnage tragique… À mon avis, il est à la fois russe et typique… C’est dans mon cœur que je suis allé le chercher… » (J. Frank, id., p. 628), il aurait aussi bien pu dire la même chose de Kirillov – et de tant d’autres, certes, Ivan Karamazov en tête !
Ivan : un Job chrétien devenu athée devant son Dieu et devant le Christ (voir, surtout, la fin de son dialogue avec Aliocha, dans le chap. « La Rébellion » et la suite, « Le Grand Inquisiteur ») ; proche, aussi, du terrible brigand Tche (voir Tchouang-tseu, Œuvre complète, chap. « Tche le brigand », trad. Liou Kia-hway, Gallimard/Unesco, 1989) : de son rugissement de révolte devant Confucius, et non pas de son cynisme intégral (bien qu’en esprit ironique il le feignît).
Je dirais qu’en fait il y a deux Ivan : celui qui atteint son apogée dans « Le Grand Inquisiteur » et celui qui entame sa descente, puis sa chute dans la folie, dans la schizophrénie entretenue, alimentée, exacerbée par les trois conversations avec son demi-frère bâtard Smerdiakov (mélange de Tartuffe, d’Uriah Heep, d’Iago et de quelque chose de typiquement russe) : ça tourbillonne (un vent gogolien souffle dans sa tête), Dieu et le diable reviennent visiter l’athée, faisant de son cœur et de son esprit leur « champ de bataille » ! Mais, paradoxalement, à travers le voile du dédoublement schizophrénique (le fantasme Ivan-diable parlant à Ivan), on pourra voir resurgir le premier Ivan, le philosophe athée mais ayant conquis une toute nouvelle vérité existentielle (une autre sorte de Kirillov !), où, l’espace de quelques instants, la formule « tout est permis » brillera avec un autre sens et une autre destination, grandioses et naturels, à la foi surhumains et on ne peut plus humains (on serait tenté de faire l’éloge érasmien de cette folie) :
« ‘[…] À mon avis, point n’est besoin de détruire, il suffit d’anéantir dans l’humanité l’idée de Dieu, voilà par où il faut commencer ! Par là, c’est par là qu’il faut commencer, ô aveugles qui ne comprenez rien ! Une fois que l’humanité tout entière aura abjuré Dieu (et j’ai foi que cette ère, par analogie avec les ères géologiques, adviendra), toute l’ancienne conception du monde tombera d’elle-même, sans anthropophagie, et surtout toute l’ancienne morale, et quelque chose d’entièrement nouveau commencera. Les hommes s’uniront pour prendre de la vie tout ce qu’elle peut donner, mais expressément pour leur bonheur et leur joie dans le seul monde d’ici-bas. L’homme s’élèvera grâce à un orgueil titanesque de dieu, et l’homme-dieu naîtra. Vainquant la nature à chaque heure, par sa volonté et sa science, et cette fois sans limite, l’homme en éprouvera par là même à chaque heure une si haute jouissance qu’elle remplacera pour lui toutes les anciennes espérances de délices célestes. Chacun saura qu’il est entièrement mortel, sans résurrection, et acceptera le sort orgueilleusement et avec calme, comme un dieu. Il comprendra par orgueil qu’il n’a pas à murmurer si la vie ne dure qu’un instant et il aimera alors son frère sans plus attendre aucune récompense. L’amour ne satisfera que l’instant de la vie, mais la conscience même de sa brièveté en intensifiera la flamme autant qu’autrefois elle se dispersait en l’espoir d’un amour après la mort et l’infini’… […] Mais étant donné que, par la faute de la bêtise humaine invétérée, cela ne se réalisera peut-être même pas d’ici mille ans, il est loisible à tous ceux qui, d’ores et déjà, sont pénétrés de cette vérité de s’organiser absolument comme il leur plaira, sur des bases nouvelles. En ce sens, ‘tout leur est permis’. [On se rappellera qu’auparavant, au ‘stade’ du Grand Inquisiteur, Ivan, dans son article, déclarait, avec scepticisme et dans un tout autre sens, plutôt hobbesien, de la ‘guerre de chacun contre chacun’ : ‘S’il n’y a pas d’immortalité de l’âme, il n’y a pas non plus de vertu, donc tout est permis’ (Les frères Karamazov, tome 1, trad. Élisabeth Guertik, Le Livre de Poche, 1992, p. 102), m. n.] Bien plus : même si cette ère ne vient jamais, et comme Dieu et l’immortalité n’existent néanmoins pas, il est loisible à l’homme nouveau de devenir homme-dieu, fût-ce seul dans le monde entier, et bien entendu, dans sa nouvelle dignité, de franchir, si besoin est, toute ancienne barrière morale de l’ancien homme-esclave. Pour Dieu il n’est pas de loi ! Où Dieu se tiendra, là est la place de Dieu ! Où je me poserai, là sera aussitôt la première place… ‘tout est permis’, et baste ! » (ibid., tome 2, pp. 299-300).
Comme, ci-dessus, c’est « le diable » qui parle, ici « l’esprit qui toujours nie » devient l’esprit qui toujours lie : l’homme à sa vie, sa nature à la Nature, son être au devenir, aux mutations… à l’exception, peut-être, d’une expression en contradiction avec tout ce qui lui précède : « Pour Dieu il n’est pas de loi ! » ; en contradiction, car – même pour un homme-dieu, ou un surhomme, c’est-à-dire un homme débarrassé de Dieu – il y aura toujours une loi à « assimiler », à « incorporer » pour pouvoir la « dépasser » et suivre son propre devenir, sorte d’Aufhebung hégélienne ! Autrement dit, avec Spinoza, la vraie, l’unique liberté est la nécessité comprise !
Pour ce second Ivan – un authentique socialiste libertaire –, l’homme ne sera plus esclave, ni dieu, mais aura la faculté, le pouvoir d’exercer un libre arbitre relatif au sein de la condition de mortel, sereinement acceptée. (Ce qui pourrait nous rappeler la célèbre polémique du début de l’humanisme entre Érasme et Luther : l’un adepte d’un libre arbitre minimal accompagnant, étayant la grâce divine ; l’autre niant rageusement tout libre arbitre et exaltant la grâce augustinienne !)
On a du mal à concevoir que Nietzsche n’ait pas lu ces passages karamazoviens ! Certes, pas de trace, de preuve d’une telle lecture : hélas, sa propre sœur Elisabeth, possessive et jalouse, s’était occupée de ses archives, et, comme bien on sait, a essayé d’assujettir l’œuvre de Nietzsche au national-socialisme ! Mais qui sait ? un beau jour peut-être trouvera-t-on ses notes et ses phrases recopiées des Frères Karamazov !
Difficile de ne pas être troublé par cette coïncidence dans la folie entre le philosophe et un personnage de fiction : c’est comme si l’un répétait le destin de l’autre… Mais, alors qu’à travers la folie érasmienne d’Ivan Dostoïevski nous dit son dernier mot lumineux, celle de Nietzsche n’entraînera que la déchéance de tout son être.
Les romans dostoïevskiens, où fleurissent le dialogisme, la polyphonie (Bakhtine, in J. Kristeva, Dostoïevski, pp. 44-47), sont autant de tragi-comédies / comédies tragiques, sinon (j’oserais l’oxymore) de vaudevilles abyssaux, des vaudevilles à la Dostoïevski ; où, tout comme chez Shakespeare : « le réel et le fantastique, le tragique et le comique, le noble et l’ignoble sont également présents dans sa vision de la vie » (cf. George Steiner, La mort de la tragédie, trad. par Rose Celli, Gallimard, Folio essais, 1993, p. 30). Rappelons la conception du réalisme fantastique dostoïevskien : « J’ai une vision particulière de la réalité (dans l’art) ; ce que la plupart des gens qualifient d’exceptionnel et de presque fantastique représente souvent pour moi la substance même du réel » (lettre à l’éditeur Strakhov, J. Frank, id., p. 481).
Daniel ILEA©Août 2023.