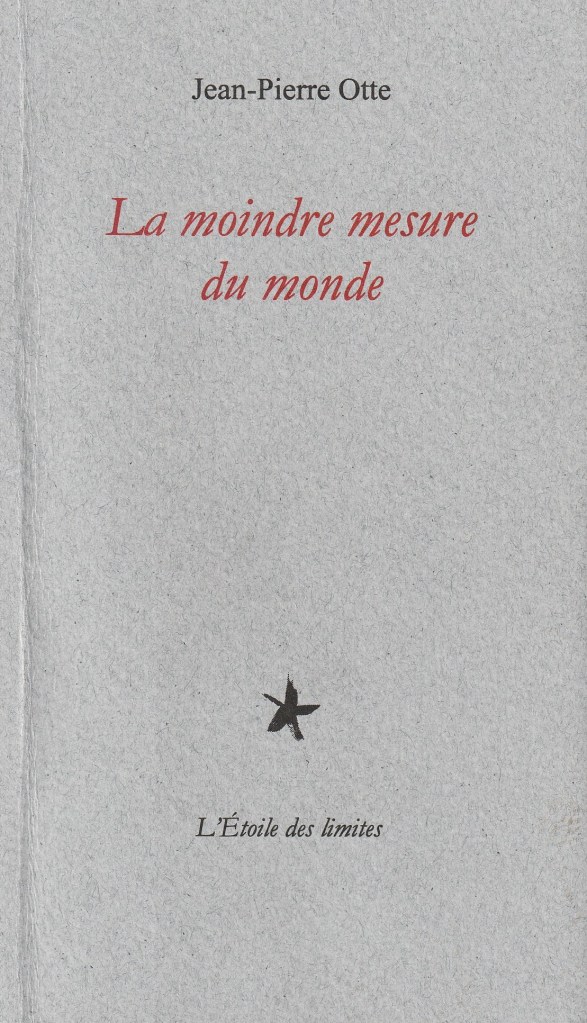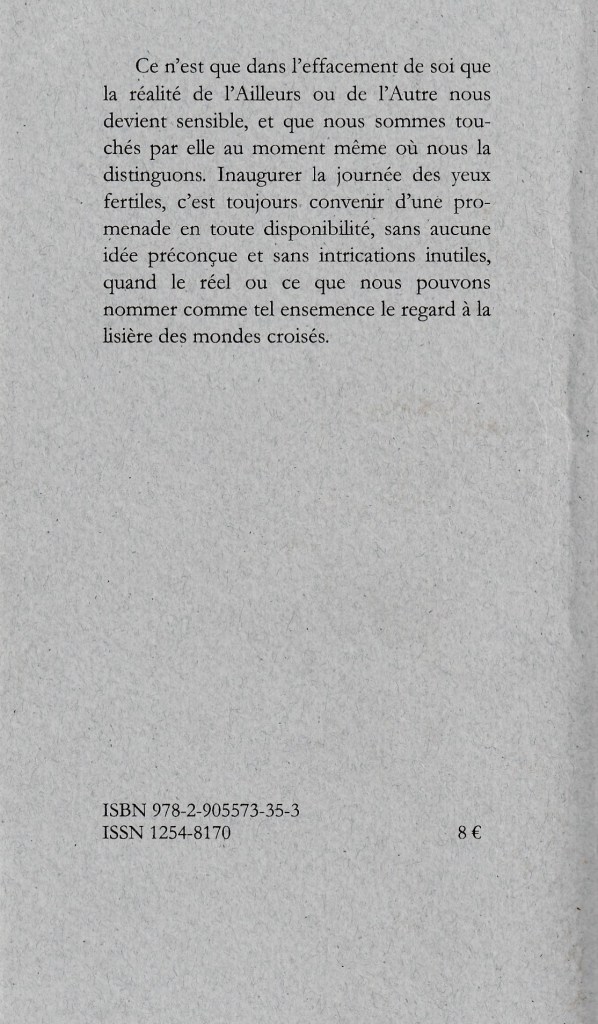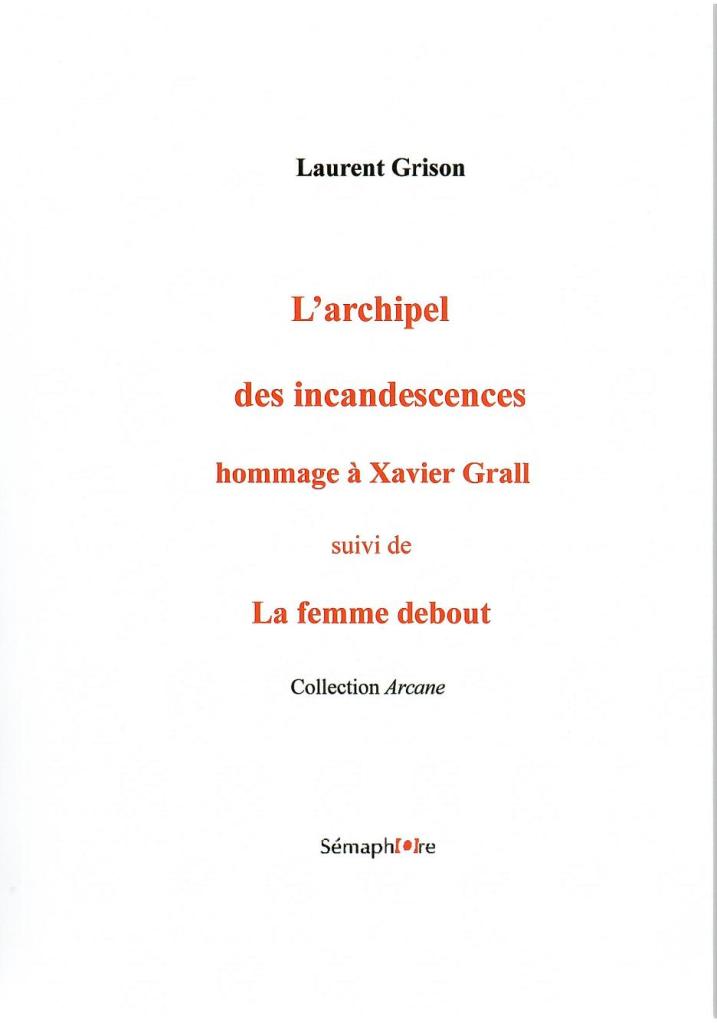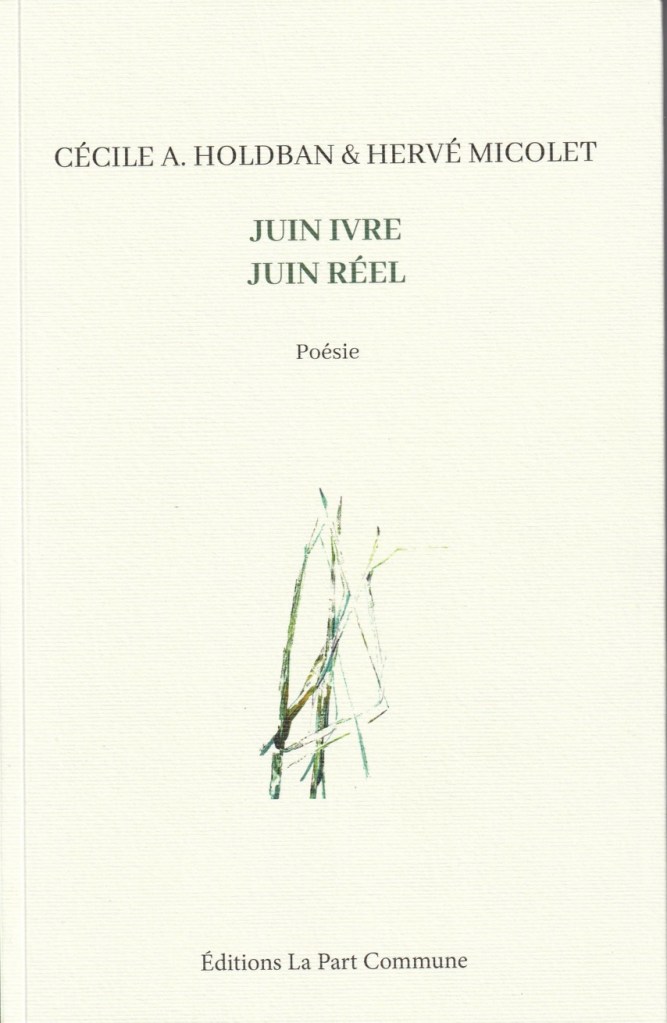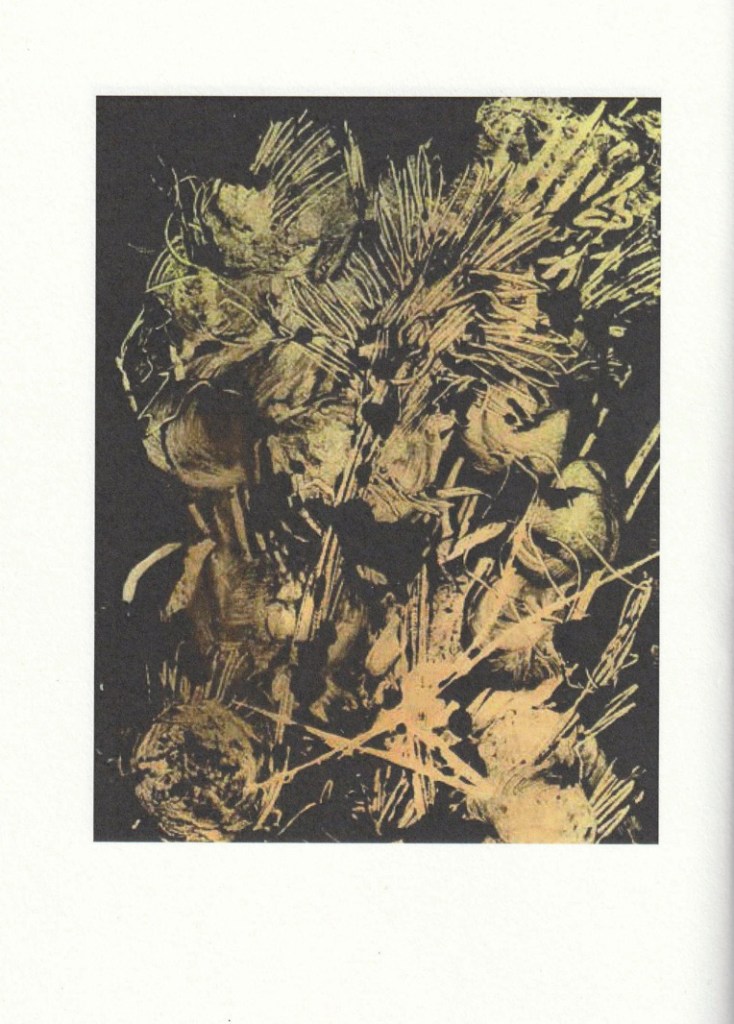Une chronique de Marc Wetzel
Jean-Pierre OTTE, La moindre mesure du monde, L’Étoile des limites, 56 pages, septembre 2023, 8 €
Que peut bien signifier prendre « la moindre mesure du monde » ? Sûrement se rapporter différemment à lui, mais comment ? « La moindre chose » veut dire, non une « chose moindre » (plus basse, plus faible, moins importante), mais plutôt : tout ce qui mérite d’être pris en considération (comme tous les détails comptent lors d’une enquête) ou vaut d’être examiné, si contingent ou particulier que ce puisse être. Comme s’il s’agissait plutôt de ne négliger aucun battement de cils d’un oeil, même si tous les regards ne se valent pas. Il y a bien l’idée d’une diminution, d’une abstention, d’une suspension en tout « moindre » (comme l’est l’intérêt qu’on écarte), mais aussi d’un soulagement (un moindre mal), du choix judicieux de s’en tenir à, de rabattre ses prétentions ou adapter la norme (comme on réduit la voilure pour prévenir les effets de la tempête).
L’auteur s’en explique en poète, en arpenteur de paysages, en homme méditatif (puisqu’il est tout cela), ainsi :
« La moindre mesure du monde était à la fois nulle part et partout, dans une figure striée sur la plage, des téguments desséchés parmi les couteaux et les coques rejetés par les vagues, des empreintes de pattes palmées ou des pertuis qui signalaient les palourdes enfouies.
Et cette moindre mesure était aussi bien à éprouver sous la peau, dans l’atmosphère intérieure, quand l’esprit s’attachait à tel élément de l’ensemble ou à un événement dans ses particularités » (p.26)
On voit que le loisir du promeneur est une tâche d’observation ou d’approfondissement; on devine que l’attachement aux plus humbles éléments du monde est à la fois simplification de l’expérience, et sophistication de son attention; on comprend que le « monde intérieur » est lui aussi concerné par cette ascèse, cette réduction hygiénique des évidences usuelles et des certitudes générales. Mais c’est bien le monde réel (dans son rassemblement concret, dans ses ressources et failles caractéristiques, dans son indépassable habitabilité aussi) qu’on sort ici vivre autrement – et cette « moindre mesure du monde » dit le monde réduit, non à sa plus simple ou plus sommaire, mais plutôt à sa plus propre expression ! L’intuition du poète est que le monde est à lui-même son propre et seul lieu de présence possible, qu’il ne peut pas, lui, se fuir lui-même, qu’il a ou est l’expérience de lui-même dans ses moindres détails, qu’il assume sa propre inscription dans l’espace et le temps parce que sa réalité n’en a pas d’autres ! C’est donc comme si l’on suivait ici le monde dans son ascèse à lui, cherchant en et avec lui la source dont il repart perpétuellement, l’accès par lequel il se rouvre indéfiniment à lui-même, le bureau d’accueil où se signale et vient s’inscrire sa propre expérience.
Cette « réduction » du monde à son noyau restreint, mais originaire, de présence objective rappelle – diraient les philosophes – la réduction phénoménologique (qui veut accueillir les manifestations du monde à et par la source pure et vraie de tous leurs aspects), mais la démarche de Jean-Pierre Otte s’en écarte résolument : d’une part parce que cette source des phénomènes est ici en eux (même si l’esprit en présence des choses est leur témoin), et d’autre part, surtout : ce n’est pas d’abord le langage qui mène la danse ici, mais bien l’expérience d’un corps vivant qui, précise la première page du livre (p.9), prend l’initiative d’un « égarement », qui va « marcher sans pensées le long d’un rivage », qui suspend les allées et venues des « images » de l’esprit en lui, qui mène et orchestre lui-même la « détente » de sa « disponibilité » ! Ici, donc, contrairement à l’effort philosophique, le discours poétique ne fera que raconter, après-coup, une réduction (du monde à sa présence significative) que lui-même (le discours) n’aura pas conduite ! Ainsi, c’est Jean-Pierre Otte en personne, non d’abord sa parole, qui mène à bien cet exercice de lucide égarement, visant à « permettre la présence au réel du monde ».
On l’y suivra, en quatre brefs mouvements, avec émotion et fruit, depuis un départ en train de nuit vers la côte (on ne saura pas quelle est la « petite ville balnéaire » où il arrive avant l’aube, mais la boucle pédestre s’y achèvera aussi) jusqu’au redépart – vagabonde escapade que la dernière page résume ainsi :
» … je regagnai la gare dont les grandes fenêtres reflétaient le soleil de fin de jour avec des rougeoiements clairs à la barre de l’horizon. J’allai d’un pas égal, me délestant de tout au fur et à mesure« (p.45)
La familière expression « au fur et à mesure » semble ici désannoblir en souriant cette assez solennelle « moindre mesure du monde » du titre. Comme le dit cet un peu baroque « fur » (qui déforme « forum », comme un bal de places à parcourir), des états de présence se succèdent ici comme les étals d’un marché, ou comme les prix de ce qu’ils proposent. La promenade décalée avait bien ce simple but : « inaugurer la journée des yeux fertiles » en arpentant le monde des réelles places du monde.
Le lecteur verra l’auteur y faire danser naturellement son ombre (et méditer sur une nuit signant paradoxalement la fin des ombres), puis suivre la danse propre des nuages (réduisant leur apparente fixité à leurs superposées errances, à la compensation perspective de leurs développements), ou celle des algues sous le retour au rivage des rouleaux. Il l’entendra en une conversation avec lui-même « dégagée de toute idée d’imposer une idée », devant une salle de restaurant encore vide, où tables et chaises dessinent déjà en creux, entre et sur elles, la convivialité qu’elles logeront. Il admirera l’auteur d’apprendre à percevoir le réel tel que celui-ci n’est pas encore passé par lui, tel aussi que le poète ne se le sera cette fois pas, par rêveries et préjugés, pré-mâché. Il y accompagnera un animateur intérieur de prodiges :
« Si une frontière existe quelque part entre ce qui est ordinaire et ce qui ne l’est pas, comment savoir de quel côté on se trouve par rapport à elle ? » (p.25)
Il le sentira buter sur les murs temporels de l’enfance, murs de la plus compacte des brumes, en revoir comme en rêve quelques souvenirs justement parce qu’à cette époque d’elle-même une vie ne pouvait que se rêver (p.33). Et snober un « irréel » un peu asphyxiant ou restrictif, au strict profit d’autres manières d’être réel ! L’eau du sens maintiendra mieux en elle l’éclat de signes de présence qui sècheraient bien vite, « ternes et terreux », si l’on en retirait les cailloux immergés :
« De la même manière, quand la matière ne fait pas défaut, il faut que le langage roule sur les motifs pour en libérer l’aspect versatile, le charme chatoyant » (p.35)
Et, puisque « c’était de l’accès à sa propre présence dont il était question », on laissera le lecteur témoin de cet étrange et rare effort de trouver l’escalier du dedans – celui qui hiérarchise naturellement les degrés de l’accès nouveau à soi – toujours en présence ici de filles et de femmes croisées (les hommes ne portent pas sur eux le mode d’emploi de leur être, et leur présence n’apprendra rien sur celle du monde !), comme cette « jeune fille vaporeuse, qui devait sans doute le plus clair de sa féminité à une détermination innocente, ou à quelque chose d’irréfléchi, de rêvé et de fier » (p.37), ou cette femme (« au chignon serré d’un élastique rouge », p.43) dont la « nudité » sur le sable, « dépouillée de toute substance érotique« , apparaît à l’auteur comme « le seul prolongement à la ligne invisible qui nous relie au mystère (et aussi bien à l’absence de mystère) » !
Les virtuoses de la présence donnée sont rares, même chez les poètes. Jean-Pierre Otte – qu’on lira plus longuement dans « Mes anticorps » (Le Temps qu’il fait, 2023) et « L’immunité merveilleuse« (Sans escale, 2024), ses deux remarquables récents ouvrages – est du lot, avec, je crois, deux contemporains de même force : Jacquy Gil et Joël-Claude Meffre – nous rendant sensible, dans « l’effacement de soi », cette disponibilité du monde à lui-même qui est le plus pédagogue des mystères, la plus fraternelle des énigmes.