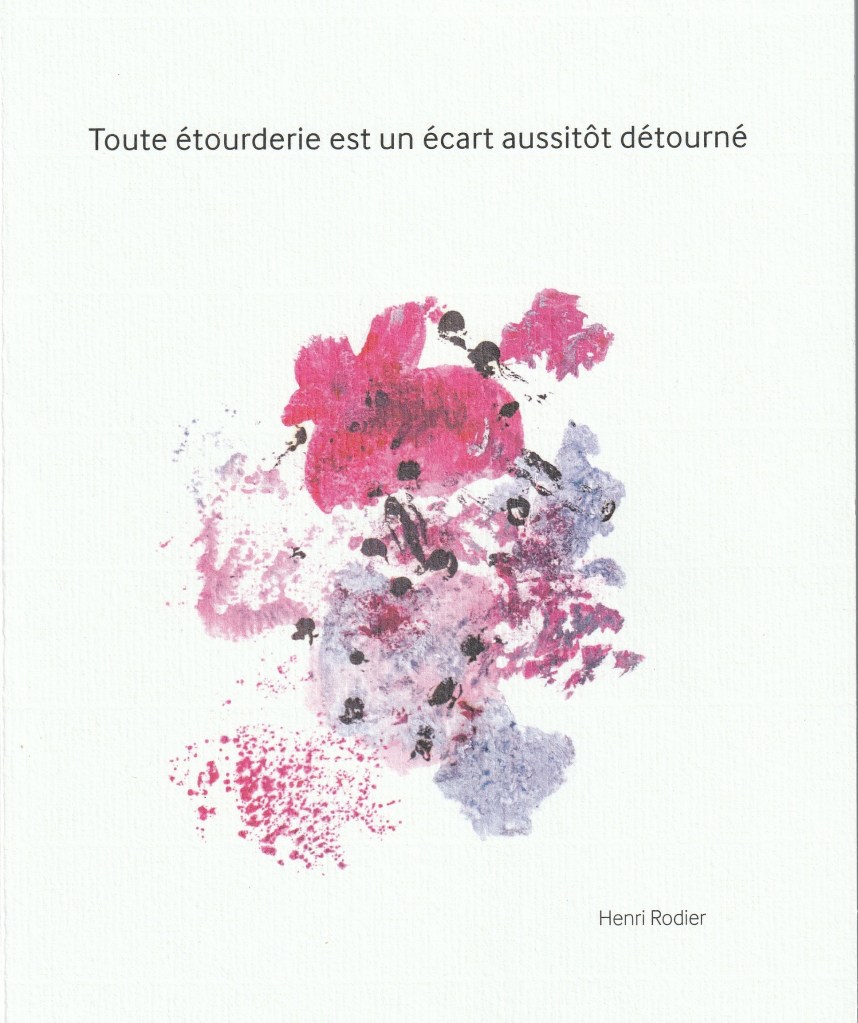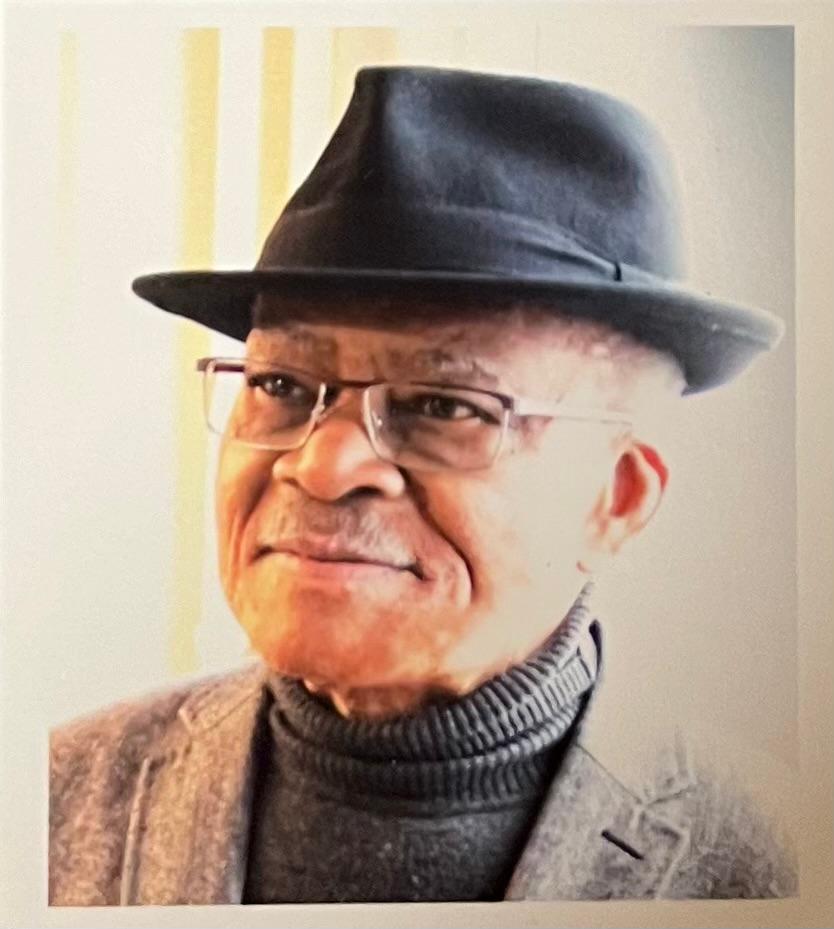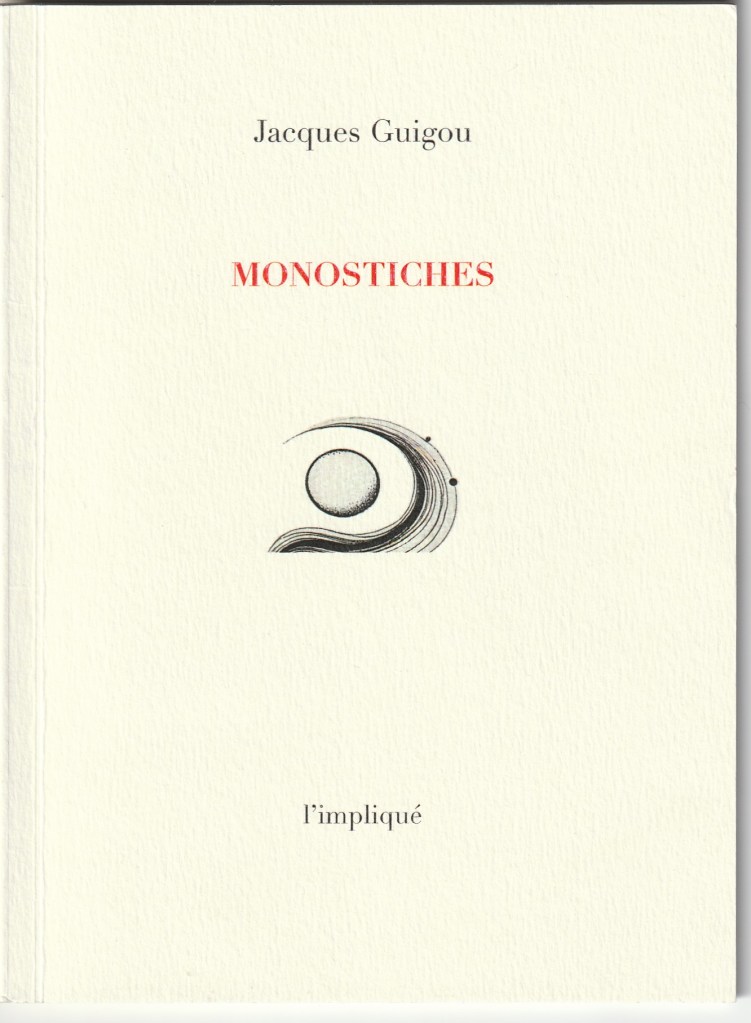Une chronique de Marie-Hélène Prouteau
Mêmes, Un Richelieu de Marie Sellier, Maison de négoce littéraire Malo Quirvane, Collection XVIIe, 2024, 48 pages, 10€.
La Maison de négoce littéraire Malo Quirvane trace son sillon de façon indépendante, en liberté grande. Sous le beau vocable de « négoce littéraire » elle se place dans le registre d’un singulier commerce qui lui a permis de découvrir de vraies pépites. Elle se spécialise dans la publication de textes courts qui nous font quitter le bruit du monde.
Avec la Collection XVIIème, la maison d’édition demande à des écrivains de se rendre au musée du Louvre, d’y choisir une œuvre peinte au XVIIème siècle et d’écrire un texte autour de ce tableau. Ici l’écrivaine Marie Sellier, devant la toile figurant le cardinal Richelieu par Philippe de Champagne, a eu un vrai choc en reconnaissant quelque chose de sa grand-mère maternelle.
Ce court texte Mêmes opère un rapprochement insolite et d’abord déconcertant entre le grand serviteur de l’État à l’âge classique et la grand-mère Édith S. née M. dans une famille de grands capitaines d’industrie. Quoi de commun entre Édith et Armand Jean, le prélat de province à l’ascension fulgurante, devenu évêque à 21 ans puis surintendant de la maison de Marie de Médicis et ministre de Louis XIII ?
Tête menue,
nez tranchant,
teint jaune,
ce visage, votre visage,
fiché au sommet d’un bouillonnement d’étoffe
rouge et de dentelle fine
Dans ce double portrait, Marie Sellier décèle les détails par le menu, comme au travers d’une lentille d’optique : le visage, le nez, les mains décharnées et osseuses, les traits physiques d’un corps délabré. Elle capte ces signes au vol en habituée, elle qui a produit des écrits et des films documentaires sur de nombreux peintres ou sculpteurs. Son regard se glisse dans le portrait en majesté de Philippe de Champaigne, le peintre du baroque janséniste apte à saisir les « vanités ». Il le rapproche du tableau du Cardinal sur son lit de mort, exposé de temps en temps, au palais Conti, pour rappeler aux grands immortels celui qui créa la célèbre institution. Marie Sellier aime ainsi retrouver, jusque dans la mort, la ressemblance du Cardinal et d’Édith qui en aurait été flattée.
Car Marie Sellier met en péril ce qui est de la pose et de la grandiloquence. Elle souligne chez les deux personnages le souci mondain du paraître, du prestige et des marqueurs sociaux, elle en voit la face cachée, la mesquinerie et l’ambition au plus haut point. Point d’image sacralisée ici d’Armand Jean ou d’Édith.
C’est une écriture caustique, au scalpel, parfois, poétique souvent, qui se déploie dans ces pages. Marie Sellier manie la liberté inventive de la langue, tel le savoureux passage en revue des chapeaux des deux personnages depuis la « barrette » cardinalice jusqu’au « bibi » grand-maternel. Elle offre l’alliance inattendue entre le beau style à l’imparfait du subjonctif et la comptine enfantine qui, avec facétie, s’amuse de la « barbichette » du célèbre prélat. Il n’y a pas de héros pour son valet de chambre, dit un proverbe connu, repris par Hegel.
Dans ces pages, perce, on l’aura compris, un regard sans concession. Mais aussi, par moments, le regard de tendresse de la petite-fille qui a repéré une douleur chez cette singulière grand-mère et se revoit lui caressant le front pour soulager ses maux de tête. Encore un point commun avec Armand Jean, « la souffrance en partage /celle de l’âme comme celle du corps ». Dans Mêmes, Marie Sellier fait descendre de son piédestal le grand ministre en « cappa magna » pourpre de Philippe de Champaigne, décapant au sens propre la figure d’apparat des livres d’école primaire. Elle l’humanise de son regard vivifiant, tonique, en le rapprochant de celle « dont le ministère ne dépassait pas le champ de l’intime, dont les emportements ne faisaient trembler que tes proches, alors que ton célèbre alter ego semait la terreur en Europe ».
L’écrivaine déroule ici par petites touches un destin féminin corseté de fille de la bourgeoisie, d’une lignée des industriels des Houillères de Dombrowa, confinée traditionnellement à l’intérieur et à la maison, les études étant interdites aux filles. Édith S., mal aimée de sa mère, en garda-t-elle cette extrême dureté pour ses enfants et ses petits-enfants ? Le souvenir de Marie vibre encore de quelque geste vif pour une note écorchée au piano. Mais elle a de l’affection pour cette personnalité forte, peu commune. Marie Sellier ne montre-t-elle pas cette « petite bonne femme » capable de faire sortir son mari du camp allemand où il était prisonnier de guerre ? Et puis, la compassion de la petite-fille écrivant pointe lorsqu’elle évoque le drame secret de cette femme qui, lors d’un accident de voiture, a malencontreusement écrasé les jambes de sa mère. Drame déjà abordé dans un précédent livre, Le Secret de grand-mère, album illustré pas Armande Oswald, paru au Seuil. Comme si, inscrit dans la mémoire familiale, ce drame n’en finissait pas de retentir.
Le texte se clôt sur un memento mori émouvant où Marie Sellier prend conscience que l’oubli des deux personnages est inéluctable. Tant pour l’homme-effigie des billets de banque désormais obsolètes que pour la photo grand-maternelle perdue dans les « naufrages des maisons de famille » que plus personne ne saura reconnaître. Mais ses mots d’écrivain, associés au pinceau de Philippe de Champaigne, Marie Sellier sait qu’ils attesteront de la vie passée, tel est le pouvoir de l’art de laisser pour l’éternité la marque indélébile d’une émotion vraie.