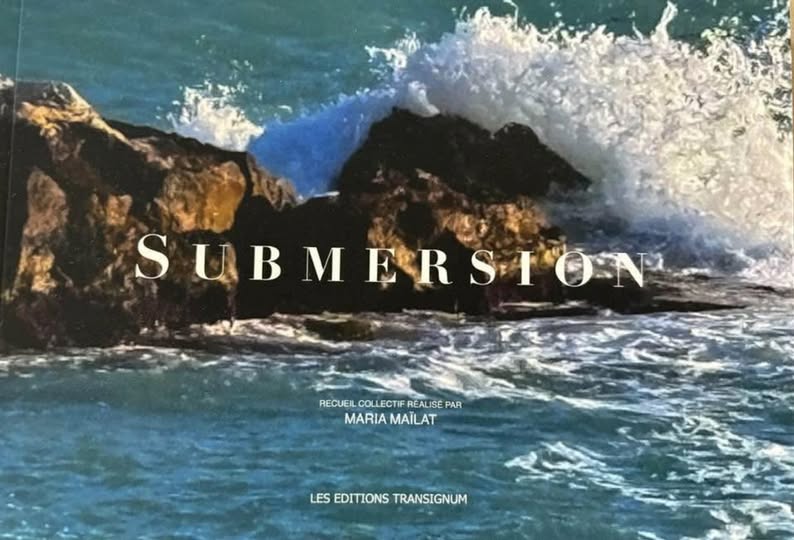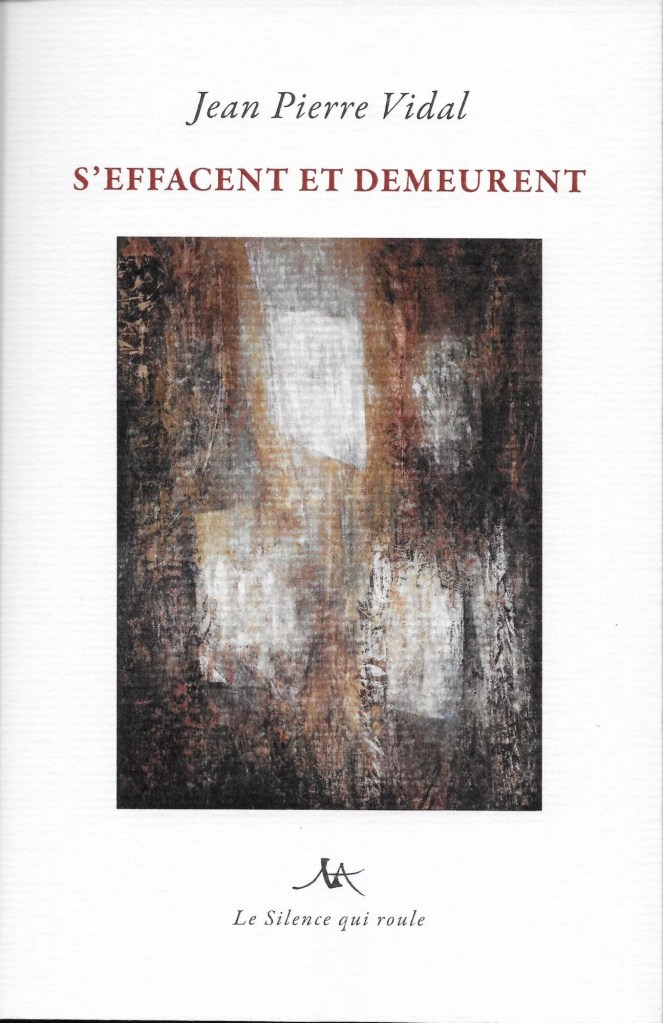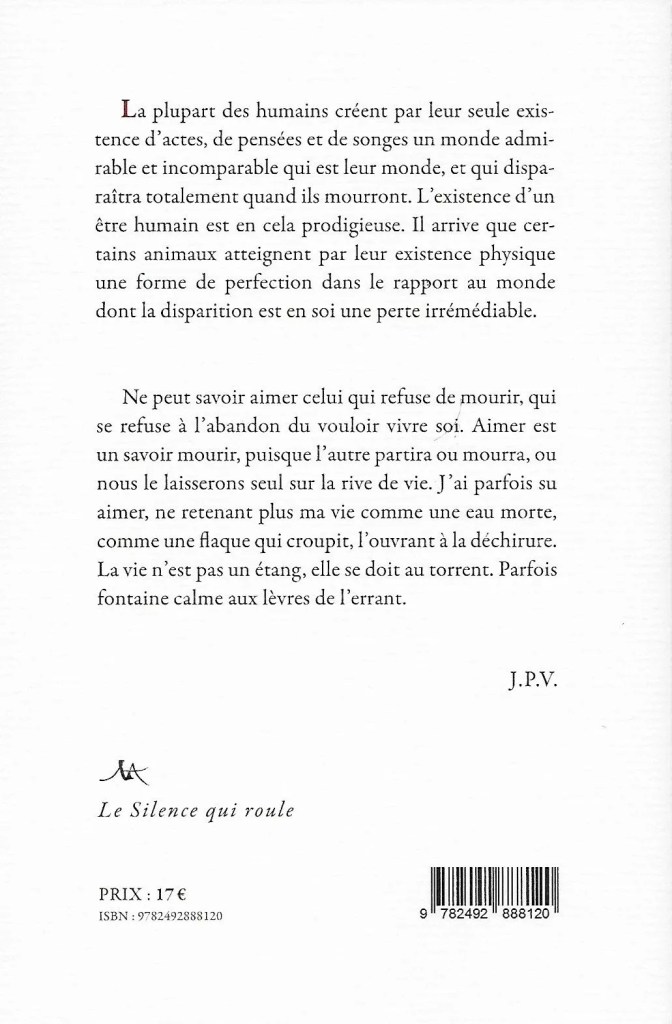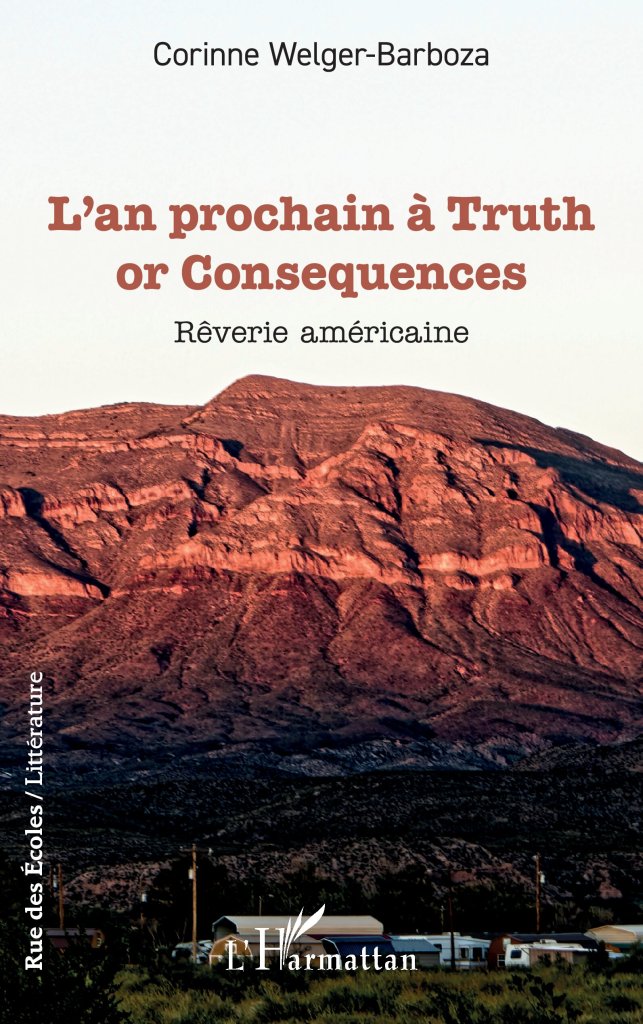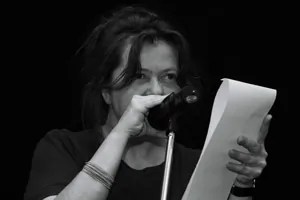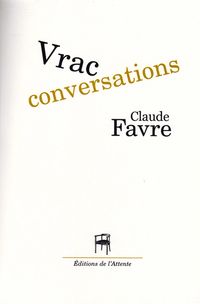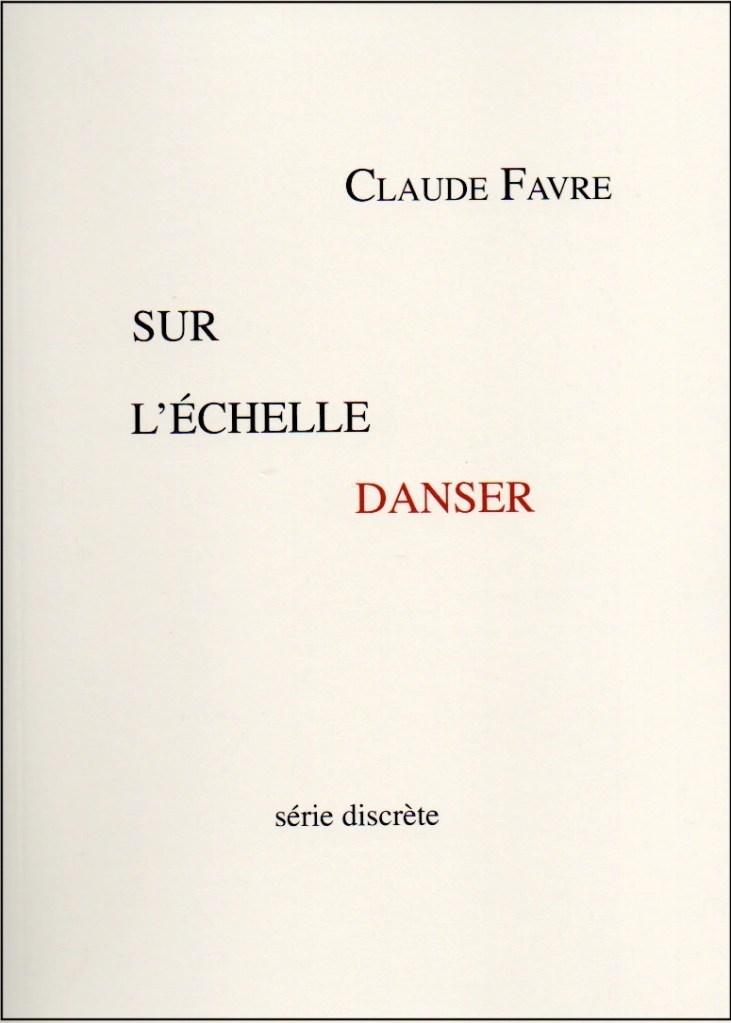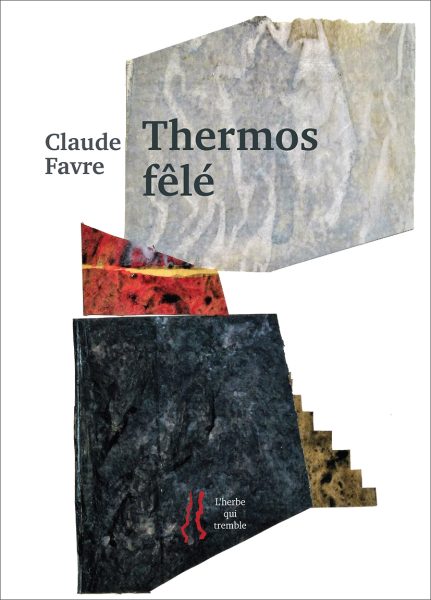Une chronique de Marie-Hélène Prouteau
Submersion, recueil collectif réalisé par Maria Maïlat, Paris : Les Editions Transignum, 2025, 103 pages, ISBN 978-2-494682-28-3, 15 euros.
La mer est, par nature, ce qui échappe, ce qui ne se circonscrit pas en un paysage. Ce qui reste imprévu, invaincu. « Une idée insaisissable s’étire dans l’étendue indéfinie du fracas maritime ». Par ces mots puissants du poème inaugural, Claude Ber nous met d’emblée en face de la tonalité du recueil Submersion. Avec la métaphore vive de Claude Ber s’ouvrent les 18 contributions de poètes présents dans le livre. Ainsi que les 35 photo-images de Maria Maïlat. Ces images, composées, ponctuant le fil du recueil de leur inventivité magique sont une vraie réussite. Les couleurs luxuriantes et les lignes fluides jouent entre elles en de superbes collages. Tels sont les « poiê&mages », selon l’expression de Maria Maïlat, d’un merveilleux monde de la mer, de ses rives et de ses fonds.
La mer, les vagues incarnent au plus haut niveau le lieu d’une fusion sensuelle avec l’eau, les secrets désirs, l’absolue liberté du corps dans l’exercice de la nage. François Coudray écrit : « Quand le rire solaire de nos corps livrés tout entiers à leurs assauts », tandis que Catherine Pont-Humbert explore un vieux rêve : « je suis une femme océan ».
Comme dans nombre de mythes, la mer renvoie ici à l’élément premier, archaïque, enclenchant une extraordinaire puissance de rêverie. Alice-Catherine Carls parle ainsi « des douces courbes des mers anciennes ». Dans le même esprit reliant les éléments du cosmos, « la mer raconte la lumière de la lune », écrit l’écrivain et plasticien Davide Napoli. On comprend aisément pourquoi la mer nourrit un certain esprit d’enfance. Celui qui irradie les rêveries analogiques de Carole Carcillo-Mesrobian : « Tes pas lourds des chevelures/ d’algues la mer ».
La mer nourrit communément les légendes de l’errance. Ainsi s’entrecroisent dans le recueil celles d’Ithaque, du capitaine Achab ou du vaisseau fantôme. Chez Marilyne Bertoncini : « la mer où l’on se perd comme le vaisseau fantôme : errant sans cesse ». Et Martine Biard revisite le mythe d’Ulysse : « je ne veux pas que tu repartes sur une mer de larmes ».
Que la mer ramène, comme chez Marilyne Bertoncini, aux falaises d’Albion, ou, chez d’autres poètes, à la Méditerranée ou à l’océan, ce qui frappe, c’est qu’elle est saisie comme une matrice originelle, universelle, et non dans une approche pittoresque. Les photos-images de Maria Maïlat illustrent ce parti-pris non circonstancié. Michel Collot ne parle-t-il pas d’une « structure de mer » ? La mer figure ainsi l’image du toujours recommencé et du cycle de l’éternité. Lara Dopf évoque le « sablier filant entre tes paumes ». Francesco Pittau, lui, « la mer bave son éternité ». Et Delia Popa nous rappelle que « l’eau de la mer revient/comme l’annonce d’une peine déjà rêvée ».
D’autres poètes nous rappellent que la mer est le lieu des tsunamis, de l’effondrement des empires, de la violence de l’histoire. « Qui/ de la mer ou de l’histoire / se réfléchit dans l’autre » se demande Philippe Tancelin. « Et l’Europe et l’Afrique ont la mer pour partage » écrit de son côté Guillaume Condello. Le sentiment de la perte, de l’exil traverse le poème de Sabine Huynh qui a connu l’épreuve des Boat People : « Que dit la mer aux blessés de la terre ». Et pour Maria Maïlat qui a dû s’exiler de sa Roumanie natale, « tes roulis d’exode déferlent dans la splendeur d’une nef ». Cette mer est de celle que l’on traverse souvent sans retour, celle qui sépare tragiquement, définitivement. Il existe pourtant des instants qui font un heureux contrepoint: « Le phare en nous, et son vertige clair, peut-être ».
La puissance signifiante du thème marin a suscité dans ces pages le parallèle entre la mer et le poème. Sabine Zuberek le développe ainsi : « écrire/toujours convoque la mer ». Et, de son côté, Pierre Astan a ces mots lumineux : « le poème vient de l’horizon intermittent, plein de paroles et d’écume ».
Il faut saluer l’aventure collective que sont ces variations pélagiques grâce à l’impulsion toute particulière de Maria Maïlat. « Celle qui vient d’une mer étrangère », selon ses propres mots, est précisément celle qui offre généreusement l’hospitalité langagière et poétique à 18 poètes. Qu’elle en soit remerciée.