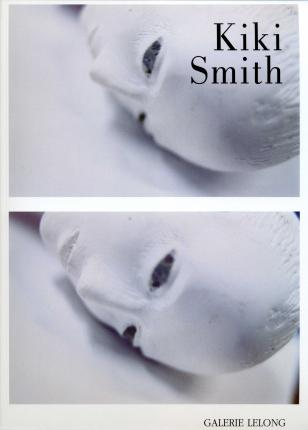-
Sarah Hildebrand, Chez soi, textes et dessins, 96 pages, coll. « Re : Pacific », éditions art&fiction, Lausanne, 2013.
Sarah Hildebrand a l’odeur de sainteté en horreur. Pour autant son « exhibitionnisme » cache une extrême pudeur. L’ostentation possède toujours chez elle un aspect particulier : il s’agit d’une manière de se soustraire afin de mieux faire surgir les secrets les plus intimes. Dans ses dessins tout est suggéré de manière métaphorique sous formes de lignes plus ou moins directrices sur lesquelles s’adjointes des torsades échevelées. Avec Chez soi, textes et dessins créent une œuvre originale. Souvent ce « chez-soi » dans le langage courant est devenu une panacée qui fait les beaux jours des magazines et des magasins de décoration. Mais l’auteur renverse ce concept pour le porter plutôt vers la notion chère à Bachelard : « la maison de l’être ».
Les interrogations de la créatrice portent souvent sur Les questions du lieu, de l’habitat et de l’intimité. A la manière d’une Sophie Calle – mais avec moins de stratégie délibérément voyeuriste – la recherche du lieu porte vers quelque chose de trouble et de troublant. Celle qui rêve « sur un tas de feuille morte de se sentir chez soi » a quitté son lieu d’origine (Genève) pour retrouver sa propre intimité. Elle pénètre par exemple en inconnue dans la maison d’une personne décédée ou en étrangère dans son pays d’adoption, l’Allemagne, encore habitée en filigrane des heures sombres du passé où certains furent jetés hors de chez eux.
Suivre à la trace des autres, retrouver les tréfonds troubles d’un pays revient pour Sarah Hildebrand à se faire plus petite afin d’en savoir plus sur elle en ce qui tient non de la fantaisie personnelle mais de la traversée du désir d’un âge d’innocence à un âge adulte. L’histoire de l’œuvre est donc l’histoire d’une accession à soi par l’intermédiaire de l’autre sur lequel l’artiste joue parfois de son pouvoir de séduction lors de la rencontre avec des êtres qui partagèrent un temps sa vie. Toutefois si Sarah Hildebrand livre dans « Chez soi » une partie de ses histoires vraies celles-ci nous renvoient à nos propres histoires dans nos maisons.
Fuyant celles où elle pourrait vivre, la créatrice reste inaccessible à la prise par les murs et ceux qui les hantent. Au mariage – et quelle qu’en soit la nature – qui l’engagerait, elle préfère les mariages « blancs » même si certaines maisons cachent des mystères là où « la tapisserie jaunie raconte des histoires de chambres ». D’entre les murs, l’auteur se plait soit à regarder avec une précision manique soit à rêver l’altérité des autres. Fantôme ou réalité, l’autre sert donc d’appât à une identité qui ne se définit que par les dépôts à travers lesquels Sarah Hildebrand crée ses dépositions, ses process figuratifs.
A l’aide d’indices abandonnés ou répertoriés lorsque la colocation ou la cohabitation les imposent, chaque lieu devient un site particulier dans lequel l’auteur aborde les problèmes de la perception visuelle et la découverte du secret. C’est là une manière de rejouer une histoire à l’aide de fragments et vestiges, une histoire qui demeurera opaque à travers une œuvre d’essence parfaitement autobiographique mais qui se refuse de raconter quoi que ce soit qui ressemblerait à une confidence ou à un récit de souvenirs d’ordre vraiment intimiste. La distance est de rigueur, une rigueur presque calviniste (Genève colle aux basques).
Textes et dessins déplacent les symptômes de l’existence. Ils demeurent suffisamment opaques pour permettre une accessibilité au secret. L’écriture se veut neutre et le dessin abstrait : cela évite une intimité trop fracturée. Néanmoins quelque chose d’autre qui pourrait bien se révéler de l’ordre de la peur (de la reconnaissance) ou de la perte. L’œuvre de l’artiste nous apprend donc l’angoisse inhérente à tout acte de franchir une porte, d’arpenter un lieu qui n’est pas le nôtre donc de vouloir entrer en effraction avec le secret de l’autre.
Sarah Hildebrand reprend ainsi le descente de l’Igitur enfant de Mallarmé. Comme lui elle émet un coup de dés, entre dans un « tombeau » pour le pénétrer et voir ce que cachent les formes d’un lieu, les traces d’un avoir-lieu. S’il y a eu drame, celui-ci garde son retrait, son « secret inabordable » dont disait le poète « on n’a pas l’idée, sinon à l’état de lueur seulement, le temps d’en montrer la défaite ».
En une telle perspective et pour rester avec lui, « rien n’aura lieu que le lieu ». Ne subsistent que les contours indiciaires qui s’orientent non vers la présence mais l’absence, non vers la description du visible mais vers un travail prenant acte d’une disparition. Se crée en conséquence une autobiographie à la fois parfaite et parfaitement inaccessible à celle même qui l’entreprend dans des approches qui se voudraient le rabattement d’un lieu (visible, regardable) sur l’état du sujet invisible mais qui nous regarde c’est-à-dire nous concerne. Ce sujet peut se trouver aussi bien hors qu’au-dedans de soi.
De l’opacité surgit néanmoins une transparence. Chaque lieu devient en effet le miroir de la propre psyché de l’artiste. Afin de réussir ce transfert, Sarah Hildebrand sait jouer de notre curiosité (voire de notre voyeurisme) pour faire de nous des complices. Avec elle, nous demeurons en effet bien éloignés des filatures farcesques à la Loft Story et de la téléréalité. La créatrice ne cherche jamais les effets de fantasme. Le but – en une sorte de rhétorique spéculaire particulière – est de parvenir à déboulonner le surmoi des lecteurs.
Et si le texte « rejoue » l’histoire de l’artiste il reste quelque chose inaccessible par excellence – ce qui surgit de la mémoire du lieu n’est rien, rien que ce qu’Edgar Poe écrit à la fin de la Chute de la maison Usher : « des images répercutées, renversées entre vapeurs et couleurs plombées ».
La généalogie à reconstituer s’éprouve donc comme une question posée par la créatrice à nous-mêmes interrogés par les traces de l’autre sur notre propre secret. L’artiste pose une question capitale pour elle et pour chacun de nous : « De quoi sommes-nous orphelins ? ». Afin d’épuiser cette question, l’artiste n’en finit pas de provoquer des situations afin de percuter la gangue du secret pour la faire éclater. Nous sommes donc chaque fois portés bien loin d’un pur « décor », nous sommes devant les lieux comme dans l’équilibre crépusculaire d’une sorte de connaissance par les gouffres de l’absence et du passé.
Ici il n’est plus question de rêves, de dérives extatiques même si l’artiste ouvre la porte de chambres où tout est permis. La règle de « l’ob-scène » est d’abord pour l’artiste le moyen de casser un « éthos » rigoriste dans lequel – malgré ce qu’on dit et ce qu’on nous montre – nous restons immergés. C’est pourquoi les dessins de l’artiste comme ses « histoires vraies » créent à la fois un effet de lointain mais surtout une dernière avancée vers l’intériorisation. Nous ne sommes plus face au miroir de l’artiste mais devant le nôtre.
©Jean-Paul GAVARD-PERRET