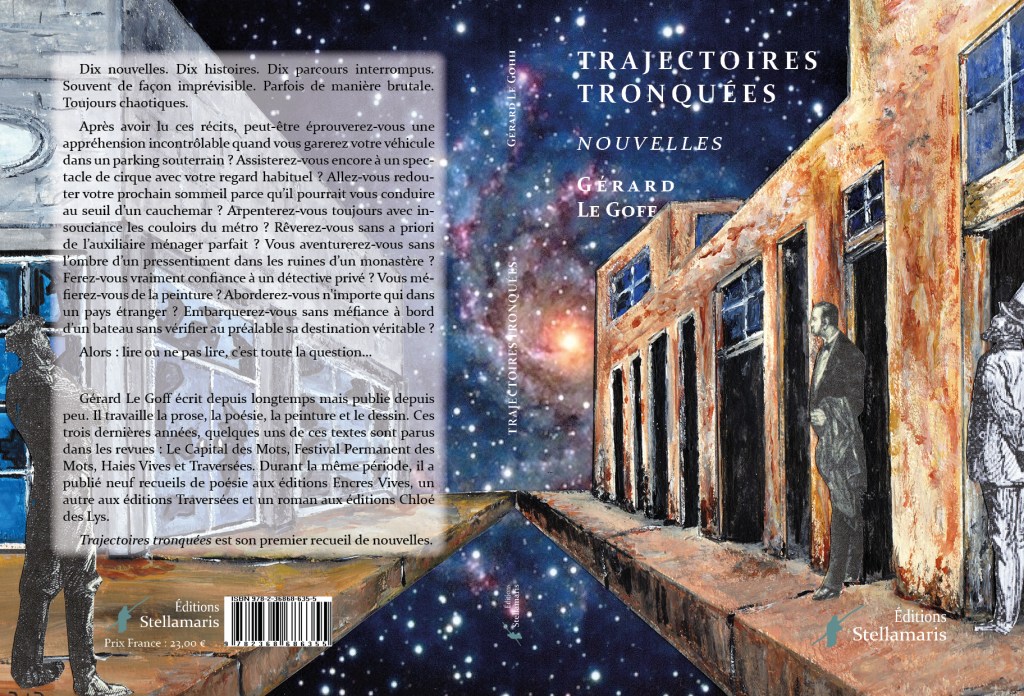Une chronique de Claude Luezior
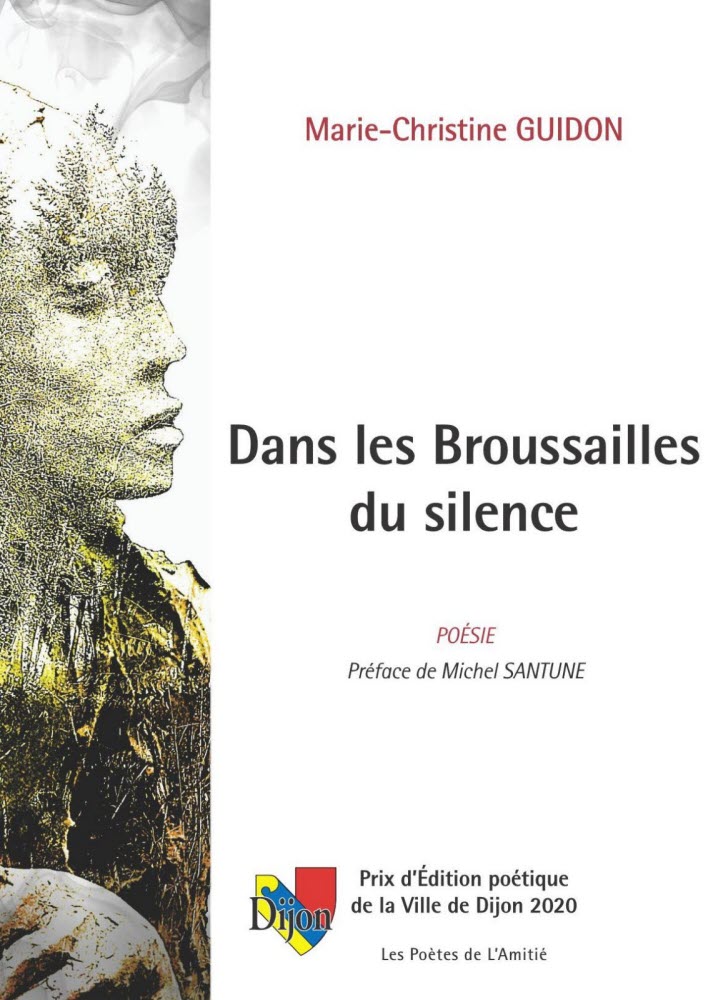
Marie-Christine Guidon, Dans les Broussailles du silence, Prix d’Édition poétique de la Ville de Dijon 2020, Les Poètes de l’Amitié, Préface de Michel Santune, 48 pages, ISBN : 978-2-917754-19-1
Fruit d’un concours de haute tenue dont le jury figure en photo à la fin du volume (pourquoi pas ? c’est assez inédit), ce recueil décline son élégance de manière dépouillée:
Des silences cousus
Aux ourlets de ton âme
Avec des fils de soi
Des lambeaux de passé
Peu à peu effrangés
Aux couleurs amnésiques
Poésie libre mais non débridée, de grande sensibilité mais canalisée par une parfaite maîtrise de la langue. N’allez toutefois pas croire que le propos est insipide : assez fréquemment, la plume se fait dague, par exemple pour décrire l’Etoile filante : Les nuits griffées (…) Les tympans éclatés (…) Les heures brûlées (…) Le regard éventré (…) Les soupirs lacérés (…) Mon cœur écartelé (….)
Ton grave, parfois : Ta présence maraude / En quête / De souvenirs froissés… Mots rebelles, rouleaux de suppliques, tourments… sur la grève meurtrie : Chateaubriand serait-il toujours d’actualité ? Ah, mon Bon Monsieur, tant que l’âme humaine sera présente…
Certes, l’on se méfiera des eaux dormantes… L’un dans l’autre, la démarche est de débroussailler le silence : serait-ce en définitive une constance du poète face à la nature, face à sa propre nature ? Une manière de transcrire la complexité du monde en paillettes de beauté :
À la flamme qui vacille
Dansent les mots
Farandole improvisée
Sur la page qui s’anime
Valsent consonnes et voyelles
Fantaisie intemporelle
Dans l’encrier qui bouillonne
Fusent rires et larmes
Carnaval imaginaire
Carnaval, charivari, danse, mais imaginaire. Comme l’écrit Michel Santune dans sa préface : Le silence est nécessaire à la création poétique car il permet, après l’effacement de la rumeur du monde, l’affleurement de l’invisible peuplé de voix, d’images, de souvenirs.
Il s’agit donc de chaparder le temps perdu :
S’envolent les serments
Dès les premiers frimas
S’évanouissent les mots
Car seuls
Les écrits restent
Verba volant, scripta manent. Une manière de poser son caillou pour un petit bout d’éternité.
©Claude Luezior