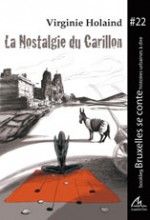Une chronique d’Éric Allard
Arnaud DELCORTE, Une lumière incertaine. Roman. Préface de Joseph Ndwaniye, postface de Vincent Tholomé. Bruxelles, éd. M.E.O., 2023.
Une lumière incertaine est le premier roman d’Arnaud Delcorte. Il raconte à la première personne le parcours d’un réfugié africain du début des années nonante à nos jours, de Kigali à Bruxelles.
C’est d’abord à Bruxelles qu’on découvre Olivier Tegera dans ses activités de subsistance au quotidien, survivant dans la marge, sans reconnaissance. Sa principale occupation consiste à trouver un lieu où dormir, quelque chose à manger, comment se laver et passer la journée dans une relative sécurité avec les étoiles du ciel comme uniques garantes de la permanence de choses. Quelqu’un qu’on ne prend pas en compte, qu’on ne voit pas, invisible des autochtones comme tenu à l’écart des Africains d’origine.
« Je ne les vois pas plus qu’ils ne me voient. Comme si nous évoluions dans des univers parallèles.»
Très vite, on suit à rebours son périple, les conditions de son départ, son voyage jusqu’en Belgique ; à pied, en camion, par train et par bateau, jusqu’en Belgique, via le Congo, l’Egypte, l’Algérie et la France.
Le récit est ponctué par des bribes de narration inspirées de vignettes d’une bande dessinée trouvée parmi les vieilleries déposées près d’une poubelle mais aussi par les épisodes de la légende de Rutegaminsi qui conte les aventures d’un jeune homme devant braver les obstacles mis sur la route menant à son aimée par le père de celui-ci.
Le récit est strié des éblouissements et obscurcissements, jusqu’à la perte de connaissance, des plongées dans le noir et des réveils brumeux d’Olivier Tegera. Entre songe et âpre réalité, on bascule « de la violence la plus extrême à la douceur la plus suave » [Vincent Tholomé].
Ces différents plans de narration font de ce roman un livre rare et allégorique sur le sujet de la migration autant que sur celui de l’homme confronté aux éléments pour trouver sa place sur la Terre, en bonne intelligence avec les forces qui le dépassent et son aspiration à satisfaire ses sens et combler son besoin d’amour.
Lors de la rencontre entre le sans-abri et le scientifique, ce dernier lui apprend que le cosmos « serait essentiellement constitué de matière noire, […] trame invisible mais massivement présente de l’univers » qui demeure inexplorée et énigmatique. On pense inévitablement à l’Homme Noir, le réfugié qu’on ne voit pas, mais aussi au visage d’autrui, du passant…
« C’est curieux comme on croit connaître les gens. Sans jamais vraiment les connaître. On capte leur visage, leur nom, la calligraphie bleutée des veines sur le dos de leurs mains ou plus rarement sur leurs tempes. Des cartes vues de pays lointains qu’on aimerait découvrir. Des mirages. Parfois je me dis qu’il n’y pas de connaissance possible… »
Un livre aussi ténébreux qu’éclairant qui questionne la nature humaine et le mystère de l’existence.