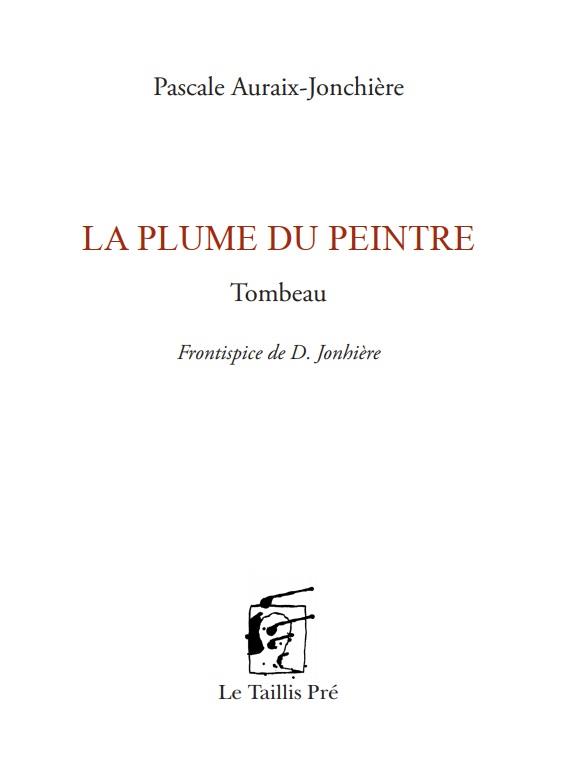Une chronique de Catherine TAUVERON
Pascale Auraix-Jonchière, La plume du peintre. Tombeau, Le Taillis Pré, Châtelineau, 2023
En fine connaisseuse de la poésie du XIXème siècle, Pascale Auraix-Jonchière reprend la tradition du Tombeau, en hommage à son père mort. Bouleversant dans son âpreté, le recueil, et le mot prend en la circonstance son double sens, s’intitule La plume du peintre. La plume du peintre, comme l’indique la 4ème de couverture, est une petite plume pointue en forme de fer de lance, souple et rigide à la fois provenant de l’aile de la bécasse des bois et qui, au Moyen Age, servait pour réaliser les enluminures. Elle s’inscrivait, s’immisçait dans les marges et le corps du texte pour le recouvrir de couleurs vives. Cette plume du peintre, confondue avec la plume de l’écrivaine, ou fondue en elle, ne trace pas ici une auréole de lumière autour du mort, ne se fait pas hagiographique, comme l’a voulu à ses origines la tradition du Tombeau. Elle n’est pas non plus célébration, déploration, ou consolation (« foin des cérémonies ») : en apparence adaptée au défunt qui fut, à ce que l’on sait, chasseur à ses heures, lui convient mieux cependant la pointe sèche d’acier des eaux-fortes, qui recourt à la morsure de l’acide, pour « forer les peines », gratter, dénuder la couche protectrice et polir, aussi, in fine, comme un dessin sur le sable.
Tout part du point ultime, le masque mortuaire imposé au regard : un visage pétrifié, « vrillé », à « la mâchoire étirée de pierre », aux lèvres de « papillon crucifié », visage de « Mohican » ensauvagé ou « gueule d’ange », « mon ange » prêt à monter aux cieux, selon l’angle du regard, mais présence manifeste d’une absence :
Toi
lèvres cousues
beau gisant
et sous l’habit
– foin des cérémonies –
ton corps maculé d’encre
Redonner vie au mort ne peut se faire que par une opération de transfusion lexicale ou de perfusion d’encre, ce que sait faire le poète : par procuration (car « le vent a saisi tes paroles/ qu’il noue/ dans le grand sarrau de la nuit »), il s’agit de découdre les lèvres, d’insuffler les mots, « rugueux », d’instiller les phrases, de « faire palabre » en grattant les pages comme une peau :
Je te prêterai des paroles nues
La poétesse se fait médium spirite. Et s’entrelacent alors, par un jeu de typographie, « ce qu’il dira » (mais, comprenons-nous, n’a jamais pu dire, « le récit est inentamé », les bouches sont restées closes) et ce que sa fille, la gorge nouée, dira de lui, lui dira, dans une sorte de colloque violent (« Ouvrir les portes/Père/avec fracas ») et tendre à la fois.
Du corps maculé d’encre, doit apparaître, dans le noir, la lumière du noir, à la manière de Soulages (évoqué au détour d’un vers) qui n’a eu de cesse de creuser l’intensité chromatique et lumineuse du noir, son autorité, sa gravité, son évidence et sa radicalité. Pour ce faire, la plume du peintre, trop légère, ou la pointe d’acier de l’eau-forte ne suffisent pas. Est nécessaire de recourir aussi au fusain ou, comme Ernest Pignon-Ernest, à la pierre noire « de l’absence » qui n’est autre que le charbon, et qu’on estompe (« point trop ») à la gomme en en raclant la trace :
ton corps maculé d’encre
muscles de soleil dur et de charbon
tendus
quoi qu’on en ait
vers plus de lumière
Et graphite et fusain
Houille
et plomb des mines tendres
point trop
pour l’estompe de
tes traits
froidis
ou, plume
pour dire
et peindre le portrait
introuvé
Peindre l’introuvé est une entreprise redoutable, qui n’est pas si éloignée de celle rencontrée par le peintre Asle mis en scène par Jon Fosse, nouveau prix Nobel de littérature, dans L’autre nom (Christian Bourgois Editeur, 2021). Dans son monologue logorrhéique de 431pages, il ne cesse de penser son art :
« quand je peins c’est toujours un peu comme si j’essayais de dé-peindre des images […] qui se sont fixées en moi […] pour en quelque sorte me déprendre d’elles […] tellement d’images qu’elles sont un déplaisir, une importunité, oui elles m’importunent à force de surgir et de ressurgir, oui, comme des visions pour ainsi dire, dans toutes sortes de moments et de lieux, et je ne peux rien y faire, tout ce que je peux faire c’est me défaire d’elles, me déprendre d’elles en les peignant » (p.37-36)
« j’attends pour me séparer d’une image de l’avoir vue dans l’opacité, j’attends que l’oeil se soit pour ainsi dire habitué à l’obscurité, et je vois l’image tel un jeu d’ombres et de lumières, et je regarde l’image afin de voir les manières et les endroits dans une image où brille la lumière, et c’est toujours, c’est toujours dans l’obscurité qu’une image a le plus de lumière et je pense que c’est sans doute pour cette raison que Dieu gagne en proximité dans le désespoir, dans le noir » (p. 119-120)
Saisir la lumière dans l’opacité, et l’opacité dans la lumière (« faire lumière aux marges de la nuit ») est un thème récurrent (« noir beau/ diamant noir ») dont témoigne encore ce qui suit :
la pensée des oiseaux
on dirait
vous extrait du puits de mine
perclus de lumière
noire
parés d’or fin
Peindre pour dé-peindre et se dé-prendre, tel me semble d’un des objectifs du recueil. C’est ce que Asle appelle : « rechercher l’obscurité lumineuse » :
« l’obscurité lumineuse que j’essaie toujours de peindre devient visible dans l’obscurité oui, plus il fait sombre plus ce qui brille de façon invisible dans une image devient clair[…] oui il y a des cieux si beaux qu’aucun peintre ne peut les égaler, et les nuages, oui, dans leurs mouvements infinis, toujours identiques et toujours,différents, et le soleil et la lune et les étoiles aussi, oui, mais il y a aussi la mort, le pourrissement, la puanteur, l’étiolement, la corruption, et tout ce qui est visible est uniquement visible, que ce soit beau ou laid, mais ce qui a de la valeur, ce qui brille, ce qui dégage une obscurité lumineuse, oui, c’est l’invisible dans le visible (p. 418-419)
L’épitaphe choisie pour le tombeau (empruntée à Pierre Bergounioux) ne dit pas autre chose :
« Les êtres et les choses, quand ils sont là, on n’y pense pas. Il faut les perdre. Alors ils ne sont plus que par nous et c’est en leur absence qu’ils nous livrent ce qu’on n’a pas vu. ».
Passé le temps de l’élévation vers les constellations visibles dans la nuit, convoquées par le nom, Altaïr, donné à la salle du funérarium où repose le corps du père, et le rêve d’atteindre Orion, le grand chasseur, qui, « porte un nom d’urine et d’or fin », la plume perd sa légèreté. Il faut consentir à descendre pour retracer, métaphoriquement, les pas terrestres de celui qui, dans une « saison renversée » (raison inversée ?) s’est retrouvé, « chasseur sourd ou/quasi », aveugle et « dépourvu de boussole » dans la forêt, autrefois familière et source d’allégresse, devenue « cri », et qui se voit contraint, avant la prostration, de « creuser le bois/ de [ses] ongles » et de « cautériser les plaies de l’écorce ». Dire l’histoire d’un absentement soudain au monde :
Saura-t-on jamais
quand et pourquoi
cessa
le haut frisson des arbres
La descente se poursuit dans le ventre de la Terre noire, celle du paysage minier de l’enfance paternelle et de ses puits profonds que le père semble avoir un temps lui-même explorés (« Père/maquillé de suie ») avec casque et lampe (il faut bien toujours que soit cette petite lumière dans l’obscurité profonde) : houille et suie et gueule et noir et poussière et graphite et fusain et plomb des mines, litaniques, se succèdent et se bousculent pour tenter de dire ce qui ne fut pas dit. Comme reste inentamé le récit même de l’enfance noire :
Noir du puits quand
petit
Noir même pas peur de la chambre
noire
Noir de cave
et d’armoire
Le noir est le signe même d’une filiation : le père a des « cheveux de fusain/noir », sa fille est noire/de sexe/ et de cils ».Voilà pourquoi « elle dira », et elle a dit. Le recueil s’achève sur un retour de la plume au point de départ : le « masque de guerrier/ et de grand blessé » du père allongé au funérarium, qui désormais peut dormir tranquille.
Ce qui fait le prix de ce recueil poétique, c’est l’absolue beauté de sa parole nue, qui taille au couteau de splendides images, et qui, par l’usage du blanc typographique, de la rétention verbale, de la suspension et de la distorsion syntaxique :
Quand le vent
ne plus
dans
les cheveux
parvient à appréhender une vie, dans sa pulvérulence, ses chaos, et ses blessures.